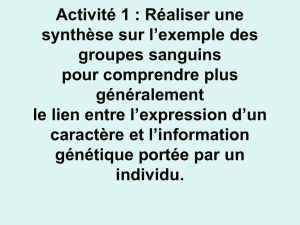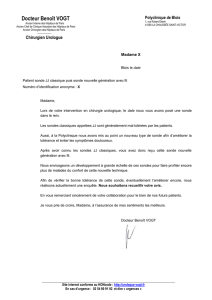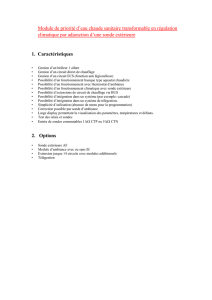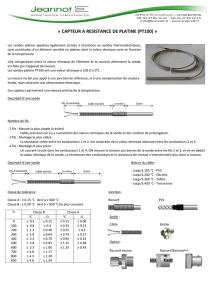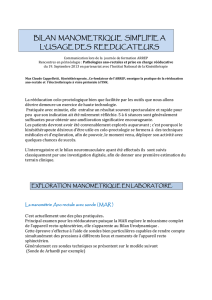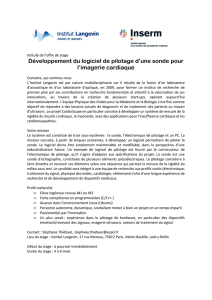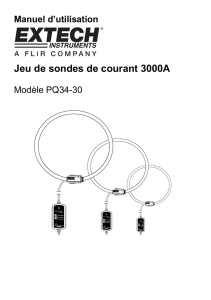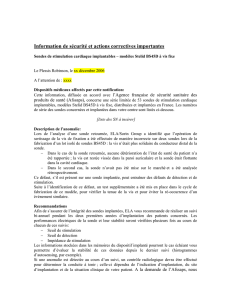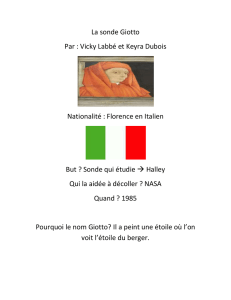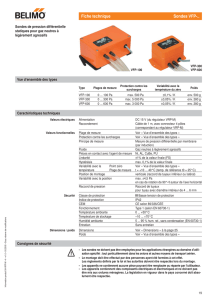Incertitudes sur les sondes intracardiaques de

DOSSIER
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés 17AMC pratique n°235 février 2015
MISE AU POINT
En 20 ans, les indications du défibrilla-
teur automatique implantable (DAI)
se sont progressivement développées
en prévention secondaire et primaire de la
mort subite. De plus en plus de patients
sont implantés chaque année. En 2014,
environ 13000 DAI ont été implantés en
France, plus de 300 000 dans le monde.
Le talon d’Achille de la défibrillation est
la sonde. En effet, la sonde de défibrilla-
tion est un condensé de technologie alliant
souplesse et résistance. Celle-ci est soumise
à d’importantes contraintes mécaniques
(mouvements du patients, battements
cardiaques…) l’exposant à des risques de
fracture. L’altération des
performances de la sonde
ou sa fracture peuvent
survenir dans un délai dit
d’usure « normale » qui
reste à définir. En effet, comme tout com-
posé mécanique, il peut s’altérer au cours
du temps. Il n’y a pas à ce jour de définition
de la durée de vie théorique d’une sonde
mais en l’implantant, le cardiologue pour-
rait espérer pouvoir s’en servir pour une
durée d’une quinzaine d’année, voire plus.
Ces dernières années ont été marquées par
la survenue de problèmes prématurés sur
les sondes de DAI amenant des questions
sur la prise en charge de ces patients et sur
la fiabilité de ces sondes.
Historique
Le premier DAI a été implanté chez l’homme
en 1980 avec à l’époque des patchs péricar-
diques. Les premières sondes endocavitaires
sont implantées en 1989. Depuis, le nombre
de patients implantés augmente et avec le
temps apparait la problématique de l’usure
naturelle ou prématurée de ces sondes avec
les questions inhérentes à ce problème :
– en cas de problèmes sur la sonde, faut-il
extraire et réimplanter ou ajouter simple-
ment une nouvelle sonde ?
– si le patient est porteur d’une sonde à
risque de rupture prématurée connu, faut-il
la changer et quand ? Comment surveiller
le patient si on conserve la sonde qui pose
problème ?
Autant de questions qui deviennent de plus
en plus fréquentes avec le vieillissement
de notre population de patients implantés
d’un DAI et auxquelles nous allons essayer
de répondre dans cet article.
Problématique des sondes de DAI
L’espérance de vie des patients augmente,
amenant à des changements de boîtier.
Après une nouvelle intervention (change-
ment de boîtier ou upgrade en biventricu-
laire), il est connu que le taux d’incident sur
les sondes de défibrillation augmente [1].
Par ailleurs, le nombre des patients implan-
tés d’un DAI augmente et la technique se
complexifie : double chambre puis triple
chambre.
Cette évolution naturelle s’accompagne
d’un certain nombre de problèmes sur les
sondes. Le taux de défaillance de sonde de
DAI nécessitant une nouvelle intervention
augmente progressivement dans le temps
pour atteindre 20 % à 10 ans [2]. Ce taux
est en partie expliqué par le vieillissement
naturel du matériel mais également par des
problèmes spécifiques liés à la technologie
C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, C. Kouakam, G. Fayad, F. Brigadeau, D. Lacroix, S. Boule, S. Kacet, D. Klug
Département de cardiologie, Centre hospitalier régional universitaire, Lille
Incertitudes sur les sondes intracardiaques
de défibrillation ?
Le talon d’Achille de la
défibrillation est la sonde.
17-25_AMCVP235_MAP2.indd 17 17/02/15 14:11

Incertitudes sur les sondes intracardiaques de défibrillation ?
MISE AU POINT
18
DOSSIER
AMC pratique n°235 février 2015
MISE AU POINT
intrinsèque des sondes et en particulier, à
deux modèles de sonde avec un taux inha-
bituel de dysfonctionnements entraînant
le retrait de ces sondes du marché et la
problématique de la gestion des patients
implantés de ces sondes. Une étude récente
sur le suivi de 5288 patients implantés d’un
DAI entre 2000 et 2012 au centre universi-
taire de Pittsburg montre un taux de dys-
fonctionnement global de 10,7 % à 5 ans,
avec un taux de défaillance qui augmente
dès la deuxième année pour les sondes
Fidelis et Riata [3].
Mécanismes et diagnostic
du dysfonctionnement
des sondes de défibrillation
Les dysfonctionnements de sonde précoces
sont dus à des déplacements de sondes, des
perforations myocardiques ou des seuils de
stimulation élevés. Les dysfonctionnements
tardifs sont liés à des phénomènes d’usure :
défaut de l’isolant ou rupture des conduc-
teurs. Le diagnostic repose dans les deux
tiers des cas sur la survenue de modifica-
tions des paramètres électriques de cette
sonde (chute du recueil, élévation du seuil,
modification de l’impédance) et dans un
tiers des cas le diagnostic est fait en rai-
son de la survenue de chocs inappropriés
sur du bruit. Le taux de chocs inappropriés
a diminué ces dernières années grâce au
dépistage précoce de ces anomalies par la
télécardiologie.
Les premières sondes concernées sont
les sondes Sprint Fidelis de Medtronic®
(6930-6931-6948-6949). Ces sondes ont
été implantées en France de 2004 à 2007
avec retrait du marché en octobre 2007, du
fait d’un taux de défaillance trop impor-
tant. L’analyse de ces sondes défaillantes a
montré deux sites principaux de fractures :
« l’extrémité distale de la sonde, affectant
l’anode (électrode à anneau) et au niveau
inférieur du manchon de fixation, affectant
principalement la cathode (électrode à vis) ;
occasionnellement, cela peut se produire au
niveau du conducteur haute tension » [4].
Cela se manifeste chez les patients concer-
nés par des modifications des paramètres
électriques de la sonde et/ou des phéno-
mènes de bruit enregistrés par le DAI qui, si
ils durent trop longtemps, aboutissent à la
survenue d’une thérapie inappropriée (ATP
ou choc). Une sonde qui dysfonctionne peut
également être à l’origine d’une inefficacité
du DAI. Le mode de révélation du dysfonc-
tionnement peut être brutal avec d’emblée
des thérapies inappropriées ou être dépisté
en amont par des signes précurseurs : élé-
vation de l’impédance et surtout surve-
nue de bruit sur la sonde enclenchant un
système d’alerte sonore à partir du DAI
du patient ou dépisté grâce à la télésur-
veillance. Actuellement, le taux de dysfonc-
tionnement de ces sondes est de 10 à 15 %
à 5 ans selon les études, alors qu’une sonde
considérée comme normale, le taux est de
moins de 1 % à 5 ans [5].
La seconde série de sondes concernées
par un taux de défaillance anormale est
les sondes Riata de Saint Jude Medical®
(Riata 8F: Modèles 1560, 1561, 1562, 1570,
1571, 1572, 1580, 1581, 1582, 1590, 1591,
1592 et Riata ST 7F: Modèles 7000, 7001,
7002, 7010, 7011, 7040, 7041, 7042). Ces
sondes ont été commercialisées en France
de 2003 à 2011, date de leur retrait du
marché. Le problème posé par ces sondes
est différent de celui des MEDTRONIC®.
L’anomalie constatée est une externalisation
des conducteurs par abrasion et rupture de
l’isolant rendant visible les conducteurs hors
du corps de la sonde. L’externalisation est
principalement due à un mouvement relatif
des conducteurs dans la lumière de l’isolant
aboutissant à une abrasion « Inside-out ».
La localisation de cette externalisation
se situe le plus fréquemment sur les 8 cm
en amont du coïl de défibrillation, là où
les contraintes mécaniques sont les plus
importantes (figure 1). Le taux d’externa-
lisation constaté est autour de 10 % pour
les sondes 7F et de 20 à 30 % pour les
sondes 8F [6]. Cette différence s’explique
par la position des conducteurs dans le
corps de sonde. En effet ceux-ci sont plus
proches du centre de la sonde dans les
sondes 7F et donc moins soumis à la force
centrifuge (figure 2). Cette externalisation
des conducteurs se dépiste par la radio-
graphie de thorax face et profil si possible
17-25_AMCVP235_MAP2.indd 18 17/02/15 14:11

MISE AU POINT
C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, et coll.
19
DOSSIER
AMC pratique n°235 février 2015
numérisée. L’externalisation ne s’accom-
pagne de modifications des paramètres
électriques de la sonde que dans 30 à 40 %
des cas. Les modifications de paramètres
électriques sont : modifications de l’impé-
dance de stimulation ou de défibrillation,
thérapies inappropriés, bruits et sur détec-
tions et élévation de seuils. Par ailleurs,
dans le cas d’externalisation des conduc-
teurs sans modification des paramètres, il
n’existe aucun moyen certain de détermi-
ner l’intégrité électrique de cette sonde et
sa capacité à défibriller.
Enfin, il existe des patients à plus haut risque
de fracture de sonde. Cette sous-population
de patients est peu nombreuse mais bien
identifiée. Il s’agit des patients jeunes et
actifs car les contraintes sur la sonde sont
plus importantes chez un patient jeune qui
garde une activité physique voire sportive
importante. Par ailleurs, l’espérance de vie
de cette population jeune peut être longue
comme pour des patients implantés pour
un syndrome de Brugada ou une cardiopa-
thie hypertrophique. Cette problématique
a été décrite chez les patients implantés
d’un DAI pour syndrome de Brugada par
Figure 1. Externalisation des conducteurs des sondes Riata.
1A. Mouvement centrifuge des conducteurs.
1B. Externalisation d’un conducteur visible sur la radiographie.
Figure 2. Différences de structure de sondes Riata entre la 7F et la 8F. Les conducteurs sont
plus près du centre pour la 7F que la 8F mais l’épaisseur du silicone est la même.
17-25_AMCVP235_MAP2.indd 19 17/02/15 14:12

Incertitudes sur les sondes intracardiaques de défibrillation ?
MISE AU POINT
20
DOSSIER
AMC pratique n°235 février 2015
MISE AU POINT
exemple où le taux de rupture de sonde est
de 16 % à 56 mois pour atteindre 29 % à
10 ans [7]. Les ruptures précoces de sonde
de DAI sont aussi connues chez les enfants
ou les cardiopathies congénitales du fait de
contraintes mécaniques plus importantes :
11 % de fracture de sonde à 4 ans pour des
patients âgés de moins de 21 ans [8].
Faut-il extraire ?
Alors, première question : en cas de
défaillance d’une sonde faut-il l’extraire et
implanter une nouvelle sonde ou mettre la
sonde défaillante sur bouchon et implanter
une nouvelle sonde ?
Considérons d’abord le premier choix :
extraire
L’extraction de sonde de DAI a été étudiée
dans plusieurs études. La difficulté consiste à
retirer une sonde qui au fil des années devient
adhérente au structures qui l’entourent :
adhérence au niveau du système veineux
(veine sous-clavière, tronc veineux innominé,
veine cave supérieure), adhérence au niveau
des structures cardiaques (paroi de l’oreillette
droite, valve tricuspide et l’endocarde du
ventricule droit). Les sondes sont également
adhérentes les unes aux autres, quand il y en
a plusieurs (sonde auriculaire et sonde sinus
coronaire, voire vieille sonde ventriculaire
droite). L’extraction de sonde a été initiale-
ment l’apanage des chirurgiens cardiaques.
Ces extractions étaient réalisées sous circula-
tion extracorporelle dans un contexte essen-
tiellement de matériel infecté. Depuis, des
systèmes d’extraction percutanée se sont déve-
loppés dont le principe fondamental consiste
à décoller ces adhérences avec des outils méca-
niques (gaine de dilatation, système de cutter)
ou du laser. Le principe est toujours le même,
à savoir émettre une traction sur la sonde par
sa voie d’introduction en essayant de décoller
les adhérences. Des techniques par lasso par
voie fémorale existent également. Le risque
principal de l’extraction du matériel est la
survenue d’une plaie du système veineux
ou cardiaque pouvant entraîner épanche-
ment péricardique ou tamponnade et pou-
vant nécessiter le recours à la chirurgie car-
diaque en urgence avec risque éventuel de
décès. Dans les grandes séries d’extraction de
matériel, les complications graves sont rares
de 1 à 2 %, selon les publications avec un
taux de décès de 0,1 % [9, 10]. De ce fait,
l’extraction d’une sonde qui dysfonctionne,
mais qui n’est pas une menace vitale pour le
patient, est une indication de classe II selon
les recommandations de l’AHA 2009 (classe
IIa, s’il y a plus de 4 sondes du même côté ou
5 dans la veine cave supérieure, sinon il s’agit
d’une recommandation de classe IIb) [11]. Par
ailleurs, ces extractions de matériel allongent
le temps opératoire et sont donc un risque
supplémentaire d’infection.
On sait par ailleurs que la complexité de l’ex-
traction d’une sonde de DAI est liée à son
ancienneté (plus elle est ancienne, plus elle
est difficile à extraire), à l’âge du patient
(plus d’adhérence chez les patients jeunes)
à l’intégrité macroscopique de la sonde (les
sondes Riata seraient plus difficiles à extraire
du fait de l’externalisation des conducteurs).
Les complications liées à l’extraction de
sonde dépendent aussi du terrain du patient
(une cardiopathie sévère expose à des suites
opératoires compliquées en cas d’interven-
tion chirurgicale en urgence).
Pourquoi prendre le risque d’extraire
cette sonde et ne pas la laisser en place
tout simplement ?
Première raison évidente, c’est que nous avons
parfois à prendre en charge des patients
jeunes qui ont une espérance de vie élevée
(> 20 ans) et si ce patient présente deux rup-
tures de sondes à 5 ans d’intervalle, il peut
se retrouver avec une, puis deux, puis trois
sondes de DAI dans le ventricule droit, à tra-
vers la tricuspide. La coexistence de plusieurs
sondes de DAI pourrait engendrer une insuf-
fisance tricuspide et un sur-risque de fracture
de sonde du fait d’interférences entre elles.
Le risque d’interférence entre deux sondes est
faible surtout avec deux sondes mais il existe.
Par ailleurs, la multiplication des sondes dans
la veine cave supérieure expose à un risque de
thrombose de celle-ci.
La deuxième raison possible est l’occlusion
du système veineux. En effet, la survenue
17-25_AMCVP235_MAP2.indd 20 17/02/15 14:12

MISE AU POINT
C. Marquié, L. Wissocque, L. Guedon-Moreau, et coll.
21
DOSSIER
AMC pratique n°235 février 2015
d’une occlusion de la veine sous-clavière
par laquelle passe la sonde est de l’ordre
de 10 %. Dans cette situation, il n’est pas
possible de rajouter simplement une sonde
puisque la veine est occluse. Il faut soit
implanter en controlatéral, soit extraire la
sonde. La mise en place de matériel dans
une veine controlatérale alors que l’autre
est occluse expose à un risque majoré d’oc-
clusion de la veine cave supérieure.
La préservation du capital veineux est donc
la motivation principale à l’extraction d’une
sonde défaillante et ce d’autant plus que
le patient est jeune ou plus justement, que
l’espérance de vie du patient est longue.
La décision d’extraire ou non doit se faire
dans un centre de référence d’extraction de
sonde afin d’évaluer la balance bénéfice/
risque de la procédure. Un patient âgé, à
fraction d’éjection basse dont l’espérance
de vie n’excède pas 5 ans, ne sera pas
extrait. La problématique de l’extraction se
pose dès que les sondes ont plus de deux
ans de vie, période à partir de laquelle les
adhérences peuvent déjà être importantes.
L’information éclairée du patient est impor-
tante et il doit être associé à la discussion.
Faut-il vraiment réimplanter ?
Rappelons ici une évidence, à savoir que
toute complication grave et en particulier,
une rupture de sonde doit faire systémati-
quement rediscuter l’indication initiale de
l’implantation du DAI. En effet, les recom-
mandations évoluent, de même que la car-
diopathie du patient et le patient lui-même
vieillit. A partir du moment où une rupture
de sonde de DAI survient, la question du
maintien de l’indication se pose. On peut
faire le choix d’abandonner la sonde et sur-
veiller le patient. Ces situations sont extrê-
mement rares mais peuvent exister.
Comment gérer les sondes
à problème potentiel ?
Si le patient est porteur d’une sonde qui
pose potentiellement des problèmes, faut-il
la changer et quand ? Comment surveiller
le patient si on conserve la sonde qui pose
problème ?
Ces deux questions concernent les patients
porteurs de sondes qui sont connues pour
avoir un taux de défaillance élevé. Il s’agit
des patients avec les sondes Riata et Fidelis
qui, jusqu’à ce jour, fonctionnent parfaite-
ment bien, mais pour lesquelles on sait qu’il
existe un taux de défaillance élevé.
La solution est de suivre les recommanda-
tions de l’HAS.
Voici ce que l’HAS préconise concernant les
sondes Fidelis : « – le bénéfice/risque lié à
l’implantation d’une nouvelle sonde (avec
ou sans extraction de la sonde Sprint Fidelis)
doit être réétudié systématiquement en cas
d’intervention sur le système de défibrilla-
tion, notamment lors d’un changement de
boîtier ».
Le choix est donc clairement laissé au car-
diologue avec nécessite une fois de plus
d’évaluer le bénéfice/risque pour chaque
patient, comme nous l’avons déjà discuté
dans le paragraphe précédent, à la diffé-
rence près que nous parlons ici « d’extrac-
tion prophylactique ».
Il y a dans la littérature, des publications
spécifiques concernant les sondes Fidelis
avec des résultats très variables en termes
de complications. 7,25 % de complica-
tions majeures dans l’étude de Parkash
(25 centres, 468 Fidelis) dont 2 décès,
contre aucune complication dans l’étude de
Maytin (5 centres, 349 sondes) [12, 13]. En
contrepartie, le fait de conserver la sonde
Fidelis au moment du changement de boî-
tier expose le patient à un taux élevé de ré-
intervention pour fracture de sonde (36 %
à 5 ans, 49 % à 10 ans) et de chocs inap-
propriés (11 % à 5 ans, 15 % à 10 ans) [14].
L’attitude concernant les patients encore
porteurs de cette sonde et qui fonctionne
correctement est centre dépendant avec
discussion au cas par cas, en tenant compte
des risques potentiels de l’extraction qui
augmentent avec l’âge de la sonde, l’espé-
rance de vie du patient.
Certains centres ont fait le choix de chan-
ger de manière prophylactique et anticipée
toutes les sondes Fidelis, soit en ajoutant
simplement une nouvelle sonde de DAI,
soit en extrayant la sonde Fidelis. D’autres
17-25_AMCVP235_MAP2.indd 21 17/02/15 14:12
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%