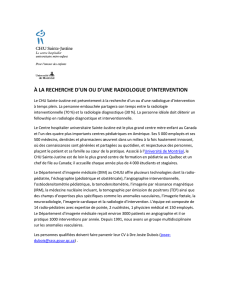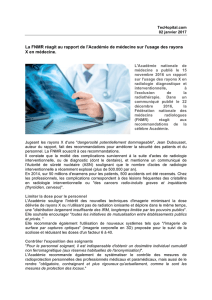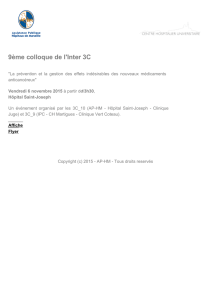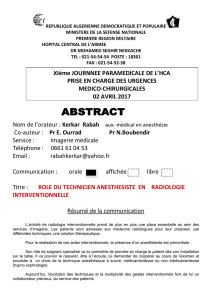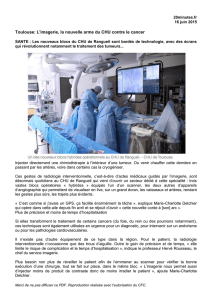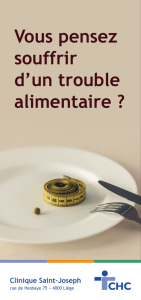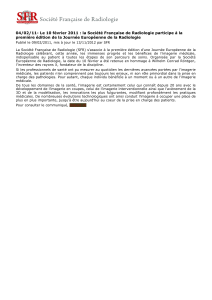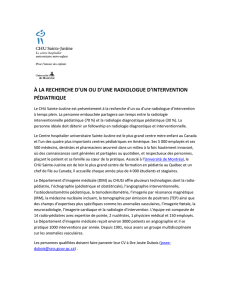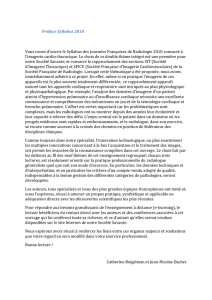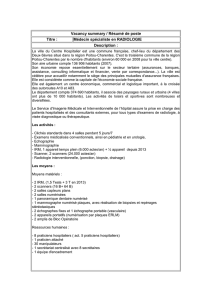C`est aussi la rentrée pour votre Blueprint

A l’instar des enfants qui revêtent leurs habits neufs
pour le grand jour, votre Blueprint de la rentrée a changé
d’habillage. Après environ 6 ans, un petit relooking s’im-
posait. Les couleurs ont été conservées, de même que
les rubriques. La ligne générale a été « rafraîchie ». Cette
nouvelle mise en page a également permis de dégager
de l’espace pour davantage de texte, sans diminuer la
lisibilité.
éditorial
C'est aussi la rentrée pour votre Blueprint
) Marianne Lebrun | service communication
Nous vous laissons découvrir ce « premier » numéro et,
comme nous le soulignons régulièrement, nous sommes
à votre écoute pour toutes vos remarques constructives.
Au nom du comité du Blueprint, je vous souhaite une
bonne rentrée et je vous laisse à la lecture de votre
« nouveau » Blueprint.
Neurochirurgie
Dr Frédéric Collignon
Le Dr Frédéric Collignon est diplômé de la Faculté de médecine de l’ULg en 1994. Il
se spécialise en neurochirurgie au CHU de Liège, formation qu'il termine en 2000.
Il séjourne ensuite trois ans aux Etats-Unis dont deux à la Mayo Clinic où il apprend
entre autres la chirurgie de l’épilepsie, des anévrysmes intracrâniens et de la base du
crâne. Il part ensuite un an à New-York, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
où il se spécialise dans la chirurgie neuro-oncologique cérébrale et rachidienne et où
il acquiert une expertise dans la chirurgie crânienne éveillée, au cours de laquelle le
patient reste conscient et coopératif ce qui permet de minimiser le risque de lésion
cérébrale irréversible pendant l'exérèse de sa tumeur cérébrale.
Au cours de ces trois années, le Dr F. Collignon publie une quinzaine de papiers
scientifiques dans les plus grandes revues internationales et intègre le laboratoire
d’anatomie pathologie et d’immunologie expérimentale de la Mayo Clinic, ce qui lui
permet de générer une base de données qui sera à l’origine de sa thèse de doctorat.
Il bénéficie également de l’infrastructure du laboratoire d’anatomie, lui permettant de
développer ses compétences dans la chirurgie de la base du crâne.
Dès son retour en Belgique, il travaille à la clinique du Parc Léopold (Bruxelles) où il
contribue au développement, au sein du service, des techniques minimalement inva-
sives dans la chirurgie du rachis dégénératif et traumatique comme la kyphoplasie et
les ostéosynthèses par voie percutanée.
Le Dr Frédéric Collignon vient aujourd’hui compléter l’activité du service de neurochi-
rurgie du CHC dans le domaine de la chirurgie du rachis et la chirurgie des tumeurs
cérébrales.
Contact
Clinique Saint-Joseph
Service de neurochirurgie
04.224.89.10
Lundi et vendredi
nouvelle tête
Ed. resp. : Association des médecins exerçant aux Cliniques Saint-Joseph
) Trimestriel | n° 96 | septembre 2010
Belgique - België
PP-PB
B 018
blueprint
Sommaire
Vie des cliniques
Cliniques Saint-Joseph
16e journée médicale .......................................... 2
Clinique de l’Espérance
La rééducation pédiatrique s’agrandit ............... 2
Clinique Saint-Joseph
Nouveau bloc d’angiographie-radiologie
interventionnelle .................................................. 3
Le point sur
Mesure de la dose de rayonnement
délivrée au patient en radiologie
Principes et dispositions réglementaires ........4-5
Agenda
13e journée de stomatologie et
chirurgie maxillo-faciale ..................................... 5
Clinique et thérapeutique
L’éducation thérapeutique du patient :
nouvelle pratique de santé ? ............................6-7
L’avis du généraliste
De quelques éponymes médicaux
remarquables ...................................................... 8
Comité de rédaction
Dr Boris Bastens, Dr Christian Focan, Dr Jean-Pierre
Lambert, Marianne Lebrun, Dr Christian Mossay, Dr Didier
Noirot, Dr Philippe Olivier, Dr Martine Smeekens
Contact rédaction
Marianne Lebrun
rue de Hesbaye 75, 4000 Liège
tél. 04.224.85.62 | fax 04.224.80.93
Secrétariat
Anne-Marie Mandic | 04.224.80.98
Blueprint est le périodique de l'association des médecins
exerçant aux Cliniques Saint-Joseph, membres du Centre
Hospitalier Chrétien (CHC)
) Clinique Saint-Joseph
rue de Hesbaye 75, 4000 Liège
tél. 04.224.81.11 | fax 04.224.87.70
) Clinique de l'Espérance
rue Saint-Nicolas 447-449, 4420 Montegnée
tél. 04.224.91.11 | fax 04.224.90.02
) Clinique Notre-Dame
rue Sélys-Longchamps 47, 4300 Waremme
tél. 019.33.94.11 | fax 019.33.96.55
) Clinique Notre-Dame
rue Basse Hermalle 4, 4681 Hermalle /s Argenteau
tél. 04.374.70.00 | fax 04.374.70.02

Ce samedi 9 octobre,
les médecins des Cliniques
Saint-Joseph vous attendent au
Château du Val Saint Lambert (Seraing)
pour leur 16e journée médicale.
Au programme de l’après-midi,
3 ateliers qui seront répétés 3 fois.
Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous vite
(jusqu’au 1er octobre) !
Atelier 1
Laboratoire de biologie clinique
● Sérologie : cas pratiques (mononucléose, CMV,
hépatite B, …)
) Françoise Perwez, pharmacien-biologiste
● Bilan de coagulation
) Dr Laure Gilis, responsable de l’unité de thrombo-
hémostase clinique
● Implications fi nancières
) Françoise Perwez, pharmacien-biologiste
Atelier 2
Les pathologies de la colonne
● Examen clinique chez l’enfant et l’adolescent :
diagnostic des troubles statiques
) Dr Pascale Stainier, médecin de l’appareil locomo-
teur
● Conseils d’hygiène de vie de la colonne (port de
la mallette, du sac à dos, choix de la literie, des
activités physiques, …)
) Dr Geoffrey Brands, médecin de l’appareil locomo-
teur
● Répercussions statiques de la dégénérescence
vertébrale
) Dr Albert Debrun, médecin de l’appareil locomoteur,
chef de département
Après plus d’un an de travaux, une partie des locaux du
-1 de la clinique de l’Espérance accueille depuis peu le
service de rééducation pédiatrique, annexe de l’unité de
médecine de l’appareil locomoteur.
Les travaux ont permis de décloisonner les lieux. En
effet, l’équipe s’était étoffée, diversifi ée et spécialisée.
Tout était prêt pour favoriser les interactions entre soi-
gnants : kinésithérapeutes, logopèdes, ergothérapeute,
psychomotricienne, mais aussi assistante sociale et
psychologue.
Atelier 3
Les maladies infl ammatoires chroniques
de l’intestin (MICIs)
● Mise au point et suivi des MICIs
) Dr Fernand Fontaine, gastroentérologue
● Particularités pédiatriques de la prise en
charge des MICIs
) Dr Isabelle Paquot, pédiatre
● L’arsenal thérapeutique des MICIs
) Dr Arnaud Colard, gastroentérologue
Pour accueillir les enfants engagés dans des
soins de longue durée, plusieurs mois à plu-
sieurs années parfois, il était essentiel pour
l’ensemble de l’équipe d’offrir un lieu de vie
chaleureux, en regard de la rigueur thérapeu-
tique.
Le service, actuellement essentiellement dirigé
vers l’ambulatoire, souhaite s’ouvrir vers les
autres partenaires de la clinique, dont les servi-
ces d’hospitalisation pédiatrique.
Organisation pratique
et renseignements
Service communication du CHC
04.224.85.62
Cliniques Saint-Joseph
16e journée médicale
) Marianne Lebrun | service communication
Clinique de l’Espérance
La rééducation pédiatrique s’agrandit
) Pierre Demoitié | service communication
vie des cliniques
PROGRAMME
Journée Médicale
Organisée par la Commission de contact
des Cliniques Saint-Joseph
Samedi 9 octobre 2010
13h00
Adresse du jour
Château du Val Saint Lambert
Esplanade du Val à 4100 Seraing
En pratique
13h00 Accueil & inscriptions
13h30-14h30 Ateliers
14h45-15h45 Ateliers
15h45-16h30 Pause-café
16h30-17h30 Ateliers
17h30 Fin des ateliers
18h Apéritif et souper au Val
Saint Lambert, offerts par
la Commission de contact
Couleurs chatoyantes pour le module de psychomotricité, au
sein d’un vaste espace
2 | blueprint 96 | septembre 2010

Contact
Clinique Saint-Joseph
Service d’imagerie médicale
04.224.88.00
A la clinique Saint-Joseph, un
nouveau bloc de radiologie
interventionnelle multimodalité
sera opérationnel dès la fi n de ce
mois de septembre. Il prendra le
relais de la salle anciennement
située au sein du service
d’imagerie médicale. Seule la
clinique Saint-Joseph dispose
d’un outil aussi performant
et aussi pointu en Province
de Liège. Ce nouveau bloc
représente un investissement
de 1,5M°, dont deux tiers pour
l’équipement. Situé au 5e étage
de la clinique, il compte deux
salles.
Le futur des disciplines chirurgicales est de développer
les activités à la fois vers des traitements agressifs
et vers des traitements de moins en moins invasifs.
L’orientation de la radiologie interventionnelle est d'être
de plus en plus précise sur le plan balistique et de plus
en plus agressive. Il y avait dès lors un point de rencontre
multidisciplinaire indispensable à développer qui est le
bloc de radiologie interventionnelle, afi n de proposer à
nos patients l'ensemble de la palette des traitements les
plus modernes.
De plus en plus, la radiologie interventionnelle apparaît
comme un moyen de traitement qui vient s’ajouter à
la palette classique des prises en charge médicale et
chirurgicale et s’inscrit dans un esprit de complémentarité
et de multidisciplinarité pour la prise en charge de
différentes pathologies. La démarche du radiologue
interventionnel s’inscrit soit dans les actes qui nécessitent
un ciblage précis (ex : les infi ltrations rachidiennes),
soit dans les actes réalisés en urgence (ex : boucher
une artère qui saigne) ou encore dans une optique de
traitement. Ces interventions peuvent être tantôt très
pointues (ex : embolisation d’anévrysme cérébral en
neurologie, chimio-embolisation en oncologie), tantôt
s’adresser à des maladies plus bénignes comme le
traitement des fi bromes utérins (technique moins connue,
mais très effi cace comme alternative à l’hystérectomie).
Le bloc devrait accueillir autant les cas lourds que les
cas ambulatoires actuellement réalisés dans le service.
Le bloc interventionnel de Saint-Joseph constitue un
concept novateur en ce qu’il allie les avantages de
différentes techniques d’imagerie (échographie, scanner,
angiographie) et un environnement stérile du même type
qu’un bloc opératoire. Outre de meilleures conditions
d’hygiène et une sécurité accrue pour le patient, ce bloc
va permettre une organisation des soins et une ergonomie
supérieures pour les médecins interventionnels. Son autre
atout, c’est sa proximité géographique du bloc opératoire
(notamment pour les anesthésistes) et des soins intensifs
(pour le suivi du patient). Enfi n, il permettra de libérer les
salles d’examen du service, désormais consacrées aux
actes diagnostiques. Il sera un point de rencontre avec
les collègues cardiologues et chirurgiens vasculaires.
Toute l’imagerie de ce bloc est digitale, d’où une parfaite
qualité d’image. L’usage de l’imagerie 3D offre une
défi nition et un guidage renforcés de l’acte médical,
notamment pour les embolisations en neurologie et
d’autres applications chez les patients d’oncologie. On
le voit, le travail multidisciplinaire est de mise, et devrait
intensifi er les collaborations avec la neurochirurgie
ou l’oncologie déjà citées, la chirurgie digestive, la
gastroentérologie, la gynécologie, l’urologie, à l’image
de ce qui est développé intensément depuis plusieurs
années avec la cardiologie et surtout la chirurgie
vasculaire.
Notons encore que ce nouveau développement de la
radiologie interventionnelle en neurologie s’inscrit dans
un partenariat du CHC avec l’hôpital Erasme et le CHR
de la Citadelle.
In fi ne, ce bloc interventionnel peut se résumer en trois
points : précision, sécurité, carrefour multidisciplinaire.
Clinique Saint-Joseph
Nouveau bloc d’angiographie-radiologie
interventionnelle
) Catherine Marissiaux | service communication
vie
des cliniques
des cliniques
L’équipe médicale de radiologie
interventionnelle
• Dr Jean-François Biquet
• Dr Denis Brisbois (neuro)
• Dr Olivier Cornet
• Dr Bénédicte Daenen (infi ltrations, patients externes)
• Dr Jean-François Goyers (oncologie, infi ltrations,
patients externes)
• Dr Georges Houben (infi ltrations, patients externes)
Sainte-Elisabeth
RMN bientôt opérationnelle
Juste à côté du futur hôpital de jour, dans le pro-
longement du service d’imagerie médicale, les
travaux vont bon train pour installer la RMN. Le
bâtiment est quasi fi nalisé. La cage de Faraday
a été montée début septembre et l’aimant doit
être livré fi n septembre. Les premiers essais
sont prévus début octobre. Le service devrait
ensuite pouvoir accueillir les patients pour les
RMN dans la foulée.
septembre 2010 | blueprint 96 | 3

Introduction
La mesure de la quantité de rayonnement délivrée au
patient lors des explorations radiologiques va devenir
une obligation légale. Les objectifs sont de maîtriser et
optimiser l’usage des rayonnements ionisants et, ainsi,
de protéger les personnes contre leurs dangers.
Les grandeurs utilisées en radioprotection sont : la dose
absorbée, la dose dans l’air, la dose d’entrée, la dose en
profondeur, la dose à l’organe et la dose effi cace. Cer-
taines grandeurs sont spécifi ques du radiodiagnostic :
le produit dose x surface, la dose glandulaire moyenne
(mammographie), l’index de dose scanographique et le
produit dose x longueur (voir fi gure ci-contre).
En tomodensitométrie, les indicateurs de dose sont
obligatoirement affi chés à la console du scanner pour
chaque examen.
Les obligations réglementaires à venir entraîneront la
mention, sur le compte-rendu radiologique, des infor-
mations concernant la dose délivrée au patient, pour les
pratiques les plus courantes ou exposant aux doses les
plus importantes. Ces obligations devraient avoir pour
effet une optimisation progressive de l’ensemble de la
pratique radiologique.
La directive EURATOM 97/43, relative à la protection
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonne-
ments ionisants lors d’expositions à des fi ns médicales,
a mis en place les fondements des nouvelles conditions
d’usage des rayonnements ionisants dans le domaine
médical. Cette directive a été publiée en 1997.
Grandeurs et unités
La dose absorbée dont l’unité est le Gray (Gy), qui équi-
vaut à un Joule (J)/kg.
La dose dans l’air permet de caractériser une installation
radiologique. Elle est mesurable à l’aide d’une chambre
d’ionisation.
La dose d’entrée est mesurée grâce à un dosimètre
placé sur la peau. Elle intègre le rayonnement diffusé,
qui représente 20 à 40% de la dose dans l’air.
La dose en profondeur est calculée à partir de la dose
d’entrée, en tenant compte de l’atténuation.
La dose à l’organe est la dose moyenne absorbée rap-
portée à l’ensemble du volume de l’organe considéré.
Elle permet le calcul de la dose effi cace. Ce calcul im-
pose de tenir compte de la nature du rayonnement et
du tissu considéré. Les tissus du corps humain sont
d’autant plus sensibles qu’ils sont moins différenciés et
que leur activité mitotique est plus grande.
La dose effi cace est un indicateur du risque de détriment
que fait courir l’exposition aux rayonnements ionisants.
Cette grandeur résulte d’un calcul et non d’une mesure
physique objective. Elle refl ète l’effet sur l’organisme en-
tier et est la seule qui permet une estimation cohérente
de la dose totale reçue par un patient en radiologie.
Grandeurs dosimétriques spécifi ques
du radiodiagnostic
Le produit dose x surface d’exposition (PDS) s’exprime
en Gy/cm2. On peut, par l’utilisation d’un cœffi cient de
conversion, Epds, dépendant de la zone explorée et de la
tension, estimer la dose effi cace à partir du PDS. Dose
effi cace = PDS x Epds.
La dose glandulaire moyenne (mammographie)
Les mammographies numériques calculent et affi chent
cette information, ainsi que la dose d’entrée, sur chaque
image.
L’index de dose scanographique (IDS) ou computed to-
mographic dose index (CTDI)
Les normes européennes et internationales défi nies par
la commission électrotechnique internationale (CEI) im-
posent aux constructeurs de faire apparaître cet index
sur la console opérateur pour toute série programmée.
Il faut bien comprendre que le CTDI est un index d’expo-
sition quantifi ant la dose délivrée en fonction des para-
mètres de la coupe, mais il ne refl ète pas la dose totale
reçue par le patient. Pour tenir compte de ce point fon-
damental, on a défi ni par analogie avec le produit dose
x surface, le produit dose x longueur (PDL) qui est un
meilleur indicateur de l’exposition du patient.
Le produit dose x longueur
PDL = CTDI x L. Le produit dose x longueur est égal
au CTDI volume multiplié par la longueur explorée. L’in-
térêt principal de cette grandeur est qu’elle représente
Contact
Clinique Saint-Joseph
Service d’imagerie médicale
04.224.88.00
Mesure de la dose de rayonnement
délivrée au patient en radiologie
Principes et dispositions réglementaires
) Dr Julien Djekic | imagerie médicale
le point sur…
le point
sur…
le point sur…le point
4 | blueprint 96 | septembre 2010

exactement l’exposition en affectant la dose au volume
exploré. Elle permet donc, en prenant en compte les or-
ganes fi gurant dans ce volume, de calculer ou d’estimer
la dose effi cace. Ce calcul se fait en utilisant des cœffi -
cients dépendant de la région explorée. Ces facteurs de
conversion permettent d’estimer simplement et rapide-
ment l’ordre de grandeur de dose effi cace pour chaque
examen, en multipliant le PDL par un cœffi cient Epdl de
la zone explorée. On peut ainsi très facilement estimer
l’ordre de grandeur de la dose reçue par le patient.
L’usage de la dose effi cace permettra d’harmoniser l’ex-
pression fi nale de la dose en radioprotection. On pourra
ainsi intégrer des doses partielles résultant d’exposi-
tions hétérogènes dans le temps et dans l’espace (par
exemple, une radiographie de bassin, puis un scanner
thoracique et un panoramique dentaire). Par ailleurs, la
conversion en dose effi cace montrera bien quels sont les
examens sur lesquels doit porter en priorité l’effort de
réduction de dose, notamment en scanner.
Les niveaux de référence diagnostique
La référence de valeur d’exposition, PDS ou PDL, per-
mettra de situer la pratique radiologique par rapport à
la pratique médiane nationale grâce à la confrontation
avec les niveaux de référence diagnostique. En radiolo-
gie conventionnelle, on utilise la dose à la surface d’en-
trée du patient et le produit dose x surface. En scanner,
les indicateurs dosimétriques sont l’indice de dose de
scanographie et le produit dose x longueur.
Ces niveaux de référence diagnostique constituent une
base de départ pour que chaque radiologue puisse com-
mencer à situer sa pratique.
Conclusion
De nouvelles dispositions législatives réglementaires vont
instituer une dosimétrie systématique des expositions
médicales. Ces dispositions constitueront un ensemble
cohérent qui permettra l’application des principes d’op-
timisation et d’ajustement des expositions médicales au
plus bas, tenant compte de l’obligation de résultat.
Bibliographie
● Y.-S. Cordoliani, Mesure de la dose délivrée au patient en
radiologie. Principes et dispositions réglementaires. EMC
(Elsevier Masson SAS, Paris), Radiodiagnostic - Principes et
techniques d’imagerie, 35-092-A-10, 2007.
● Y.-S. Cordoliani, H. Foehrenbach, Radioprotection en milieu
médical, Principes et mise en pratique, Elsevier Masson SAS,
2ème édition, 2008.
La 13e rencontre de stomatologie et chirur-
gie maxillo-faciale se déroulera le samedi 4
décembre à l’hôtel Ramada Plaza (quai Saint-
Léonard à Liège). La journée abordera les
thèmes suivants :
● le noma, gangrène foudroyante qui se dé-
veloppe dans la bouche et ronge les tissus
de la face
● la chirurgie piezographique (chirurgie ortho-
gnathique, reconstructrice, oncologique)
● l’orthodontie
● la responsabilité sans faute et l’explosion
des sinistres en orthodontie
Les médecins à l’initiative de cette journée
sont les Drs S. Dammous, P. Fryns, R. Gilles
et P. Ponchaut.
13e journée de
stomatologie et
chirurgie
maxillo-faciale
agenda
Information et inscriptions
PAF 140
clôture le 15 novembre
04.224.98.66 ou
Le programme est disponible sur
le site www.maxillo-liege.be
sur…
Grandeurs et unités
Grandeurs pouvant être mesurées
ou calculées
PDS
Dose dans l'air
Dose d'entrée Grandeurs ne pouvant
être que calculées
Dose à l'organe
(et dose efficace)
Dose en profondeur
septembre 2010 | blueprint 96 | 5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%