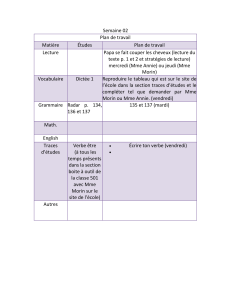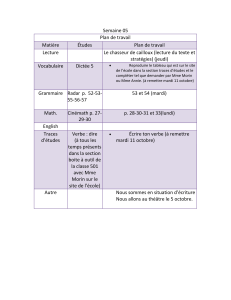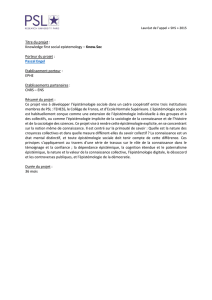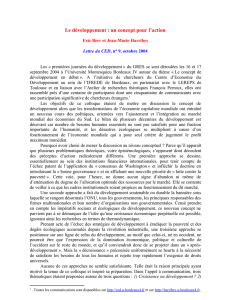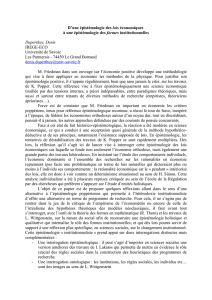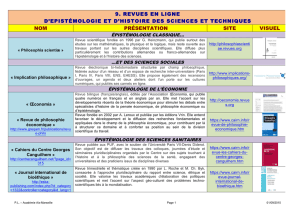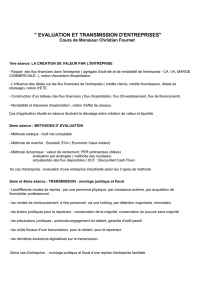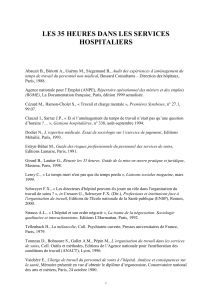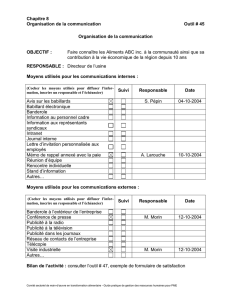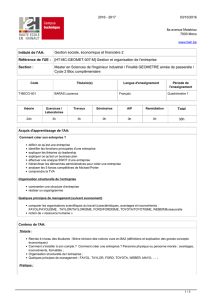Epistémologie et sciences de gestion

Colloque International francophone: Complexité 2010
1
D2.2 : Complexité de l’entreprise: une approche transdisciplinaire
Marie-Joëlle Browaeys ; professeur assistant, Nyenrode Business University
(Pays-Bas)
L’objet d’étude de prédilection des sciences de gestion reste l’entreprise. Une
entreprise dans laquelle phénomènes organisationnels, économiques et sociaux
s’entremêlent. Mais l’entreprise n’est plus ce qu’elle était. On voit apparaître de
nouvelles formes d’organisation - qui privilégient le micromanagement - et avec elles de
nouvelles formes de pensée. La pensée managériale actuelle s’éloigne de la pensée
classique et serait plutôt vue comme une métascience pénètrant dans les domaines qui
ne sont pas les siens. (Péron, 2002).
Cette remise en question du champ d’étude principal de la recherche
organisationnelle nous aménera à considérer les travaux d’Edgar Morin sur la pensée
complexe et l’entreprise. Ceci soulèvera aussi des questions se rapportant
principalement à la transdisciplinarité qui permet d’utiliser les démarches de la pensée,
les modèles et les concepts de différentes disciplines. Nous essayerons de montrer en
quoi il peut être intéressant de chercher dans d’autres disciplines les moyens de saisir la
complexité de l’entreprise, tout en sachant que « la complexité est un mot problème et
non un mot solution». Morin (1990, 2005, p.10)
Epistémologie et sciences de gestion
Tout d’abord, il semble ici opportun de faire une remarque concernant la
définition du terme ‘Epistémologie’. (Browaeys, 2004). Dans la tradition philosophique de
langue française, l’épistémologie se définit comme la théorie de la science en général.
On parle d’épistémologie des sciences physiques et chimiques, de la biologie ou encore
de la logique. Cette épistémologie de la logique se rapproche de la définition anglo-
saxonne de l’épistémologie puisqu’elle s’intéresse entre autres, aux différentes formes
de pensée vues au travers d’une théorie de la connaissance. Une théorie qui cherche à
comprendre les fondements de la connaissance, son développement, son objet, ses fins
et ses objectifs.
C’est surtout avec Bachelard que le terme ‘épistémologie’ émerge comme
philosophie des sciences : « Pour le philosophe, les méthodologies, si diverses, si
mobiles dans les différentes sciences, relèvent quand même d’une méthode initiale,
d’une méthode générale qui doit informer tout le savoir, qui doit traiter de la même

Colloque International francophone: Complexité 2010
2
manière tous les objets. » (Bachelard, 1971, p.121). Pour lui, les progrès de la pensée
scientifique contemporaine ont transformé les principes mêmes de la connaissance.
Connaître, selon le principe ontologique, c’est rechercher une façon de penser et non
plus vouloir décrire la vérité.
L’épistémologie complexe s’intègre dans cette démarche cognitive tout en
n’excluant pas les cadres de l’épistémologie classique, mais ce qui la distingue, c’est
que tout en maintenant la problématique de la vérité, elle envisage aussi une
connaissance qui se croit vraie, qui peut alors être aussi une illusion ou une erreur.
(Morin 1986, p.24).
Non seulement l’épistémologie, mais aussi le statut même des sciences de
gestion suscite de nombreux débats. Selon certains auteurs, elles n’emprunteraient
qu’aux autres sciences ou même ne seraient qu’un art pratique. Le travail des
chercheurs ne se réduirait qu’à l’observation méthodique de l’action des gestionnaires.
D’autres - comme ceux de la nouvelle sociologie des entreprises - soulignent que les
théoréticiens ne saisissent pas assez l’entreprise comme un espace multi-formes, qu’ils
ne se penchent que sur un objet spécifique de l’entreprise, tels que par exemple, la
question du pouvoir ou de la culture (Amblard & al., 1996, p.192).
Ces multiples modèles de lecture fragmentent l’objet d’étude au point de ne plus
rendre compte de sa cohérence globale. C’est pourquoi la recherche en entreprise doit
être abordée comme tout système complexe dans lequel l’interaction entre la totalité du
système et de ses éléments en particulier est essentiel. C’est-à-dire que l’entreprise
(l’organisation) et le personnel (les individus), doivent être appréhendés comme « deux
processus inséparables et interdépendants » (Morin, 2005, p.116).
Cette approche forme le cadre épistémologique des démarches de recherche qui
privilégient l’interaction sujet-objet dans la construction de la connaissance. Une
connaissance dont il faut être conscient de ce qui la mutile. Comme le principe
d’explication simple des phénomènes complexes de la science classique qui ne prend
pas en compte « l’aléa, notamment pour comprendre tout ce qui est évolutif » et « un
univers où se combinent hasard et nécessité. » (Morin, 1994, p, 318).
Cette réflexion touche à la notion de transdisplinarité qui est sous-jacente dans la
pensée complexe puisqu’elle utilise des procédures intellectuelles qui privilégient une
pensée plurielle. (Wunenburger, 1990)

Colloque International francophone: Complexité 2010
3
Notion de transdisciplinarité
Tout d’abord il faut définir les approches autour de la ‘transdisciplinarité’. Dans
l’approche interdisciplinaire (qui sous-entend la réciprocité), les situations et les thèmes
sont vus au travers de l’interaction de plusieurs disciplines alors que l’approche
pluridisciplinaire permet d’étudier les mêmes thèmes ou situations selon les points de
vue spécifiques des différentes disciplines. L’approche transdisciplinaire va plus loin
puisque les démarches de la pensée et les mêmes concepts sont utilisés dans
différentes disciplines.
Cette notion de transdisciplinarité est repris dans une note de lecture de J-L Le
Moigne (2005) sur le livre de Legay & Schmid (2004). Ce livre - une correspondance sur
la recherche scientifique, la modélisation et les objets complexes - permet de relativiser
et de re-poser la question : Pourquoi certaines sciences s’approprieraient-elles certaines
notions ? Comme la complexité par exemple, une notion qui n’est ni l’apanage des
siences mathématiques ou de la nature. C’est ce que montre Prygogine (1998)
concernant la révision du concept de temps en physique faite grâce aux systèmes
dynamiques instables. Cette révision lui a permis de se détacher de la science classique
– qui privilégiait la prévisibilité du futur, l’ordre et la stabilité - en utilisant la notion de
chaos, une notion devenue si populaire qu’elle est utilisée dans tous les domaines de la
science.
Prygogine (2000) va plus loin quand il voit dans les lois en mathématiques,
physique et chimie une source possible d’inspiration pour les sciences humaines,
spécialement pour les économistes et sociologues qui sont en présence de problèmes
complexes. C’est le cas des sciences de l’organisation qui serait vues par certains
chercheurs non plus comme un champ ayant sa propre structure, mais plutôt comme
une science qui s’approprie les disciplines tout en essayant de les synchroniser dans le
cadre de l’entreprise. (Péron, 2002)
On pourrait alors ici s’interroger sur le possible du transfert des concepts et des
principes d’une science à une autre et de leur applicabilité dans un autre domaine que
celui d’origine. Se demander, par exemple, si un concept relevant des sciences
physiques ou de la biologie pourrait être applicable aux sciences de l’organisation.
Applicabilité des concepts et principes d’une science à l’autre

Colloque International francophone: Complexité 2010
4
Il semble au premier abord intéressant de considérer la notion d’entropie. Il est
communément admis que l’entropie est la mesure du désordre dans un système. Plus le
désordre est grand plus l’entropie augmente. Or, en physique, s’il est admis qu’il y a
toujours une tendance vers le désordre, la fonction de l’entropie comme mesure du
désordre reste difficile à utiliser alors qu’elle est assez bien définie en termes de chaleur
et de température par la deuxième loi de la thermodynamique. Il est par exemple
problématique pour les physiciens de « mesurer le degré d’ordre dans l’eau » pendant la
congélation, « où l’apparition de structures cristallines s’accompagne en permanence
d’une libération d’énergie » (Gleick 1989, p.385-386).
En s’appropriant ce concept, la biologie, l'économie, et même la sociologie l’ont
modifié et lui ont donné le sens général de tendance à la désorganisation ou à la
déstructuration. (Petit lexique Complexité MCX-APC).
Ceci ne pose pas seulement la question du transfert d’un concept d’une science
à d’autres mais aussi des principes appartenant à un système. Pour reprendre le
deuxième principe de la thermodynamique cité plus haut, sans échanges, le système ne
peut évoluer que vers la mort ou tout au moins décliner. Les structures se paralysent ou
se fixent. Ce type de systèmes hypercomplexes se rencontrent aussi dans les systèmes
du vivant et humain. (Donadieu et Karsky, 2002)
Cet exemple nous amène à la biologie, un système qui se rapproche le plus des
systèmes humains. Il semble en effet plus adéquate d’essayer d’appliquer les concepts
de la biologie aux sciences de l’organisation plutôt que ceux de la physique. Kauffman
(in Benkirane, 2002) réunit déjà ces systèmes puisqu’il trouve que la pensée biologique
prend une place de plus en plus importante dans le management des organisations. Il
essaie d’appliquer les concepts venus des sciences de la complexité dans les
entreprises qui cherchent la résolution de problèmes pratiques du monde des affaires.
Systèmes biologiques et humains
En biologie, les systèmes sont particulièrement complexes. Il n’est pas inutile de
rappeler ici les travaux de Darwin sur le rôle de la sélection naturelle dans l’évolution
puisqu’on peut retrouver un processus similaire dans les sociétés humaines. L’évolution
se fait par des changements (mutations génétiques) qui arrivent au hasard et se
combinent avec une sélection naturelle. Les organismes les mieux adaptés à un certain
milieu survivent et peuvent procréer. Ces changements donnent ainsi graduellement une

Colloque International francophone: Complexité 2010
5
modification des propriétés des organismes d’une espèce et à la longue naissance à de
nouvelles espèces.
Dans la nature, chaque espèce a sa place, une niche écologique où elle peut
exister en équilibre avec son environnement. Nous voyons un système bien organisé qui
est capable de s'adapter aux changements environnementaux. Il se comporte comme
un système ayant une stratégie précise et un objectif bien défini. Cependant il n’en est
rien. Il faut savoir que l’évolution se passe par des changements aléatoires spontanés et
se fait sans aucun objectif. Que les espèces changent, s’adaptent et meurent, c’est le
fruit du hasard.
On retrouve le même système dans le monde de l’entreprise en tout au cas
quand on regarde au niveau macro-économique. On voit arriver et partir des entreprises.
Seules les entreprises qui se sont adaptées aux marchés se développent et survivent.
Les autres meurent. Il se forme alors une nouvelle situation où l’ensemble des
entreprises ont leur place dans le système économique sans que cela ait été planifié.
La différence se situe au niveau micro-économique, puisque contrairement à la sélection
naturelle du système évolutionnaire où les changements sont dirigés par le hasard, ici
chaque entreprise doit diriger son évolution. Les dirigeants ne peuvent pas se permettre
de laisser tout changement sujet au hasard. Ils doivent choisir une stratégie.
Un deuxième exemple de la biologie se retrouve dans le système immunitaire.
Ce système produit des anticorps pour se battre contre des micro-organismes
pathogènes. Comment le corps peut-il faire des anticorps spécifiques pour chaque
micro-organisme, alors qu’il y a des millions de structures différentes possibles, qui
peuvent changer dans le temps et sont alors inconnus? La réponse, c’est que cette
production d'anticorps par le système immunitaire est aussi basée sur la génération
aléatoire et la sélection naturelle et fonctionne ainsi de façon tout à fait semblable au
système évolutionnaire. Le corps produit au quotidien des milliards de leucocytes dont
chacun porte un anticorps différent avec une spécificité aléatoirement construite et
seulement les leucocytes qui rencontrent un micro-organisme avec lequel ils peuvent
s’accorder resteront en vie, les autres – la plupart – mourront. Ainsi, le système
immunitaire se comporte comme un système qui a une réponse bien définie: il fait
exactement le bon anticorps et seulement quand c'est nécessaire. Tout se passe
comme s’il y avait une gestion centrale. Cependant il n’en est rien. Le système s’auto-
organise, évolue et combine hasard et nécessité.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%