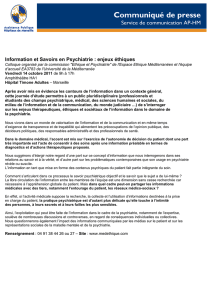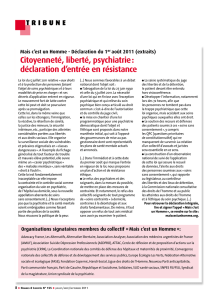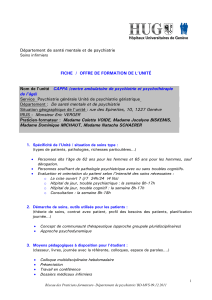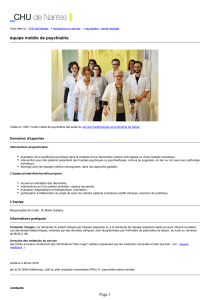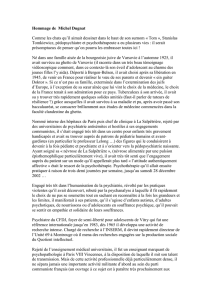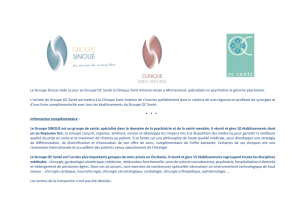Familles et Psychiatrie : Hier et Aujourd`hui

Familles et Psychiatrie : Hier et Aujourd’hui
Dr Patrick BANTMAN, Chef de service 94 G 16
L’évolution de la pratique psychiatrique dans la communauté et la dés- institutionnalisation font
que de plus en plus de patients passent de plus en plus de temps hors de l’hôpital Psychiatrique ,
c’est-à-dire souvent dans leurs familles.
Bien des choses ont évolué dans les relations avec les familles depuis quelques années à travers
des rencontres fructueuses avec des associations de familles, et, l’évolution de positions moins
dogmatiques, qui avaient fortement compromis toute alliance thérapeutique avec les familles .
Un consensus semble s’installer actuellement sur le fait qu’à la prise en charge du patient dans la
communauté doit s’associer le soutien de sa famille, une attention vis-à-vis de ses besoins et de
ses souffrances et une coopération à ses problèmes quotidiens afin de l’aider à assumer les crises
. En témoignent les conférences de consensus en France (1994)(2003) , en Belgique (1998 et
2001)
En France, la conférence de consensus sur les « Stratégies thérapeutiques à long terme dans les
psychoses schizophréniques (1994) », évoque les approches familiales parmi les stratégies
thérapeutiques non médicamenteuses, dans le chapitre traitant des approches psychothérapiques.
On insiste sur l’information aux familles, et la place des psychothérapies familiales dans une
optique de partenariat1.
En psychiatrie, domaine particulièrement sensible aux contradictions sociales, c’est depuis une
trentaine d’années que l’on s’intéresse à la famille. Cette préoccupation n’a pas pour autant été
absente dès l’origine de la Santé Mentale.
Les psychiatres s’intéressaient à la famille dans plusieurs aspect : d’abord pour y étudier la cause
des maladies mentales, l’entourage des malades, dépister d’autres patients, et pour permettre la
réinsertion du malade. L’évolution du soin psychiatrique et médico-psychologique a renouvelé
cette insistance.
Je rappellerai succinctement l’histoire de ces relations pour situer l’évolution mais montrer aussi
l’origine historique de certains préjugés
I – Le rôle des familles dans l’institution psychiatrique naissante. L’impact de la loi de 1838
et la création de l’Asile
Dans son ouvrage sur « Familles, Parenté, Maison, Sexualité dans l’ancienne société », J. L
Flandrin (3) montre « qu’à y regarder de près la distinction du privé et du public, fondamentales
dans nos sociétés libérales, est peu pertinente pour l’analyse des sociétés monarchiques.
L’institution familiale y avait des caractères d’institution publique et les relations de parenté
servaient de modèle aux relations sociales et politiques ». Dans le domaine de la folie, la famille
disposait de toute latitude et de toute liberté à l’égard de ses malades et pouvait demander un
ordre du roi (« placet ») pour solliciter l’enfermement de l’insensé. Selon R. Castel (4), le pouvoir
royal n’était qu’un relais et un régulateur dans l’exercice du pouvoir correctionnaire des familles.
Les familles disposaient également de la procédure d’interdiction afin d’obtenir la séquestration de
l’insensé.
1 Je rappellerai ici la conclusion de la conférence de consensus sur le prise en charge au long cours de la
schizophrénie en France (1994) pour « offrir au patient et à sa famille une information la plus complète et la
plus objective possible afin de développer autour du patient un véritable partenariat thérapeutique ».

II – Quelques éléments historiques sur la place tenue par la famille dans la psychiatrie
A partir du moment où se constitue l’asile, même si certains médecins repèrent déjà des indices de
l’influence que l’entourage peut exercer sur le patient, il ne s’occupe que du malade et du malade
seul. L’internement ne se justifie pas de motifs uniquement d’ordre public et de protection sociale,
il est également « thérapeutique ». Le premier pouvoir qu’il y ait lieu de s’assurer sur le patient
« nerveux », c’est celui que confère la rupture avec le séjour coutumier et avec les relations
familières.
L’opinion de Pinel (6) reflète celle des autres aliénistes : « il est si doux en général pour un malade
d’être au sein de sa famille et d’y recevoir les soins et la consolation d’une amitié tendre et
compatissante, que j’énonce avec peine une vérité triste mais constatée par l’expérience la plus
répétée, la nécessité absolue de confier les aliénés à des mains étrangères et de les isoler de
leurs parents ».
Ainsi Charcot : « Oui, il faut séparer les enfants des adultes, de leur père et mère, dont l’influence,
l’expérience le démontre, est particulièrement pernicieuse ».
La possibilité d’une intervention en direction des familles se trouve stérilisée dans son principe par
l’internement qui rompt le lien familial, ce que regrette Ulysse TRELAT, l’aliéniste le plus sensible
aux rapports aliénation-famille, dans le « Folie Lucide » en 1861.
En 1871, Falret et Laseque publient un des premiers travaux faisant référence au rôle de
« l’interaction » entre des personnes vivant ensemble dans la genèse des troubles psychiatriques
dans « La folie à Deux ». Legrand du Saulle dans son ouvrage sur « le Délire de Persécution »,
met bien en évidence l’électivité presque exclusivement familiale des cas de délire à deux.
Depuis les premiers aliénistes, nombreux sont les psychiatres et les psychanalystes qui se sont
intéressés à l’influence de la famille dans la maladie mentale.
En Allemagne, E. BLEULER et ses élèves ont observé les interactions familiales et émis
l’hypothèse de leur rôle signifiant dans l’étiologie de la schizophrénie. E. KRETSCHMER a étudié
l’entourage des patients atteints de paranoïa sensitive.
Pour S. FREUD : « dans le traitement psychanalytique, la présence des parents est tout
simplement un danger, et un danger auquel on ne sait pas parer (…). En ce qui concerne la famille
du patient, il est impossible de lui faire entendre raison et de la décider à se tenir à l’écart de toute
l’affaire. D’autre part, on ne doit jamais pratiquer une entente avec elle, car on court alors le
danger de perdre la confiance du malade (…). Celui qui sait quelles discordes déchirent souvent
une famille ne sera pas étonné de constater, en pratiquant la psychanalyse, que les proches du
malade sont souvent plus intéressés à le voir rester tel qu’il est qu’à le voir guérir » (8).
Il est pourtant habituel de rappeler que l’analyse du « petit Hans » représentait, dès 1909, la
première approche familiale d’un cas de névrose infantile. Dans la forme pure de la psychanalyse
telle que l’a codifié FREUD, la famille du patient, et plus particulièrement la famille nucléaire,
n’apparaît pas dans sa réalité concrète. Mais, par contre, la famille est le lieu de conflits dont le
paradigme est le conflit oedipien. Il n’est donc pas nécessaire, ni même souhaitable, de demander
à la famille une participation active au traitement.
En 1936, R. LAFORGUE communique à la 9ème conférence des psychanalystes de langue
française, ses travaux sur la « Névrose Familiale », terme employé pour désigner le fait que
« dans une famille donnée, les névroses individuelles se complètent, se conditionnent
réciproquement et pour mettre en évidence l’influence pathogène que peut exercer sur les enfants
la structure familiale, principalement celle du couple parental ».
Pour J. LACAN, « la simple clinique montre, dans beaucoup de cas, la corrélation d’une anomalie
de la situation familiale ». Dans son très important article sur « la famille et les complexes
familiaux », paru en 1938, il montre l’importance des facteurs familiaux dans le déclenchement des
psychoses et leur rôle dans les névroses. Il note la fréquence de la transmission de la paranoïa en

ligne familiale directe. Dans la névrose, les « complexes familiaux » y remplissent une fonction
causale dont la réalité et le dynamisme s’opposent diamétralement au rôle que jouent les thèmes
familiaux dans les psychoses. « Les formes de névrose sont intimement dépendantes des
conditions familiales ». Cependant, comme dit Lacan, « il est impossible de rapporter chaque
entité à quelques anomalies constantes des instances familiales ».
Toujours dans le courant psychanalytique qui semble avoir accordé plus de poids aux facteurs
familiaux, outre les travaux d’Anna Freud et des analystes d’enfants, il convient de faire une place
aux travaux de H. S Sullivan sur la recherche socio-psychiatrique, qui ont inspiré, en partie, les
origines du courant de la psychothérapie institutionnelle. Pour H. S Sullivan, « isoler une
personnalité d’un complexe de relations interpersonnelles impliquant sur un mode très chargé de
sens, d’autres personnes extérieures au sujet, c’est passer absurdement à côté de la question »
(49). Pour Sullivan, « la psychiatrie doit s’occuper de l’existence détraquée de personnes-sujets de
l’intérieur même de leurs complexes interpersonnels » (10). Les publications de Sullivan
représentent les premières tentatives pour formuler la psychiatrie en terme de relations
interpersonnelles.
Depuis 1940, la prise en compte de la famille dans le champ de la maladie mentale se fait de
façon dispersée, chaque auteur étant plus sensible à tel ou tel aspect des relations. Ainsi apparaît
un certain nombre de notions qui vont connaître des fortunes variées et qui, pour plusieurs sont
encore très actuelles.
1 – La mère pathogène et la carence des soins maternels
Des 1943, dès Levy fait un rapprochement entre les troubles du comportement chez un enfant et
la surprotection de la mère. Les frustrations affectives qu’elle a subies dans son enfance l’amène à
protéger son propre enfant à l’excès. C’est le point de départ des travaux sur la mère
schizophrénogène décrite comme dominatrice, agressive, peu sûre d’elle et rejetante. A l’inverse,
le père est alors repéré comme passif, indifférent et inadéquat. Ces études devaient par la suite
être critiquées. Les premières expériences relationnelles de l’enfant jouent un rôle essentiel dans
son développement. C’est dans la perspective de recherches que de nombreuses études sur la
carence des soins maternels ont été entreprises pendant et après la dernière guerre. Burlingham
et A. Freud observent les enfants placés loin de leurs parents à la pouponnière de HAMPSTEAD
pendant les bombardements de Londres.
R. Spitz décrivit l’hospitalisme et appela dépression anaclitique l’état d’hébètement stuporeux qui
s’installe chez l’enfant privé de soins maternels. Depuis ces travaux, la prise en considération des
conséquences proches ou lointaines qu’entraîne la séparation d’un jeune enfant de sa mère est
devenue l’une des notions de base en psychiatrie infantile.
2 – Le concept de lien symbiotique se référant plus particulièrement à la relation
pathogène mère-enfant émergea dans les années 1950. M. MALHER, en décrivant le concept de
relation symbiotique indifférenciée (1952), fut parmi ceux qui contribuèrent à porter une attention
plus grande au mode de relations pathogènes à l’intérieur des familles, plutôt qu’à la mise en
évidence d’une série de traits isolés de différents membres de la famille.
3 – Le père pathogène
Le personnage de la mère n’est pas le seul étudié par les psychanalystes. La position du père
dans la relation est celle du tiers exclu par la dyade mère-enfant ; c’est la notion sur laquelle Lacan
a particulièrement insisté (forclusion du nom du père). De nombreux auteurs ont tracé des
tableaux évocateurs qui démontrent le rôle pathogène de la carence d’autorité, et plus
particulièrement de celle assurée par le père. Après ses études des mères psychotiques, T. Lidz
étend ses observations aux pères. Il tente de préciser le rôle de ses derniers dans la genèse de la
psychose de l’enfant. Il aboutit alors à une classification des pères en cinq types selon leur
soumission plus ou moins grande à leur femme et suivant leur alliance avec leurs enfants ou leur
hostilité envers eux (11).

Le problème des interactions parents-enfants psychotiques, tel qu’il a été abordé par ces travaux
de recherche, l’a été de façon parfois trop schématique et la psychose a pu être considérée
comme le contre coup d’une attitude pathogène de la mère (le plus souvent étudiée) ou du père.
Ces travaux ont cependant l’avantage d’avoir élargi le regard psychanalytique vers la situation
concrète de l’enfant dans son milieu.
Nous aurions pu citer bien d’autres auteurs comme FROMM-REICHMANN, BION, ROSENFELD,
A. GREEN, DEMANGEAT, ROSEN, FEDERN, SEARLES, BOWLBY, WINNICOT.
Ainsi, après le primat attaché à la relation individuelle et aux vertus de l’isolement avec la mise en
place de la psychiatrie, on assiste, à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, a un intérêt
de plus en plus important concernant l’entourage du patient, conduisant parfois à un traitement
parallèle mais séparé du patient et de sa mère ou son père. En renouvelant ainsi l’abord du
psychotique par la prise en considération de tout se qui se passe autour de lui, c’est tout le champ
de la psychiatrie qui se métamorphose par la prise en considération de la famille et de
l’environnement social. La troisième phase prolonge la précédente et conduit à la mise en place du
développement de la Psychiatrie de secteur et de l’intervention dans la communauté .La famille
devient un partenaire même si cela ne se fait pas uniformément dans tous les secteurs de
Psychiatrie .
III . Du côté de la Psychiatrie des adultes…
Il reste beaucoup à faire pour développer une réelle collaboration avec les familles des patients .
Pour les familles , il y trois domaines sensibles :
1 - Celui de l’intervention et de la mobilité des équipes de secteur , trop
souvent frileuses pour intervenir vis à vis d’un patient décompensé et dont la famille
épuisée sollicite parfois en vain trop souvent encore les équipes de Psychiatrie de secteur
pour des interventions à domicile …
2 - Le problème de l’hospitalisation psychiatrique vient compliquer cette
approche de la famille en termes d’alliance thérapeutique en faisant intervenir la loi ainsi
que la contrainte. Dans un cadre comme celui de la loi de 90 en France, où les relations
sont souvent instituées par le biais d’un tiers qui sollicite l’hospitalisation, la relation
familiale est souvent vécue comme compliquant auprès du patient le recueil du
consentement ainsi que sa collaboration. Il n’est pas rare de voir ainsi se mettre en place
des relations symétriques entre la famille et l’institution hospitalière, régies par l’utilisation
de la loi de 90.
La famille exprime souvent le sentiment que les hospitalisations sont trop courtes et redoutent le
retour à domicile de leur malade.Ils sont encore trop souvent insuffisamment informées pendant
l’hospitalisation et tenu à l’écart des projets …
3 - Celui de l’hébergement thérapeutique et de la Réhabilitation psycho-
sociale dont les moyens sont en France trop insuffisant , et pour lesquelles la famille reste
encore trop souvent la seule véritable alternative à l’hospitalisation .Dans ce domaine les
associations familiales comme l’UNAFAM développe des projets innovants en collaboration
avec plusieurs partenaires dont les équipes de secteur
Les difficultés relationnelles mentionnées peuvent être dans de très nombreux cas atténués par
la rencontre avec la famille.
Face à la crise, il est important de prendre en compte et de respecter la famille dans son
fonctionnement, et de revoir avec elle les différentes solutions déjà envisagées antérieurement.
Les projets élaborés avec les patients auront d’autant plus de chance de se concrétiser que la
famille y aura participé ou en aura été informée. Par exemple, des retours en milieu familial
insuffisamment préparé réintroduisent rapidement le conflit entre le patient et sa famille

Les familles doivent êtres informés des projets des patients afin de ne pas se sentir exclues du
prise en charge Il nous semble qu’en l’absence d’un soutien parental, il existe peu de chance pour
qu’un projet d’autonomisation réussisse. La séparation, si elle intervient, doit se produire sans
rupture.
Ce travail d’alliance que nous préconisons a pour visée la prise en compte à la fois de la
dimension du sujet, de celle de sa famille et de son environnement social. Les conférences de
consensus recommandent à juste titre, l’élargissement du concept de famille à toutes les
personnes concernées par le patient dans le cadre de la prise en charge au long cours.
Afin que puisse s’établir une collaboration avec elle, il importe de modifier la définition de la
relation que l’on instaure avec la famille et avec le patient. Cela n’est pas seulement l’affaire d’une
technique mais d’une véritable clinique de la relation, en souhaitant réellement l’aide de la famille
pour soigner son patient.
Il ne s’agit pas là d’importer un modèle, de passer du patient désigné par la famille à la famille
désignée comme patient, ce qui révèlerait d’une approche comportementaliste déguisée, mais de
donner à la famille la place qui lui revient dans la prise en charge du patient, tout en conservant
notre spécificité comme professionnel de la santé mentale.
2, en Hollande (1996) , les guides de bonnes conduites ailleurs
2 Cet article a été rédigé à la suite d’un rapport lors de la deuxième conférence belge de consensus
sur le traitement de la schizophrénie (« Trois ans après »). Ligue belge de schizophrénie -
Kortenberg -29 novembre 2001
1
/
5
100%