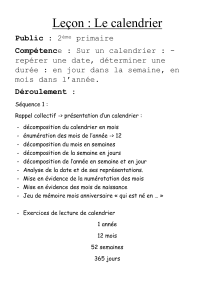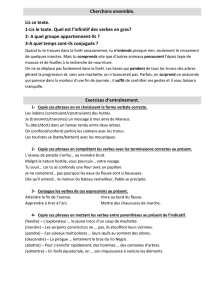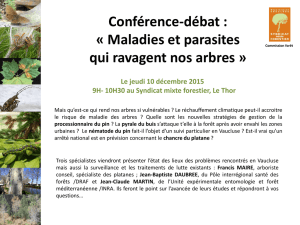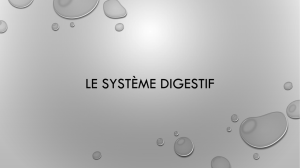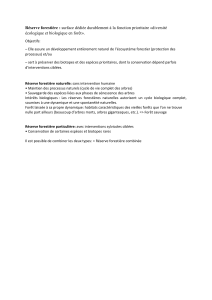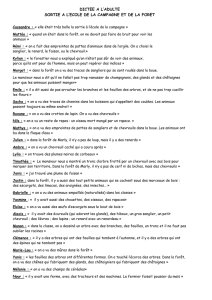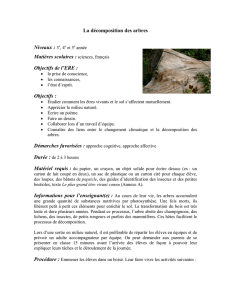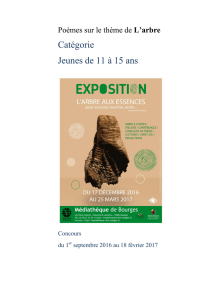Le bois mort dans l`écosystème forestier : une nécessité fonctionnelle

1
Le bois mort dans l‘écosystème forestier : une nécessité fonctionnelle
Le terme de bois mort concerne toutes les parties de l’arbre : les branches et les racines, l’écorce, ainsi
que les parties mortes des arbres encore vivants. La nécromasse la plus importante est évidemment
celle stockée dans les troncs, qui peut représenter dans certaines forêts tempérées des valeurs de
l’ordre de plusieurs centaines de tonnes à l’hectare. Ces quantités considérables de bois mort sont des
réservoirs de matière organique, qui ne seront restitués à l’écosystème que graduellement, sauf
événements tels que le feu. La transformation de la matière organique en matière minérale est en
effet très graduelle, et ce d’autant que le climat est froid, le sol acide et les espèces résistantes
chimiquement. Le stockage à long terme évite le lessivage par fortes pluies, contrairement à la
fertilisation artificielle, contribuant à augmenter la résilience de la forêt après de fortes perturbations,
lorsque beaucoup de bois mort est à terre.
Le bois mort accumule aussi, entre nombreux éléments, azote et carbone, grâce à une activité
bactérienne durant la décomposition. 215 tonnes de bois mort accumulés dans un hectare de forêt
contiennent près de 300 kg d’azote. L’arbre mort accumule aussi de grandes quantités d’eau, lors des
épisodes de pluie et lors du processus de décomposition des tissus. Cette capacité varie bien entendu
avec l’espèce et le climat (la capacité est plus grande en climat humide), mais tous les troncs finissent
par être gorgés d’eau. Ces troncs peuvent donc être considérés comme des réservoirs d’eau et un
modérateur du microclimat forestier. Ces propriétés sont particulièrement importantes dans les sols
rocheux les sols peu profonds ou les milieux arides.
Le bois mort est essentiellement composé de cellulose (40-60%), hémicellulose (25-35%), lignine (21-
30%). Il s’y adjoint des composés secondaires tels que résine, cire, tanins, alcaloïdes. Ces
caractéristiques physiques et chimiques des bois varient cependant avec l’espèce (densité du bois,
métabolites secondaires de résistance aux pathogènes, résistance à la friction), et elles déterminent
ainsi le destin de l’arbre : de son vivant, sa vulnérabilité aux attaques pathogènes ou au climat, sa
résistance à l’invasion. Ces mêmes propriétés déterminent aussi quelles espèces vont l’envahir et
quel sera le temps de sa décomposition. En forêt tempérée, la décomposition totale d’un arbre,
qu’elle intervienne à la suite d’une mort rapide ou durant un long processus de sénescence, s’étend
sur des dizaines d’années, voire des siècles.
Les arbres sénescents servent de refuge et d’abri pour la reproduction à un très grand nombre
d’espèces, qui disparaissent lorsque les forêts sont artificialisées. Les plus typiques sont pour les
cavicoles primaires et secondaires, les chauves-souris. Les souches d’arbres morts servent de
reproduction au loup, de nourriture à l’ours s’il trouve des nids d’hyménoptères.
Les qualités fonctionnelles des bois sénescents et morts expliquent les pertes de biodiversité
considérables quand elles ne sont pas prises en considération dans la gestion forestière.
Annik Schnitzler
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements continentaux (LIEC). UMR 7360 CNRS
Université de Lorraine
1
/
1
100%