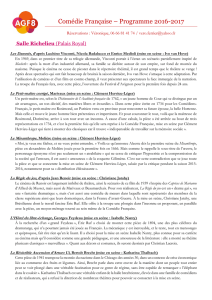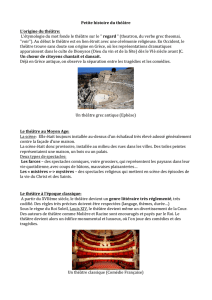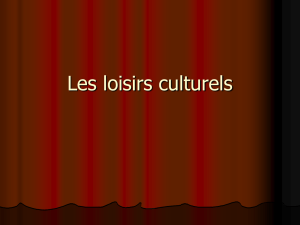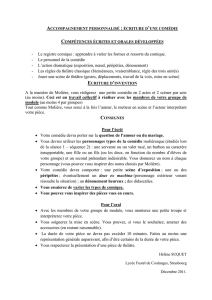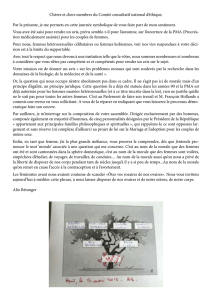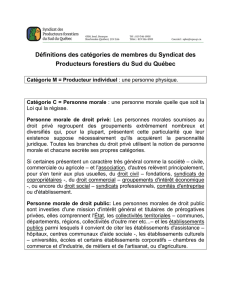Introduction (Fichier pdf, 482 Ko)

INTRODUCTION
Philippe Néricault Destouches (1680-1754), dont la biographie a été large-
ment retracée 1 , auteur d’une vingtaine de comédies 2 , a connu un véritable succès
à partir des années 1730, notamment grâce à sa comédie du Philosophe marié.
On s’accorde généralement à le considérer comme le fondateur de la « comé-
die moralisante 3 » ou encore « moralisatrice 4 », bien accueillie dans un siècle où
l’intérêt pour les questions d’ordre morales ne cesse de grandir :
1. Voir notamment J. HANKISS, Philippe Néricault Destouches, l’homme et l’œuvre, Paris Debreczen,
1918, rééd. Slatkine, Genève-Paris, 1981. Dans son Tombeau de Monsieur Néricault Destouches de
l’Académie Française. Élégie., Tanevot résume les principes qui rent le succès de l’homme de théâtre,
qu’il compare à Molière : « Ton art, et plus correct, et plus dèle aux mœurs,/Sut en les respectant
corriger nos erreurs,/Aux préjugés des Grands attacher ta censure,/Et faire à leur orgueil une vive
blessure,/Tandis que la vertu charmant tous les esprits/Brille sous ton pinceau du plus beau coloris,/
Et que tu fais régner dans un plan sympathique,/Et la haute morale et la force comique. » Paris, Prault
Père, 1754, p. 6. Gresset, dans son « Portrait de M. Destouches » insiste également sur le lien entre
ses comédies et la morale : « Philosophe, sans en être témoin citoyen, accoutumé à ne voir la gloire
réelle des talents, que dans l’utilité dont ils peuvent être à la société, il tourna toutes ses vues vers ce
but respectable, et montra, que la comédie, quand elle est instructive, et noble, bien loin d’être enve-
loppée dans la proscription autrefois prononcée contre le crime et la bassesse de la force antique, doit
être regardée comme l’École de la Raison et des mœurs. École plus utile par le pouvoir de l’agrément,
que ne le sont tant de Traités de Morale, qu’on lit sans goût, ou qu’on ne lit pas. » Journal helvétique
ou recueil de pièces fugitives de littérature choisie. Dédié au Roi, Neuchâtel, octobre 1754, p. 399-400.
2. « Avec vingt-sept pièces représentées, dont dix-neuf montées à la Comédie Française et un total
de 2050 représentations entre 1710 et 1860, Destouches, jusqu’au milieu du XIXe siècle, vient
au quatrième rang des auteurs du XVIIIe siècle les plus joués à la Comédie Française, juste après
Voltaire (4000 représentations), Regnard et Dancourt. » J.-Cl. POLET, Patrimoine littéraire euro-
péen : anthologie en langue française, sous la direction de J.-Cl. POLET, vol. 9, 1997, p. 218.
3. F. RUBELLIN, dans sa Présentation des Philosophes amoureux fait remarquer à ce sujet que
« L’expression “comédies moralisantes” que la plupart des manuels d’histoire littéraire emploient
pour désigner l’œuvre de Destouches peut conduire à ne pas prendre en compte son comique. »
Montpellier, Éditions Espaces 34, 2001, p. 15.
4. Tel est le titre de l’ouvrage de A. HOFFMANNLIPONSKA, Philippe Néricault Destouches et la comédie
moralisatrice, Poznan, 1979. Sa mise au point sur les études consacrées à la biographie de l’homme
[« Destouches », Karine Benac-Giroux]
[ISBN 978-2-7535-1473-7 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

8 DESTOUCHES
Le public du XVIIIe se passionnait également pour les problèmes moraux. S’il est
un point qui t l’unanimité des dramaturges, c’est la défense de la vertu ; que l’on
se tourne vers la tragédie, la comédie de caractères ou de mœurs, a fortiori le drame,
partout il est question d’elle sous toutes ses formes : vertu-chasteté, vertu-héroïsme,
vertu-sacrice…, et de plus en plus, quand on avance dans le siècle, vertu civique.
[…] les thèmes du bon père et de la bonne mère se révèlent inépuisables ; Marivaux,
Destouches, Nivelle de La Chaussée, Voltaire lui-même, avec L’Enfant prodigue,
ouvrent la voie au Père de Famille de Diderot 5 […].
Cependant, de son côté, Gabriel Conesa souligne les limites d’un tel théâtre :
Quant à la comédie moralisante, elle constitue une réaction morale souvent gauche,
sur le plan esthétique, au relâchement des mœurs qui aecte la société, car elle
prêche naïvement la vertu, ignorant que le théâtre perd toute portée dès qu’il se
transforme en tribune. Des œuvres comme Le Médisant (1715) de Destouches, qui
illustre bien cette intention de faire du théâtre avec de bons sentiments, ne seront
jamais reprises au théâtre 6 .
Certes, bon nombre de comédies de Destouches ne connaissent pas le succès,
et certaines ne sont pas représentées. Pourtant, d’autres connaissent aussi un véri-
table triomphe, comme le souligne Françoise Rubellin dans sa Présentation des
Philosophes amoureux, preuve que malgré sa méance vis-à-vis de l’esprit et de
l’imagination 7 , Destouches était parvenu à échafauder des intrigues pleines de vie
de théâtre et sur les sources de ses pièces demeure d’ailleurs essentielle. L’auteur place son analyse
sous le sceau de la morale en ces termes : « La morale était le souci constant de l’auteur, et l’inten-
tion de moraliser caractérise toute son œuvre. » p. 7. Elle rattache ce souci constant à l’évolution
des mœurs : « La littérature classique se voulait morale, c’est-à-dire qu’elle donnait une morale très
générale, universelle et abstraite. La littérature du XVIIIe siècle prétend être moralisatrice, ce qui
n’est pas la même chose. Elle adapte ses leçons au public qui les écoute, surtout à la bourgeoisie qui
forme de plus en plus la masse des lecteurs. La meilleure manière d’améliorer les hommes et de leur
faire aimer la vertu, c’est de la leur montrer dans des situations qui se répètent tous les jours. C’est
ainsi qu’on félicite Destouches et La Chaussée d’avoir inspiré aux hommes le goût d’une morale
bienfaisante. » p. 12-13. Aleksandra Homann-Liponska s’appuie d’ailleurs sur les textes mêmes
de Destouches pour en prouver la visée morale, notamment sur « l’épître qui précède L’Obstacle
imprévu, dédiée au Régent », où « Destouches n’hésite à comparer la tâche de l’auteur comique
à celle du Prince régnant », p. 23, mais également sur ses Préfaces, celle bien entendu du Curieux
Impertinent, mais également celle du Glorieux ou de La Force du Naturel, “[…] lorsqu’il avoue que
la Comédie peut corrompre les mœurs quand sa gaieté dégénère en licence, ce qui ne lui est arrivé
que trop souvent” », p. 24.
5. J. TRUCHET, Introduction au éâtre du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », XL.
6. La comédie de l’âge classique 1630-1715, Paris, Le Seuil, 1995, p. 227.
7. Voir A. HOFFMANNLIPONSKA, Philippe Néricault Destouches et la comédie moralisatrice, op.
cit., p. 28 : « Destouches ne cesse de mettre en garde les écrivains contre l’écueil de l’imagination.
[« Destouches », Karine Benac-Giroux]
[ISBN 978-2-7535-1473-7 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION 9
et de verve, à l’action susamment bien construite et aux dialogues assez alertes
pour enlever l’adhésion du public 8 .
Ajoutons que l’aspect moral de ses comédies, censé être croissant à mesure
que son œuvre s’arme 9 , est de plus en plus remis en question par la critique au
fur et à mesure que le temps passe. Il est sûr que dans les débuts de Destouches, la
portée morale n’est pas armée. Jean Hankiss souligne que dans l’Épître dédica-
toire à L’Obstacle Imprévu, « la comédie édiante n’apparaît encore qu’en germe et
comme accessoirement » ; en s’appuyant sur les commentaires du Nouveau Mercure
du 6 octobre 1717, il commente également de la sorte cette comédie : « Quelques
dards décochés contre le mariage à la mode et la corruptibilité des juges, voilà
toutes les « leçons » dont l’auteur moraliste peut se réclamer 10. » Déjà au début
du siècle précédent, dans son Discours sur la comédie et la morale, Claude-Bernard
Petitot distinguait entre « moralité » et « morale » pour en venir à une critique
directe de la prétendue « morale » du théâtre des grands auteurs du XVIIIe siècle :
[…] le théâtre n’est pas une école de morale, il ne doit jamais la blesser dans ses résul-
tats importants […] Ainsi c’est une règle générale, que le vice et le crime ne sortent
point triomphants : de l’observation de cette règle, il résulte que chaque pièce, dans
Il leur conseille, par contre, d’aimer la nature, d’observer la vie réelle, d’étudier les anciens et les
“illustres modernes” et de tâcher de mettre de la simplicité et des mœurs chrétiennes dans leurs
pièces de théâtre. » p. 28.
8. Ainsi La Fausse Agnès, « qui ne fera son entrée au répertoire de la Comédie-Française qu’en 1759,
repose sur un rythme débridé et un comique loufoque qui tranche avec la réputation de sérieux
que l’on a longtemps faite à son auteur. À elle seule, cette pièce aujourd’hui méconnue aura
475 représentations : ce sera le plus grand succès de Destouches ». Patrimoine littéraire européen :
anthologie en langue française, op. cit. p. 218.
9. Sophie Marchand met l’accent sur les revendications morales de Destouches, parfois contredites
par son œuvre : « La revendication morale qui se fait entendre chez les partisans de la comédie
nouvelle n’est pas tout à fait neuve. Le castigat ridendo mores classique subordonnait déjà le
recours au rire à une visée édiante et Destouches n’est pas loin parfois de se recommander de ce
principe, comme le prouve le prologue du Curieux Impertinent. Loin de mettre en cause le rire,
il entend simplement lui rendre décence et honnêteté et, si le projet moral occupe le premier
plan, il ne menace nullement la légèreté du propos. Il est vrai, toutefois, que le défaut que cette
comédie a pour charge de stigmatiser est véniel et que la cible du poète est l’originalité, plus que
le vice. Destouches n’en réarme pas moins dans la plupart des textes liminaires de ses pièces
son attachement à la morale, écrivant notamment dans l’avertissement de L’Homme Singulier : “Je
me atte qu’on y trouvera […] ce comique élevé et cette morale mâle et vive qui ont fait recevoir
mes autres pièces avec tant d’indulgence.” La moralité du genre rejaillit sur le poète, dont l’ethos
participe alors de la captation opérée par le spectacle, permettant d’œuvrer à la réhabilitation
du théâtre. » éâtre et pathétique au XVIIIe siècle : pour une esthétique de l’eet dramatique, Paris,
Champion, 2009.
10. Philippe Néricault Destouches, l’homme et l’œuvre, op. cit. p. 108.
[« Destouches », Karine Benac-Giroux]
[ISBN 978-2-7535-1473-7 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

10 DESTOUCHES
son ensemble, ore une moralité consolante ; et c’est cette moralité que nos penseurs
modernes ont prise pour de la morale […] et toutes les pièces de théâtre renferment
des moralités, parce qu’elles sont composées d’actions et de récits ; mais il ne s’ensuit
pas qu’elles soient, ni même qu’elles doivent être morales pour plaire au public et
aux amis des lettres 11.
Prenant divers exemples à l’appui dont celui de Destouches, il expose par
conséquent assez cyniquement que l’on ne saurait revendiquer purement et simple-
ment un fondement moral aux œuvres de Destouches 12 :
Si nous examinons les pièces de Destouches, qui commence les comiques moralistes,
c’est-à-dire ceux qui ne sont pas gais, nous trouverons, dans Le Philosophe marié, une
honte du lien conjugal qui est contraire aux bonnes mœurs ; dans Le Glorieux, un
homme insolent qui n’est pas puni, parce que l’acteur qui créa le rôle ne voulut point
être humilié ; ce qui ne t aucun tort au succès de l’ouvrage ; dans Le Dissipateur, un
fou sauvé par une friponne sensible ; ce qui ne peut tirer à conséquence, car elle est
à coup sûr la seule de son espèce ; du reste, des parents traités sans respect et même
sans politesse. Le Tambour nocturne est une farce imitée de l’anglais, théâtre assez
généralement brouillé avec la morale : Destouches a présenté le sujet d’une manière
décente, et dont on peut tirer pour moralité qu’il ne faut pas épouser la femme d’un
homme qui vit encore, parce qu’il peut revenir. L’Homme Singulier est un fou qui
débite gravement les maximes les plus dangereuses : il mériterait d’être enfermé aux
petites maisons ; et l’auteur a cru le corriger susamment en lui faisant promettre
qu’il changerait d’habit, qu’il passerait l’hiver à Paris et l’été à la campagne 13.
Cette première considération, à savoir que la morale n’est peut-être pas le
meilleur moyen d’aborder l’œuvre de Destouches sera à prendre en compte dans
notre approche d’une œuvre plus inattendue qu’il y paraît d’abord. Très récem-
11. Répertoire du théâtre français, Tome vingt-septième, Paris, Foucault libraire, 1819, p. 548-549.
12. Il fait aussi remarquer qu’«il n’y a de morale vraie que celle qui est obligatoire ; et certainement
personne ne soutiendra qu’on soit obligé par devoir de conscience de régler sa conduite sur les
maximes qui se débitent au théâtre : si cela était, nos comédies les plus goûtées, les plus gaies
et les mieux faites devraient être interdites, et nous serions réduits à des drames moraux fort
ennuyeux, qui ne feraient point honneur à notre littérature, seraient peu suivis, et encore moins
lus », ibid., p. 546.
13. Ibid., p. 552-553. Autant de critiques qui font écho à celles qu’aronta le théâtre durant tout
le XVIIe siècle : « En donnant une forme sensible à l’amour, à l’ambition ou à l’amour-propre,
le dramaturge inuence les cœurs et les comportements : il rend une réalité possible, par l’eet
subversif de la parole et des images. Comme La Rochefoucauld l’écrit à propos de l’amour,
l’homme poursuit toujours les chimères dont il a la prescience intime. » M. BOURGEOIS,
O. GUERRIER, L. VANOFLEN, Littérature et morale XVIeXVIIIe siècle, de l’humaniste au philo-
sophe, Paris, Armand Colin, 2001, p. 100. Cependant, Claude Petitot va plus loin en suggérant
que le vice n’est même pas châtié au nal et que la vertu ne l’emporte par conséquent ni dans
l’intrigue, ni dans le dénouement.
[« Destouches », Karine Benac-Giroux]
[ISBN 978-2-7535-1473-7 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]

INTRODUCTION 11
ment, dans une conférence proposée à Paris en novembre 2009, John Dunkley
concluait lui-même que
La critique a pris la préface du Glorieux trop à la lettre, que (me semble-t-il)
Destouches est appauvri par cette perspective limitée, qu’il est beaucoup plus expé-
rimental que cela ne laisse croire, et qu’il y a illogisme critique à prendre cette préface
pour la vérité pure et à persister à croire en revanche que Godard d’Aucour ne fait
que mentir de gaieté de cœur 14.
Par ailleurs, quoique représentatif de la comédie morale et annonciateur du
drame bourgeois 15, Destouches paraît tout de même avoir tissé des liens avec ses
contemporains les plus célèbres, y compris Marivaux 16.
Michel Gilot et Jean Seroy soulignent ainsi la double face des comédies de
Destouches. D’un côté l’héritage de Molière et Regnard 17 ; de l’autre la prégura-
tion de Marivaux, voire de Diderot :
Le Curieux Impertinent ouvre une voie beaucoup plus originale, car on y entre
dans un nouvel univers, celui que Marivaux explorera dans les décennies suivantes.
L’intrigue dépend tout entière de ressorts psychologiques ; elle est constituée par
un jeu serré, très sérieux entre six personnages […] L’intérêt de la pièce tient dans
14. Et John Dunkley de souligner que « les premières comédies ne font pas ce qu’il dit dans cette
préface », qu’il « ne moralise pas du tout » avec L’Irrésolu ; enn, écrit-il, « Quant au Philosophe
marié, il n’y a aucune moralisation, et il reste au spectateur d’en tirer des conclusions générales
– s’il y en a, à part le conseil de ne pas cacher son mariage pour plusieurs raisons évidentes, ce
qui n’aecte à la vérité qu’un nombre de personnes assez restreint. Il me semble que tout cela
est bien peu en fait pour fonder une esthétique d’ordre moral. »
15. « Ainsi, sans beaucoup s’éloigner du cadre et du langage de la comédie moliéresque, Destouches
s’inscrit avec ces pièces dans la modernité des Lumières : l’alliance de la morale et d’une liberté
fondée sur les sentiments naturel annonce le drame bourgeois tel qu’il sera mis en place par
Diderot dans Le Fils naturel. » Patrimoine littéraire européen : anthologie en langue française, op.
cit. p. 218.
16. Hankiss voit même une inuence inversée dans le Médisant : « Beaucoup de Molière, un épisode
à l’espagnole, un autre à la Marivaux et cela avant la lettre, un Frontin eronté qui ressemble à
Crispin rival de son maître, voilà assez d’emprunts à la fois. Mais l’ensemble porte l’empreinte
de Destouches qui a trouvé des accents tout nouveaux pour peindre un homme au lieu de faire
une caricature. » Philippe Néricault Destouches, l’homme et l’œuvre, op. cit., p. 96.
17. Ils mettent tout d’abord en évidence ce que doit Destouches à Regnard et Molière : « Quand
on évoque Destouches, on est d’abord tenté d’armer qu’il a voulu restaurer l’art de Molière
en étudiant des caractères et donner à la comédie une forte portée morale. […] Or, une pièce
comme L’Irrésolu (1713) témoigne surtout d’une profonde inuence de Regnard. […] L’Ingrat
(1712) est une comédie beaucoup plus sérieuse, profondément inuencée par Le Tartue, car il
y est question d’un “ingrat [qui] doit savoir l’art de se contrefaire”. » La comédie à l’âge classique,
Paris, Belin, 1997, p. 224-225.
[« Destouches », Karine Benac-Giroux]
[ISBN 978-2-7535-1473-7 Presses universitaires de Rennes, 2011, www.pur-editions.fr]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%