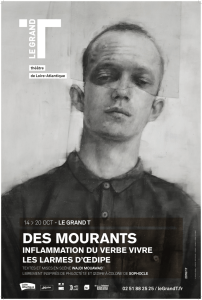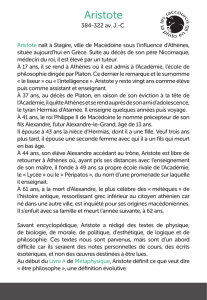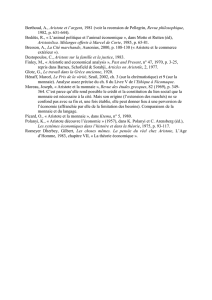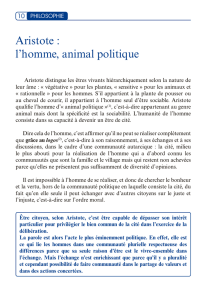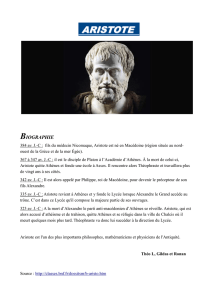Frontières et objets de la scène de reconnaissance - IRCL

© 2013 ARRÊT SUR SCÈNE / SCENE FOCUS (IRCL-UMR5186 du CNRS).
ISSN 2268-977X. Tous droits réservés. Reproduction soumise à autorisation.
Téléchargement et impression autorisés à usage personnel. www.ircl.cnrs.fr
!!
!
!
!
!
"#$%&'(#)*!)&!$+,)&*!-)!./!*0(%)!-)!#)0$%%/'**/%0)1!!
-23#'*&$&)!4!5/0'%)!
!
67%7-'0&)!89:;3<=>989?3@!
AB5C8=:>5DEFG!-H!CI5J1!:%'K)#*'&7!L/H.=;/.7#M!N!>$%&O)..')#!PQ!
!
!
R!./!S'%!-H!Malade&imaginaire1!<$'%)&&)!O#$O$*)!4!3#T/%!-)!U!0$%&#)S/'#)!.)!V$#&!W!O$H#1!.H'!
-'&=)..)1! -$%%)#! .2$00/*'$%! 4! 67.'%)! -)! V/%'S)*&)#! &$H&)! ./! &)%-#)**)! XH2)..)! /! O$H#! *$%!
7O$HY! )&! V$%&#)#! 4! 67#/.-)! XH2'.! /! &$#&! -)! -$H&)#! -2H%)! &)..)! /SS)0&'$%Z!82/SS/'#)!&$H#%)!
/H&#)V)%&1! 0$VV)! $%! */'&1! )&! .)! *&#/&/T(V)1! /HXH).! 3#T/%! *)! O#[&)! 4! -)HY! #)O#'*)*1!
O)#V)&!)%!#7/.'&7!/H!O#$&/T$%'*&)!.H'=V[V)!-)!U!0$%%/\&]#)^!.)*!*)%&'V)%&*!XH)!&$H&)!]*/^!
S/V'..)!/!O$H#!].H'^E!WZ!_2/+$#-!0)HY!-)!67.'%)!AU!8)!C').!)%!*$'&!.$H7!`!>)!K$'.4!-7.'K#7)!-2H%!
T#/%-! S/#-)/HZ!WQ1! OH'*! 0)HY! -23%T7.'XH)! AU!a! C').!`! XH)..)! '%S$#&H%)!`! XH)..)! /&&)'%&)!
0#H)..)b!`!WQ!c!4!XH$'!3#T/%!#7O$%-!#)*O)0&'K)V)%&!d!U!e)!*H'*!+')%!/'*)!-)!K$'#!K$&#)!/V'&'71!
)&!-2/K$'#!)%&)%-H!.)!+)/H!O/%7TM#'XH)!XH)!K$H*!/K)f!S/'&!-)!V$'!W!)&!U!;/1!&H!)*!V$%!K#/'!
*/%T1! V/! K7#'&/+.)! S'..)!c! )&! ,)! *H'*! #/K'! -2/K$'#! KH! &$%! +$%! %/&H#).g!WZ! 5M&hV7)! O/#! .)*!
)%)*!*H00)**'K)*!-)*!O)#*$%%/T)*!A67.'%)1!OH'*!3%T7.'XH)!)&!)%S'%!C.7/%&)Q1!O/#!./!*$#&')!
O#70'O'&7)! -)! 67.'%)!4!./!*0(%)!Eg!)&!O/#!.)*!V$HK)V)%&*!/.&)#%7*!-23#T/%1!XH'!S)'%&!.)!
V$#&! OH'*! *)! .(K)! /K/%&! -)! #)0$VV)%0)#1! ./! *7XH)%0)! -)! *0(%)*! /! &$H&)*! .)*!
0/#/0&7#'*&'XH)*! -2H%)! #)0$%%/'**/%0)Z! C/#/0&7#'*&'XH)*! *&M.'*&'XH)*! -2/+$#-1! /K)0! ./!
O#7*)%0)! -2H%! .)Y'XH)! )&! -)! V$-/.'&7*! 7%$%0'/&'K)*! *O70'S'XH)*!d! )Y0./V/&'$%*! )&!
'%K$0/&'$%*!/H!0').!)%!0/*0/-)1!.)Y'XH)!-H!0iH#1!/.&)#%/%0)!-)!Oh#/*)*!'%&)##$T/&'K)*!)&!-)!
Oh#/*)*! )Y0./V/&'K)*! XH'! '%-'XH)%&! H%! *$VV)&! -)! O/&h7&'XH)Z! >/'*! 0/#/0&7#'*&'XH)*!
-#/V/&H#T'XH)*! *H#&$H&1! OH'*XH)! .2)%*)V+.)! -)! ./! *7XH)%0)! O/#/\&! '..H*&#)#! ./! -7S'%'&'$%!
T7%7#/.)!-)!./!#)0$%%/'**/%0)!XH23#'*&$&)!)%!-$%%)!/H!0h/O'&#)!EE!-)!./!Poétique&d!
8/!#)0$%%/'**/%0)1!0$VV)!.)!%$V!V[V)!.2'%-'XH)1!)*&!.)!#)%K)#*)V)%&!XH'!S/'&!O/**)#!-)!
.2'T%$#/%0)! 4! ./! 0$%%/'**/%0)1! #7K7./%&! /..'/%0)! ]philia^! $H! h$*&'.'&7! ]ekhtra^! )%&#)! 0)HY! XH'!
*$%&!-7*'T%7*!O$H#!.)!+$%h)H#!$H!.)!V/.h)H#PZ!
j%!O)#V)&&/%&!4!3#T/%!-)!U!0$%%/\&#)k!W!.)*!*)%&'V)%&*!-)!*/!S/V'..)1!./!S/H**)!V$#&!$O(#)!
.)! #)%K)#*)V)%&! XH2/&&)%-)%&! %$&/VV)%&! <$'%)&&)! )&! 67#/.-)1! #)%K)#*)V)%&! XH'! S/'&!
E! >$.'(#)1! Le& Malade& imaginaire1! BBB1! EE!A&)Y&)! -)! EGFgQ!c! -/%*! Œuvres& complètes1! 7-Z! -'#'T7)! O/#! l)$#T)*!
"$#)*&')#!)&!C./H-)!6$H#XH'1!L/#'*1!l/..'V/#-1!6'+.'$&h(XH)!-)!./!L.7'/-)1!gmEm1!&Z!g1!OZ!nPnZ
g!Le&Malade&imaginaire…1!BBB1!Eg1!EP!)&!Ek1!OZ!nPo=nkmZ
P!3#'*&$&)1!Poétique1!7-Z!)&!&#/-Z!5$*).M%)!_HO$%&=5$0!)&!e)/%!8/..$&1!L/#'*1!J)H'.1!EoFm1!OZ!nEZ

!
La scène de reconnaissance/Recognition Scenes
ARRÊT SUR SCÈNE/SCENE FOCUS 2 (2013)!
!
!
pgFq
O/**)#! 3#T/%! -)! .2/K)HT.)V)%&! 4! ./! .H0'-'&7! 4! O#$O$*! -)! */! *)0$%-)! 7O$H*)1! -$%&! .)*!
'%&)%&'$%*!K7#'&/+.)*!*$%&!V'*)*!/H!,$H#!O/#!.)!O#$07-7Z!8/!#)0$%%/'**/%0)!%2/T'&!-2/'..)H#*!
XH)! *H#! 0)&&)! O/#&')=.4! -)! ./! O'(0)! )&! -H! 0/#/0&(#)! -)! *$%! O#$&/T$%'*&)1!OH'*XH)!3#T/%!
-)V)H#)!,H*XH24!./!S'%!H%!U!V/./-)!'V/T'%/'#)!W1!02)*&=4=-'#)!H%!h$VV)!O/#S/'&)V)%&!*/'%!
-)!0$#O*!XH'!*)!0#$'&!V/./-)Z!j..)!#7K(.)!U!h$*&'.'&7!W!OH'*!U!/..'/%0)!W1!-7O./0)!.)*!.'T%)*!4!
.2'%&7#')H#!-H!0)#0.)!S/V'.'/.1!)&!0$%-H'&!3#T/%!4!#)**)##)#!.)*!.')%*!/K)0!*/!S'..)!/\%7)!)&!4!
/00)O&)#! 0)! XH2'.! /K/'&! #)SH*7! ,H*XH24! O#7*)%&1! 4! */K$'#! XH23%T7.'XH)! 7O$H*)! .2h$VV)!
XH2)..)!*2)*&!0h$'*'b!4!0$%-'&'$%!XH2'.!*)!S/**)!V7-)0'%Z!
J'!.2$%!/!+')%!/SS/'#)!4!H%)!*7XH)%0)!-)!#)0$%%/'**/%0)1!'.!)*&!0)#&/'%!XH)!0)..)=0'!%2/!
O/*!O$H#!$+,)&!.2'-)%&'&7!-2H%!$H!-)!O.H*')H#*!O)#*$%%/T)*1!-H!V$'%*!*'!.2$%!*2)%!&')%&!4!H%)!
-7S'%'&'$%!7&#$'&)!-)!./!%$&'$%!-2U!'-)%&'&7!WZ!8)!*O)0&/&)H#!%2M!/OO#)%-!O/*!XH)!67.'%)!)*&!
./!S'..)!0/0h7)!-)!67#/.-)!)&!C.7/%&)!.)!S#(#)!-23%T7.'XH)!c!)&!*'!.2$%!K)H&!+')%!.H'!-$%%)#!.)!
%$V!-)!*0(%)!-)!#)0$%%/'**/%0)1!'.!S/H&!0$%K)%'#!XH)!%$&#)!*7XH)%0)!*)!-'SS7#)%0')!/**)f!
%)&&)V)%&!-)*!0/*!-2Œdipe&roi1!-2Iphigénie&en&Tauride!$H1!O$H#!7K$XH)#!XH).XH)*!)Y)VO.)*!
O.H*!V$-)#%)*1!-H!Timocrate&-)!<h$V/*!C$#%)'..)1!V/'*!/H**'!-)*!-7%$H)V)%&*!-)!L’École&
des&femmes&$H!-)*!Fourberies&de&ScapinDZ!
j&!.2$%!)%!K')%&!/'%*'!4!./!XH)*&'$%!/%%$%07)!O/#!.)!&'&#)!-)!0)&&)!7&H-)!d!.)*!S#$%&'(#)*!
)&1! O$H#! 0$VV)%0)#1! .)*! $+,)&*! -)! ./! *0(%)! -)! #)0$%%/'**/%0)Z! L/#! U!$+,)&*!W1! %$H*!
)%&)%-#$%*! T7%7#/.)V)%&! 0)! XH'! )*&! O$#&7! 4! ./! 0$%%/'**/%0)! $H! 4! ./! #)=
0$%%/'**/%0)b!.)XH).!O)H&
B. LOUVAT MOLOZAY, Objets et frontières de la scène de reconnaissance, d’Aristote à Racine
pgoq
*$HK)%&!/0XH'*1!4! ./!.)0&H#)!-)!./!Poétique1&XH)!U!./!#)0$%%/'**/%0)!])*&^!#)0$%%/'**/%0)!
)%&#)! O)#*$%%/T)*F!W1! 0)! XH)! 0$%S'#V)%&! ./! XH/*'=&$&/.'&7! -)*! )Y)VO.)*! V$+'.'*7*! O/#!
3#'*&$&)1! 0)&&)! /SS'#V/&'$%! $HK#)! %)&&)V)%&! .)! 0h/VO! -)*! U!$+,)&*!W! O$**'+.)*! -)! ./!
#)0$%%/'**/%0)1!O/#V'!.)*XH).*!0)!XH)!.)*!0$VV)%&/&)H#*!%$VV)#$%&!#)0$%%/'**/%0)!-)*!
S/'&*!AO$H#!./!-'*&'%TH)#!-)*!O)#*$%%)*Q!$H!#)0$%%/'**/%0)!-2'%%$0)%0)!$H!-)!0H.O/+'.'&7Z!
5)*&)!4!*/K$'#!XH)..)!O./0)!$00HO)!0)&&)!0/&7T$#')!0h)f!3#'*&$&)!)&!0h)f!*)*!&#/-H0&)H#*!)&!
0$VV)%&/&)H#*!V$-)#%)*1!)&!0)!XH2)..)!#)0$HK#)!O#70'*7V)%&Z!!
_/%*!.)! 0h/O'&#)!XH2'.! 0$%*/0#)1!-/%*! Recognitions1!/HY!0$VV)%&/&)H#*!'&/.')%*! -)!./!
5)%/'**/%0)1!<)#)%0)!C/K)!V$%&#)! XH)1! )%! -7O'&! -)! XH).XH)*! -'K)#T)%0)*1! 0)*! -)#%')#*!
*2)%&)%-)%&!O$H#!0$%*'-7#)#!XH)!*'1!)%!&h7$#')1!./!#)0$%%/'**/%0)!O)H&!O$#&)#!*H#!-)*!S/'&*!
A/'%*'!-2/'..)H#*!XH)!*H#!-)*!'%/%'V7*1!.')HY!$H!$+,)&*Q1!./!#)0$%%/'**/%0)!/H&h)%&'XH)V)%&!
&#/T'XH)1! K$'#)! /H&h)%&'XH)V)%&! -#/V/&'XH)! $H! .'&&7#/'#)! )*&! ./! #)0$%%/'**/%0)! -)!
O)#*$%%)*oZ!8/!#)0$%%/'**/%0)!-)*!S/'&*!/OO/#&')%&!O$H#!*/!O/#&!/H!-$V/'%)!-)!./!,H*&'0)!)&!
-)! .27.$XH)%0)! ,H-'0'/'#)1! $z! '.! *2/T'&! -)! O#$HK)#! .2'%%$0)%0)! $H! ./! 0H.O/+'.'&7! -)!
O)#*$%%)*EmZ!C)!.')H!0$VVH%!)&1!/H=-).41! .2'-7)! XH)! ./! #)0$%%/'**/%0)! -)! 0H.O/+'.'&7!
0$%*&'&H)! H%! &MO)! *)0$%-/'#)1! K$'#)! -7T#/-71! -)! #)0$%%/'**/%0)1! *$%&! O/#S/'&)V)%&! )%!
O./0)! XH).XH)*! -70)%%')*! O.H*! &/#-1! 0$VV)! .2/&&)*&)%&! .)*! &#/'&7*! -H! </**)! OH'*! -)!
{)'%*'H*Z!_/%*!*$%!Discours&du&poème&héroïque&AEDokQ1!.)!</**)!#/OO)..)!XH)!!
8/! #)0$%%/'**/%0)! -)*! S/'&*! )*&! O.H&|&! /OO#$O#'7)! /HY! $#/&)H#*! XH2/HY! O$(&)*1! /HYXH).*!
0$%K')%&!&$H&!O/#&'0H.'(#)V)%&!./!#)0$%%/'**/%0)!-)*!O)#*$%%)*1!02)*&=4=-'#)!.)!S/'&!-)!O/**)#!
-)!.2'T%$#/%0)!/H!*/K$'#EEZ!
J'!.2$%!0$%%/\&!/**H#7V)%&!)%!"#/%0)!.)*!0$VV)%&/&)H#*!'&/.')%*!-)!./!5)%/'**/%0)!)&!.)!
</**)1! $%! 0$%%/\&! )%0$#)! V')HY1! 4! O/#&'#! -H! V'.')H! -)*! /%%7)*! EGPm1! .)! &#/'&7! De&
constitutione&tragœdiae&-H!h$../%-/'*!{)'%*'H*EgZ!J$%!/H&)H#!M!0$%*/0#)!H%!0h/O'&#)!)%&')#!
*2/&&/0h)! '%-'SS7#)VV)%&! /HY! h$VV)*1! /HY! /%'V/HY1! )&! /HY! 0h$*)*! '%/%'V7)*!W1! '.! *)V+.)! *)! .'K#)#! 4! H%!
7./#T'**)V)%&! -)! 0)! XH'1! -/%*! ./! #)0$%%/'**/%0)1! O)H&! [&#)! #)0$%%HZ! C)&! 7./#T'**)V)%&! %2)*&! &$H&)S$'*!
XH2/OO/#)%&1! 0$VV)! .2'%-'XH)! ./! *H'&)! -H! O/**/T)1! $z! 8/! >)*%/#-'(#)! O#)%-! .2)Y)VO.)! -2:.M**)! XH'1! -/%*!
.2Odyssée1!)*&!#)0$%%H!4!./!S$'*!O/#!-)*![&#)*!hHV/'%*!A*$%!S'.*!)&!*/!%$H##'0)Q!)&!O/#!H%!0h')%1!)&!XH'!U!O$HK/'&!
.2[&#)!/H&#)V)%&!c!0$VV)!O/#!*$%!70#'&H#)1!O/#!-)*!+/TH)*1!O/#!-)*!T/T)*1!)&!O/#!H%!%$V+#)!-2/H&#)*!*'T%)*1!
O/#!$z!.2$%!O)H&!-70$HK#'#!./!0$%-'&'$%!-)!XH).XH2H%!h$#*!V[V)!-)!*/!O#7*)%0)!W!A8/!>)*%/#-'(#)1!La&Poétique1!
L/#'*1!3Z!-)!J$VV/K'..)1!EGPo!c!l)%(K)1!J./&}'%)!5)O#'%&*1!Eong1!OZ!GmQZ
F!3#'*&$&)1!Poétique1!0h/OZ!EE1!&#/-Z!5Z!_HO$%&=5$0!)&!eZ!8/..$&1!7-Z!0'&Z1!OZ!nE!c!>Z!>/T%')%!&#/-H'&!U!]b^!XH/%-!./!
#)0$%%/'**/%0)!)*&!H%)!#)0$%%/'**/%0)!-)!O)#*$%%)*!]b^!W!A7-Z!0'&Z1!OZ!EgmQZ
o!5$+$#&)..$1!.)!O#)V')#!0$VV)%&/&)H#!'&/.')%!N!*)*!U!)YO.'0/&'$%*!0$VVH%)*!W!O/#/'**)%&!)%!EDkF!N!O#$O$*)!
&$H&)S$'*! H%)! &MO$.$T')! V$-)#%)! XH'! S/'&! O./0)! 4! H%! V$-(.)! XH)! %2)YO.'0'&)! ,/V/'*! 3#'*&$&)! V/'*! XH)! ./!
Poétique&#)%-!O$**'+.)Z!5/OO$#&/%&!.)!0/*!-2~-'O)!4!0).H'!-)!./!#)0$%%/'**/%0)!-)*!O)#*$%%)*!XH/%-!.)!S/'&!)*&!
0$%%H! V/'*! XH)! .)*! /T)%&*! 'T%$#)%&! .)H#! '-)%&'&7! A~-'O)! *2H%'**/%&! /K)0! e$0/*&)Q1! '.! -7S'%'&! H%! 0/*!
#'T$H#)H*)V)%&!*MV7&#'XH)!d!0).H'!$z!./!#)0$%%/'**/%0)!O$#&)!*H#!.)!S/'&1!XH/%-!.)!S/'&!)*&!'T%$#7!V/'*!XH)!.)*!
O)#*$%%)*! *$%&! 0$%%H)*1! )&! )%! -$%%)! O$H#! )Y)VO.)! .)! Canace& -)! JO)#$%'1! &#/T7-')! '&/.')%%)! /.$#*! &$H&)!
#70)%&)! AEDkGQ1! -/%*! ./XH)..)! ./! #)./&'$%! '%0)*&H)H*)! )%&#)! H%! S#(#)! )&! H%)! *iH#1! 0$%%H)! -)! 0)*! -)HY!
O)#*$%%/T)*1!)*&! O$#&7)! 4! ./! 0$%%/'**/%0)! -)!.)H#!O(#)Z! C)! S/'*/%&1! 5$+$#&)..$! O#)%-! O$*'&'$%! /H!*)'%!-)! ./!
XH)#)..)!-)!Canace1!4!./XH)..)!0)#&/'%*!7#H-'&*!#)O#$0h/')%&!O#70'*7V)%&!-)!%)!O/*!S/'#)!O./0)!4!H%)!K7#'&/+.)!
#)0$%%/'**/%0)! A*$H*=)%&)%-H!d! 4! H%)! #)0$%%/'**/%0)! -2'-)%&'&7Q! )%! h'**/%&! /H! #/%T! -)! #)0$%%/'**/%0)!
&#/T'XH)! /H&h)%&'XH)! H%)! &)..)! #)0$%%/'**/%0)! -)*! S/'&*! */%*! #)0$%%/'**/%0)! -)*! O)#*$%%)*! AK$'#! <)#)%0)!
C/K)1!Recognitions&:&A&Study&in&poetics1!9YS$#-1!C./#)%-$%!L#)**1!EoFF1!OZ!Gk=GDQZ
Em!I$H*!#)O#)%$%*!'0'!.2)YO$*7!-)!<)#)%0)!C/K)1!Recognitions...1!OZ!GPZ
EE!8)!</**)1!Discours&du&poème&héroïque1!7-Z!)&!&#/-Z!"#/%s$'*)!l#/f'/%'1!L/#'*1!3H+')#1!Eoon1!OZ!gPFZ
Eg!_2/+$#-!0$%sH!0$VV)!H%!0$VV)%&/'#)!-)!./!Poétique&-23#'*&$&)!O./07!4!./!*H'&)!-2H%)!&#/-H0&'$%!-H!&)Y&)!
T#)0! )&! O/#H! *$H*! 0)&&)! S$#V)! )%! EGEE1! .)! &)Y&)! -)! {)'%*'H*! O#70(-)1! -/%*! ./! *)0$%-)! 7-'&'$%! -)! EGkP1! ./!
&#/-H0&'$%!-23#'*&$&)!)&!.H!-(*!.$#*!0$VV)!H%!&#/'&7!4!O/#&!)%&'(#)Z!C$%%H!-/%*!&$H&)!.2jH#$O)1!'.!)*&!-'SSH*7!)%!
"#/%0)! 4! O/#&'#! -)! ./! wH)#)..)! -H! Cid! AEGPnQ! AK$'#! 3%%)! _HO#/&1! '%&#$-H0&'$%! 4! .27-'&'$%! -H& De& constitutione&
tragœdiae1!l)%(K)1!_#$f1!gmmE1!OZ!km!sq.QZ

!
La scène de reconnaissance/Recognition Scenes
ARRÊT SUR SCÈNE/SCENE FOCUS 2 (2013)!
!
!
pPmq
4!./!#)0$%%/'**/%0)!c!'.!*2M! /-$%%)! /HY! -7K).$OO)V)%&*! /&&)%-H*!*H#!./! -'SS7#)%0)! )%&#)!
#)0$%%/'**/%0)! *'VO.)! )&! #)0$%%/'**/%0)! -$H+.)! )&! .)*! -'SS7#)%&*! V$-)*! -)! ./!
#)0$%%/'**/%0)! AO/#! *'T%)*! -'*&'%0&'S*1! O/#! #/'*$%%)V)%&1! )&0ZQ1! V/'*! O$*)! /H**'! H%)!
XH)*&'$%! -70'*'K)!d! U!wH)..)*! *$%&! .)*! 5)0$%%/'**/%0)*! XH'! %)! 0$%K')%%)%&! O/*! 4! ./!
<#/T7-')1!)&!XH)..)*!*$%&!0)..)*!XH'!O)HK)%&!M!S'TH#)#!W!•!C)&&)!XH)*&'$%!*7V'%/.)!&#/K)#*)!
./!O#7*)%&/&'$%!-)*!$+,)&*!-)!./!#)0$%%/'**/%0)1!*$'&!./!&#'.$T')!-)*!U!'%/%'V7*!W1!U!S/'&*!W1!
)&!U!O)#*$%%)*!W!d!!
Il&y&a&un&type&de&Reconnaissance&propre&à&la&Tragédie,&et&un&autre&qui&n’a&rien&à&voir&avec&elle.!j%!
)SS)&1! 0$VV)! ./! L7#'O7&')! )&! ./! 5)0$%%/'**/%0)! *$%&! &$H&)*! -)HY! -)*&'%7)*! 4! )Y0'&)#! .)*!
O/**'$%*1!&$H&)*!0)..)*!XH'!%)!#)VO.'**)%&!O/*!0)&!$SS'0)!*$%&!-H!V[V)!0$HO!'VO#$O#)*!4!./!
<#/T7-')!c!par&exemple,&lorsqu’un&personnage&reconnaît&quelque&chose&d’inanimé!N!H%)!K'..)1!H%!
VH#1!$H!H%!)%-#$'&1!*'!.2$%!K)H&!N!-)!O.H*1!H%)!5)0$%%/'**/%0)!-)!0)!&MO)!%)!*/H#/'&!)%&#/\%)#!
/H0H%!#)%K)#*)V)%&!-)!./!*'&H/&'$%Z!3'%*'1!-/%*!.)*!0$V7-')*!-)!L./H&)1!./!5)0$%%/'**/%0)!
O$#&)!O/#S$'*!*H#!-)*!,$H)&*1!-)*!0$#+)'..)*1!$H!-)*!/%%)/HY1!)&!02)*&!O$H#&/%&!4!0)./!XH)!&')%&!
&$H&! .)! #)%K)#*)V)%&! -)! ./! L'(0)! )..)=V[V)Z!C’est& le& cas& encore,& lorsqu’on& reconnaît& que&
quelqu’un& a& fait,& ou& n’a& pas& fait& quelque& chose,& simplement,& et& sans& que& cela& ait& aucune&
influence&sur&le&déroulement&de&la&Pièce.!_/%*!H%)!<#/T7-')1!0)*!*$#&)*!-)!5)0$%%/'**/%0)!%)!
O#$K$XH)%&! -2$#-'%/'#)! %'! ./! 0$VO/**'$%1! %'! .2h$##)H#1! /.$#*! XH)! 02)*&! ,H*&)V)%&! *H#! -)*!
/0&'$%*1! 0$VV)! 0)..)*=.41! XH)! O$#&)! &$H,$H#*! .2'V'&/&'$%! <#/T'XH)!d! 02)*&! O$H#XH$'! .)*!
5)0$%%/'**/%0)*!-)!0)!T)%#)!*$%&!)Y0.H)*1!-/%*!./!V)*H#)!$z!)..)*!%)!-7+$H0h)%&!%'!*H#!.)!
V/.h)H#! %'! *H#! .)! +$%h)H#1! /.$#*! XH)1! 0$VV)! $%! K')%&! -)! .)! -'#)1! ./! L7#'O7&')! )%&#/\%)!
&$H,$H#*!.2H%!-)*!-)HYZ!Voilà&pourquoi&les&Reconnaissances&dont&il&s’agit&maintenant&sont&les&
Reconnaissances&TragiquesEP.&
9%!.)!K$'&1!.)*!&#$'*!$+,)&*!-)!./!#)0$%%/'**/%0)!A'%/%'V7*1!S/'&*1!O)#*$%%)*Q!*$%&!-'*&#'+H7*!
)&! 0$VV)%&7*! )%! S$%0&'$%! -)! 0#'&(#)*! T7%7#'XH)*!c! -)*! &#$'*! $+,)&*1! *)H.! .2H%! A.)*!
O)#*$%%)*Q!O)H&!O#7&)%-#)!/007-)#!4!./!-'T%'&7!&#/T'XH)!c!XH/%&!/HY!-)HY!/H&#)*1!'.*!*$%&!
./'**7*! 4b! ./! 0$V7-')! $H! 4! -)*! &#/T7-')*! -2H%! T)%#)! '%S7#')H#b! C/#! '.! 'VO$#&)! -)!
0$VO#)%-#)!XH).*!*$%&!.)*!0#'&(#)*!XH'!O#7*'-)%&!4!./!0./**'S'0/&'$%!O#$O$*7)!O/#!{)'%*'H*1!
.)*XH).*!*$%&!&#(*!S'-(.)*!4!.2)*O#'&!)&!4!./!.$T'XH)!-H!0h/O'&#)!EE!-)!./!PoétiqueZ!827K$0/&'$%!
-)*!$+,)&*!O$**'+.)*!-)!./!#)0$%%/'**/%0)1!)&!%$&/VV)%&!-H!S/'&!-)!*/K$'#!*'!XH).XH2H%!/!
0$VV'*! $H! %2/! O/*! 0$VV'*! H%! /0&)1! O#)%-! O./0)! /O#(*! .2/SS'#V/&'$%! *).$%! ./XH)..)! U!./!
#)0$%%/'**/%0)!./!O.H*!+)..)!)*&!0)..)!XH'!*2/00$VO/T%)!-2H%!0$HO!-)!&h7r&#)!WZ!3O#(*!XH$'!
$%! .'&! U!B.! M! /! )%0$#)! -2/H&#)*! #)0$%%/'**/%0)*Ek!W1! $z! U!/H&#)*!W! *'T%'S')1! 0#$M$%*=%$H*1!
U!/H&#)*!W! O/#! #/OO$#&! /HY! O.H*! +)..)*! AXH'! *)! &#$HK)%&! [&#)! -)*! #)0$%%/'**/%0)*! -)!
O)#*$%%)*QZ!!
wH)!#)O#$0h)=&=$%!4!./!#)0$%%/'**/%0)!-)*!S/'&*!•!j%!-7S'%'&'K)!d!-2[&#)!V$'%*!+)..)!XH)!
./!#)0$%%/'**/%0)!-)*!O)#*$%%)*!)&!-)!%)!O/*
B. LOUVAT MOLOZAY, Objets et frontières de la scène de reconnaissance, d’Aristote à Racine
pPEq
L$H#!.2rT)!0./**'XH)1!.2H%)!-)*!*&#H0&H#)*!&#/T'XH)*!.)*!O.H*!/-/O&7)*!4!./!#)0$%%/'**/%0)!
-)!0H.O/+'.'&7!)*&!*/%*!0$%&)*&)!0)..)!-)!.2'%%$0)%&!O)#*70H&7!$H!'%,H*&)V)%&!0$%-/V%7Z!
C2)*&!0)!XH)!#/OO)..)!>/#0!;H'..)#V$f!-/%*!H%!/#&'0.)!0$%*/0#7!4!./!#)0$%%/'**/%0)!-/%*!
.)*! &#/T7-')*! -)! >/'#)&EDZ! C)&&)! *&#H0&H#)1! XH)! >/'#)&! #)O#)%-! -/%*! Le& Grand& et& dernier&
Solyman& ou& la& mort& de& Mustapha! AEGPFQ1! *2'%0/#%)! %$&/VV)%&! -/%*! -)HY! -)*! *H,)&*=
K)-)&&)*! -)! ./! *0(%)! )H#$O7)%%)1! .2H%! h'*&$#'XH)1! .2/H&#)! .7T)%-/'#)!d! 0).H'! -)! C#'*O)! )&!
0).H'!-2{'OO$.M&)Z!B.!*2/T'&!.4!-)!-)HY!*H,)&*!,HV)/HY1!-)HY!K/#'/%&)*!-2H%)!V[V)!*&#H0&H#)!
&#/T'XH)EG!-/%*!./XH)..)!H%!O(#)1!*H#!./!S$'!-)*!0/.$V%')*!-2H%)!7O$H*)!/00H*/%&!*$%!+)/H=
S'.*! -2/K$'#! 0h)#0h7! 4! /+H*)#! -2)..)1! )%K$')! 4! ./! V$#&! .)-'&! S'.*! )&! -70$HK#)! /O#(*! 0$HO! ./!
0H.O/+'.'&7! -)! .27O$H*)! )&! .2'%%$0)%0)! -H! S'.*Z! 9%! /H#/! #)0$%%H1! +')%! *€#1! .2'%&#'TH)! -)*!
Hippolyte!$H!-)*!Phèdre!XH'!*)!*$%&!*H007-7!-)OH'*!jH#'O'-)!)&!J7%(XH)!,H*XH24!5/0'%)Z!
Ch)f!5/0'%)1!./!*0(%)!-)!#)0$%%/'**/%0)!4!O#$O#)V)%&!O/#.)#!)*&!#)O$H**7)!4!.2)Y&#[V)!S'%!
-)!./!O'(0)!d!!
I$%1!<h7*7)1!'.!S/H&!#$VO#)!H%!'%,H*&)!*'.)%0)Z!!
B.!S/H&!4!K$&#)!S'.*!#)%-#)!*$%!'%%$0)%0)Z!!
B.!%27&/'&!O$'%&!0$HO/+.)Z!!
R!XH$'!S/'&!*H'&)!.)!#70'&!-)*!S/'&*1!/K)0!H%)!$OO$*'&'$%!*7V/%&'XH)!&#(*!V/#XH7)!AU!C2)*&!
V$'!XH'!*H#!0)!"'.*!0h/*&)!)&!#)*O)0&H)HY!•!9*/'!,)&)#!H%!i'.!O#$S/%)1!'%0)*&H)HYEn!WQZ!
>/'*!0)&&)!#)0$%%/'**/%0)!)*&!O#7O/#7)!-)OH'*!.)!-7+H&!-)!.2/0&)!;1!K$'#)!.)!-7+H&!-)!
./!O'(0)!A.)!#70'&!-)!Lh(-#)!K')%&!O/#/0h)K)#!H%)!*7#')!-2/K)HY1!4!~%$%)1!OH'*!4!{'OO$.M&)!
OH'*! )%S'%! 4! <h7*7)EFQ! c! 02)*&1! *H#&$H&1! .)! &#/'&)V)%&! -H! O)#*$%%/T)! -)! <h7*7)1! */'*'! -)!
-$H&)*!-(*!.)!-7+H&!-)!.2/0&)!;1!XH'!O#7O/#)!/H!V')HY!./!#)0$%%/'**/%0)!AXH'!%2)*&!&)..)!XH)!
O$H#! .)! O)#*$%%/T)1! .)! *)H.! XH'! 'T%$#)! )%0$#)! -)*! S/'&*! XH)! *O)0&/&)H#*! )&! /H&#)*!
O)#*$%%/T)*!0$%%/'**)%&!-)OH'*!O.H*')H#*! /0&)*QZ! _)! 0$H#&*!V$%$.$TH)*!-H!O)#*$%%/T)!
O$%0&H)%&! /'%*'! .)! -)#%')#! /0&)!d! U!_')HY1! 70./'#)f! V$%! &#$H+.)1! )&! -/'T%)f! 4! V)*! M)HY! •!
>$%&#)#!./! K7#'&71! XH)!,)!0h)#0h)! )%! 0)*!.')HY!W! 4! ./! *0(%)! g!OH'*1!O.H*! .$%TH)V)%&1! 4! ./!
*0(%)!k1!/O#(*! XH23#'0')! /! XH'&&7! ./! *0(%)1!/K$H/%&!U!SH]'#^! */!O#7*)%0)! •!L$H#!%2[&#)!O/*!
S$#07)!4!#$VO#)!.)!*'.)%0)!W!d!
wH)..)!)*&!-$%0!*/!O)%*7)!•!j&!XH)!0/0h)!H%!-'*0$H#*!
C$VV)%07!&/%&!-)!S$'*1!'%&)##$VOH!&$H,$H#*!•!
]b^!!
>/'*!V$'=V[V)1!V/.T#7!V/!*7K(#)!#'TH)H#1!
wH)..)!O./'%&'K)!K$'Y!0#')!/H!S$%-!-)!V$%!0iH#!•!
:%)!O'&'7!*)0#(&)!)&!V2/SS.'T)1!)&!V27&$%%)EoZ!
j%S'%1!.)*!-)#%'(#)*!O/#$.)*!-2{'OO$.M&)1!ultima&verba!XH'!$%&!&$H,$H#*!K/.)H#!-)!K7#'&71!)&!
XH)!#/OO$#&)%&!<h7#/V(%)1!/0h(K)%&!-)!O#7O/#)#!./!*0(%)!S'%/.)!d!
!
ED!>/#0!;H'..)#V$f1!U!8)!&#/'&)V)%&!-)!./!#)0$%%/'**/%0)!-/%*!.)*!&#/T7-')*!-)!>/'#)&!W1!Littératures&classiques1!
%‚!GD! AU!.)! &h7r&#)! -)! e)/%! >/'#)&!WQ1! gmmF1! OZ! EEn=EgnZ! ;$'#! /H**'1! -H! V[V)! /H&)H#1! U!3*O)0&*! -)! ./!
#)0$%%/'**/%0)!&#/T'XH)!-/%*!.)!&h7r&#)!S#/%s/'*!-H!t;BB)!*'(0.)!W1!La&Reconnaissance&sur&la&scène&française&XVIIeW
XXIe&siècle1!-'#Z!"#/%s$'*)!{)H.$&=L)&'&!)&!8'*)!>'0h).1!3##/*1!3#&$'*!L#)**)*!:%'K)#*'&71!gmmo1!OZ!gE=PgZ
EG!JH#!./!XH)*&'$%1!K$'#!%$&/VV)%&!l)$#T)*!"$#)*&')#1!U!>M&h)1!h'*&$'#)!)&!&#/T7-')!d!-)!C#'*OH*&4!La&Mort&de&
Chrispe!W1! Mythe& et& Histoire& dans& le& Théâtre& classique1! -'#Z!"/%%M!I7O$&)=_)*V/##)*! )&! e)/%=Lh'.'OO)!
l#$*O)##'%1!<$H.$H*)1!J$0'7&7!-)!8'&&7#/&H#)*!0./**'XH)*1!gmmg1!OZ!PDE=PnmZ
En!5/0'%)1!Phèdre!AEGnnQ1!;1!n1!KZ!EGEn=EGEo!OH'*!KZ!EGgP=EGgk!c!-/%*!Œuvres&complètes1!&Z&1&AThéâtreWPoésieQ1!7-Z!
lZ!"$#)*&')#1!L/#'*1!l/..'V/#-1!6'+.'$&h(XH)!-)!./!L.7'/-)1!Eooo1!OZ!FnGZ
EF!B.*!$00HO)%&!#)*O)0&'K)V)%&!.)*!*0(%)*!B1!P!c!BB1!D!)&!;1!nZ
Eo!Phèdre…1!;1!P1!KZ!Ekko=EkDm!OH'*!;1!k1!KZ!EkDE=EkDF1!OZ!FnmZ
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%