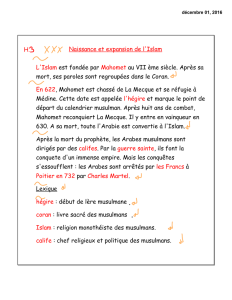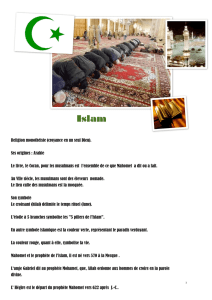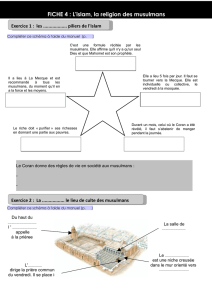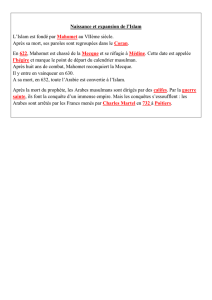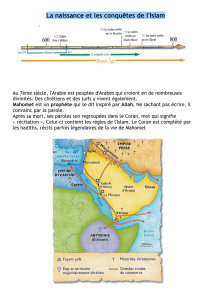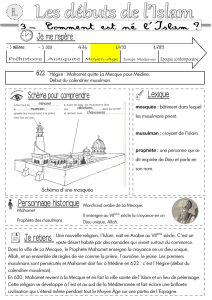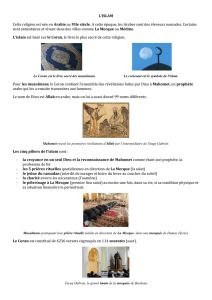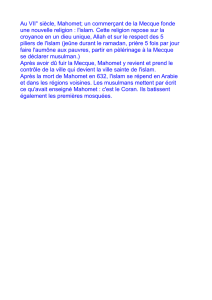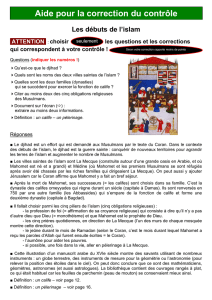LA TRADITION

Le chemin du retour vers Allah
LA TRADITION
ISLAMIQUE
Sous la direction de
Jean-Marie Debunne
Jean-René Milot

Le chemin du retour vers Allah
LA TRADITION
ISLAMIQUE
Jean-René Milot
Directeur de la collection
Jean-Marie Debunne

La tradition islamique
Auteur Jean-René Milot, enseignant à l’Université du Québec
à Montréal et à l’Université de Montréal, et spécialiste en
études islamiques
Directeur de la Collection Labyrinthes Jean-Marie Debunne, professeur en éducation
religieuse à l’Université Saint-Paul
Conception graphique Les Éditions La Pensée inc.
Révision linguistique Marie-Claude Piquion
Illustrations Monique Chaussé
Photographies Archives du Centre Monchanin,Archives Rédaction
d’Orient, Jean-René Milot, Jean-Marie Debunne,
Anne-Héloïse Debunne
Remerciements Un merci tout particulier à la boutique Multivisions
pour son acceuil et le prêt d’objets pour fins de
photographie (www.multivisionsinc.com)
© Les Éditions La Pensée inc., 2002
Tous droits réservés.
On ne peut reproduire, enregistrer ni diffuser aucune partie du présent ouvrage, sous
quelque forme ou par quelque procédé que ce soit,électronique,mécanique, photographi-
que, sonore, magnétique ou autre, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de
l’éditeur.
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2002
Bibliothèque nationale du Canada, 2002
Imprimé et relié au Québec
ISBN 978-2-89458-292-3
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du
Programme d’Aide au Développement de l’Industrie de l’Édition (PADIÉ) pour nos activi-
tés d’édition.
«Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC»
LE «PHOTOCOPILLAGE» TUE LE LIVRE

•Les musulmans chez nous et dans le monde 2
Un monde imposant, étendu et très varié 3
Un monde qui a quelque chose en commun 4
Un monde à apprivoiser 6
•Le Prophète Mahomet et les débuts de l’Islam 8
L’Arabie à la veille de l’Islam 9
Mahomet à La Mecque 12
Mahomet à Médine 15
Le rôle de Mahomet dans l’Islam 18
•Le Coran, Livre sacré des musulmans 20
Le caractère oral et auditif des révélations 20
Le passage de l’oral à l’écrit 22
Le caractère sacré du Coran 23
Le Coran au cœur de la vie des musulmans 24
•Le Coran et les grandes questions de la vie 26
Allah, le créateur 27
La création de l’Univers 29
La création des anges 30
La création de l’homme et de la femme 30
Le cycle de la prophétie 31
Les prophètes et les Livres 33
Le Jugement et la vie future 36
•Le chemin du retour vers Allah 38
Croire, dire et faire: foi et religion 39
Du Coran à la Loi islamique 40
Les cinq piliers de l’Islam 43
Les rites et les fêtes 45
Les interdictions 46
•Comprendre les musulmans aujourd’hui 48
Attitudes et tendances face au déclin 49
Entre deux modèles de société 50
Le statut de la femme en Islam 52
Le port du voile ou du foulard 55
L’accommodement des différences 56
Table
des matières

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%