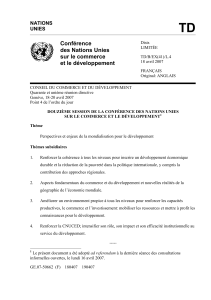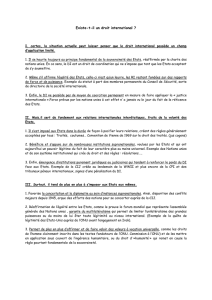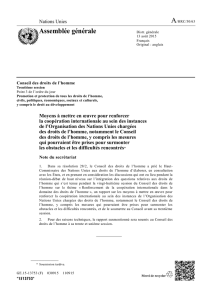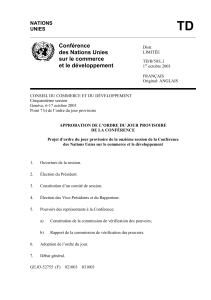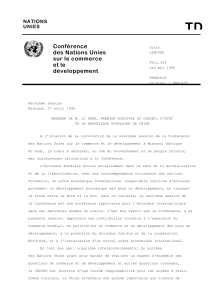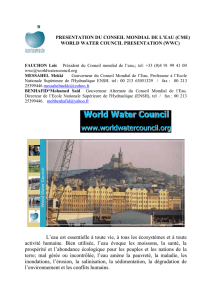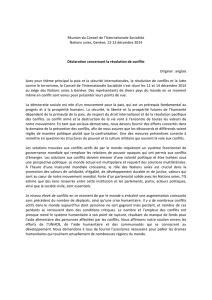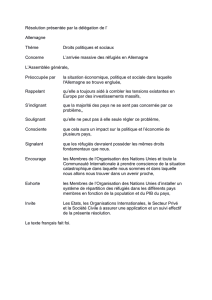pour le respect des droits de l`homme sans droit d`ingérence

POUR LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
SANS DROIT D’INGÉRENCE
La question du droit d’ingérence est difficile, car il s’agit d’un
sujet sensible où la passion le dispute à la controverse. Se trouvent
mêlées à ce concept, des considérations d’ordre politique, stratégi-
que, économique, éthique, morale et juridique. L’enchevêtrement
est tel que même sur le plan sémantique la notion d’ingérence se
confond avec l’intervention. Selon le Petit Robert, s’ingérer : c’est
s’introduire indûment, sans en être requis ou en avoir le droit.
Entendue en ce sens l’ingérence n’existe pas en droit international,
ou plus précisément le droit international interdit toute immixtion
ou intrusion dans les affaires intérieures des Etats. Si le droit inter-
national ignore donc l’ingérence, il connaît, en revanche, l’interven-
tion.
L’intervention est dite matérielle lorsqu’elle se concrétise par une
opération physique sur le territoire d’un Etat étranger, elle est
immatérielle, en cas de simple appréciation sur un régime politique
donné (
1
). De même, l’intervention peut être licite ou illicite; elle est
licite lorsqu’elle respecte le cadre juridique dans lequel elle doit se
dérouler, elle est illicite dès lors qu’elle s’opère en marge de la léga-
lité sur la base de mobile politique.
Une réflexion juridique s’impose pour tenter d’élucider un sujet
sans cesse entouré d’une « atmosphère » confuse (
2
), et enveloppé
d’une certaine incertitude.
La question qui se pose est de savoir dans quel cas on peut inter-
venir sur le territoire d’un Etat étranger. La réponse peut paraître
simple prima facie : à chaque fois que l’Etat en cause donne son
consentement à cette intervention. Lorsque les autorités locales
donnent explicitement leur accord à l’intervention, celle-ci est licite.
Le problème ne se pose donc qu’en cas de refus de l’Etat. On consi-
dère, en droit international que chaque Etat est libre dans son ordre
(1) Dans l’Affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre
celui-ci, la Cour internationale de justice affirme que : « ... si les Etats-Unis peuvent
certes porter leurs appréciations sur les situations des droits de l’homme au Nicara-
gua, l’emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer
le respect de ces droits », Rec., 1986, p. 14.
(2) Comme le dit fort justement Max Weber : « Ce n’est pas parce que la réalité
est ambiguë que nos concepts doivent être confus ».

juridique interne. Selon la Cour permanente de justice internatio-
nale : « dans l’exercice de ses compétences territoriales chaque Etat
reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus
convenables » (
3
).
Mieux, il y a une présomption de légalité de tout acte édicté par
un Etat sur son territoire. Ayant une compétence générale, l’Etat
peut tout faire sur son territoire sauf bien entendu à répondre de ses
engagements internationaux (Par exemple protéger les diplomates
qu’il accueille sur son territoire, mais il reste libre de ne pas établir
des relations diplomatiques).
Il faut s’attaquer à la délicate question : en cas de violation des
droits de l’homme (
4
) peut-on intervenir pour faire cesser ses vio-
902 Rev. trim. dr. h. (2002)
(3) C.P.J.I, arrêt du 7 septembre 1927, Affaire de Lotus, série A, N
o
10. La Cour
européenne des droits de l’homme, par une décision du 19 décembre 2001, Bankovic
et autres contre Belgique et autres, a décidé, que le recours de victimes yougoslaves des
bombardements de l’OTAN sur Belgrade, était irrecevable. Selon cette jurisprudence
il faut entendre par « qui relève de leur juridiction », qui relève de leur juridiction ter-
ritoriale : « en ce qui concerne le » sens ordinaire « des termes pertinents figurant dans
l’article 1 de la Convention, la Cour considère que, du point de vue du droit interna-
tional public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territo-
riale. Si le droit international n’exclut pas un exercice extraterritorial de sa juridic-
tion par un Etat, les éléments ordinairement cités pour fonder pareil exercice (natio-
nalité, pavillon, relations diplomatiques et consulaires, effet, protection, personnalité
passive et universalité, notamment) sont en règle générale définis et limités par les
droits territoriaux souverains des autres Etats concernés... L’article 1 de la Conven-
tion doit passer pour refléter cette conception ordinaire et essentiellement territoriale
de la juridiction des Etats, les autres titres de juridiction étant exceptionnels et
nécessitant chaque fois une justification spéciale, fonction des circonstances de l’es-
pèce ». La Cour ajoute : « La Convention est un traité multilatéral opérant, sous
réserve de son article 56 (application territoriale), dans un contexte essentiellement
régional, et plus particulièrement dans l’espace juridique des Etats contractants,
dont il est clair que la République fédérale de Yougoslavie ne relève pas. Elle n’a
donc pas vocation à s’appliquer partout dans le monde, même à l’égard du comporte-
ment des Etats contractants. »
(4) La notion même des droits de l’homme est assez ambiguë. On distingue géné-
ralement les libertés publiques en droit interne, et les droits de l’homme considérés
comme le statut international des libertés. L’idée des droits de l’homme implique
l’existence de valeurs universelles qui se situent au dessus de la diversité des cultures.
En effet, même si le relativisme culturel consiste à considérer toutes les cultures
comme équivalentes et qu’il n’est pas possible d’établir entre elles une hiérarchie —
Montaigne fut l’un des premiers penseurs à avoir attiré l’attention sur ce caractère
relatif des valeurs culturelles : il faut dit-il, faire preuve d’ouverture d’esprit et de
tolérance vis-à-vis de ceux dont les comportements différent des nôtres — Cepen-
dant, poussé dans ses extrêmes limites, le relativisme culturel débouche sur une
impasse, dans la mesure où il conduirait à tout admettre — l’esclavage, le génocide,
les sacrifices humains, etc., d’où l’idée de valeurs universelles incarnées dans les
droits de l’homme qui s’imposent à toutes les cultures.

lences et soulager les victimes en leur apportant les soins et les
secours nécessaires? Autrement dit, les droits fondamentaux de la
personne humaine justifient-ils — au cas où ils seraient violés —
une intervention de tout Etat contre un autre Etat, même lorsque
la victime de la lésion n’est pas un national de l’Etat réclamant?
Après tout comme le dit le Parlement européen dans une Résolution
du 2 octobre 1997 (A4-0274/97) : « Les êtres humains sont de plus en
plus liés les uns aux autres, ce qui se traduit... par l’émergence de
valeurs communes à toute Humanité ». Les droits de l’homme tra-
duisent ces valeurs communes, qui doivent être sauvegardées et
défendues. Les pays occidentaux considèrent généralement qu’en
matière de droits de l’homme un Etat ne peut pas opposer sa com-
pétence nationale. En réalité, le droit positif, ne permet pas aujour-
d’hui de venir au secours des droits de l’homme bafoués ici ou là (
5
).
La notion « droit d’ingérence » porte en elle-même les germes de sa
contradiction, elle est antinomique. En effet de deux choses l’une :
— ou bien on est en présence d’un droit et ce n’est pas de l’ingé-
rence
— ou bien c’est de l’ingérence et ce n’est pas un droit.
Une double question se pose ici : quels sont les obstacles juridi-
ques à l’ingérence (I)?; y a-t-il des actions alternatives au droit
d’ingérence (II)?.
I. — Le droit d’ingérence :
les obstacles juridiques
Les obstacles juridiques au droit d’ingérence résultent des pres-
criptions du droit positif d’une part (A) et des décisions de la juris-
prudence internationale d’autre part (B)
A. — Le droit positif :
droit coutumier et droit conventionnel
Depuis le traité de Westphalie de 1648, la maîtrise exclusive du
territoire est un attribut traditionnel de la souveraineté. Deux
Rev. trim. dr. h. (2002) 903
(5) L’emploi de la force armée en violation de la Charte des Nations Unies est
explicitement exclu par l’article 2 alinéa 2, de la résolution adoptée le 13 septembre
1989 par l’Institut de droit international et intitulée : « La protection des droits de
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures de l’Etat ».
(Annuaire, 1990, vol. 63-II, p. 338).

règles notamment ont survécu à ce traité : l’égalité et la souverai-
neté des Etats (
6
). Le droit positif de la Charte des Nations Unies
affirme dans son article 2, paragraphe 4 : « Les membres de l’organi-
sation s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir
à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territo-
riale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de tout autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (
7
). La réso-
lution 26 25 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée générale des
Nations Unies est encore plus explicite : « Aucun Etat ni groupe
d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement pour
quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures
d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention
armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace,
dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments
politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit inter-
national » (
8
). En 1981, l’assemblée des Nations Unies affirme « le
devoir d’un Etat de s’abstenir d’exploiter ou de déformer les ques-
tions relatives aux droits de l’homme dans le but de s’ingérer dans
les affaires intérieures des Etats ». De même selon l’acte final d’Hel-
sinki : « En vertu du principe de l’égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes, tous les peuples ont toujours
le droit, en toute liberté, de déterminer lorsqu’ils le désirent et
comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans
ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement
politique, économique, social et culturel » (
9
). Enfin, les chefs d’Etat
904 Rev. trim. dr. h. (2002)
(6) Selon Jean Bodin : « La souveraineté est le pouvoir de commander et de
contraindre sans être commandé ni contraint par qui que ce soit sur la terre ».
(7) De son côté la doctrine Monroe — du nom du Président américain de l’épo-
que — affirme « notre politique consiste à ne jamais nous interposer dans les affaires
intérieures d’aucune puissance de l’ancien monde »
(déclaration du 2 décembre 1823).
(8) La résolution 36/103 de l’Assemblée du 9 décembre 1981 abonde dans le même
sens : « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention et de l’ingérence dans les
affaires intérieures des Etats ».
(9) La C.I.J considère que cette déclaration a un effet juridique. Selon la Cour :
« Les Etats-Unis ont expressément accepté les principes énoncés dans la déclaration
de l’acte final de la conférence d’Helsinski (1
er
août 1975) sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, y compris un exposé détaillé du principe de non-intervention. Ces
principes ont été assurément présentés comme s’appliquant aux relations mutuelles
entre les Etats participants, mais on peut considérer que leur texte témoigne de
l’existence et de l’acceptation par les Etats-Unis, d’un principe coutumier universel-
lement acceptable ». (Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, § 204, p. 107; voy
également Moncef Kdhir, « Quelques réflexions sur la nature juridique de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 », Revue de droit interna-
tional et de droit comparé, 1999, p. 340).

et de gouvernement, affirment dans leur Déclaration du Millénaire,
adoptée le 8 septembre 2000 aux Nations Unies : « Nous sommes
résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier
conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte.
Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l’égalité
souveraine de tous les Etats, le respect de leur intégrité territoriale
et de leur indépendance politique, le règlement des différends par
des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et
du droit international, le droit à l’autodétermination des peuples
qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étran-
gère, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le res-
pect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect
de l’égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion et une coopération internationale en vue du
règlement des problèmes internationaux à caractère économique,
social, culturel ou humanitaire » (
10
). Quant à la doctrine, elle consi-
dère que l’ingérence est illicite. Ainsi Rougier considère que « si les
Etats peuvent agir pour défendre leurs droits, ils ne peuvent pas
s’entre — juger, ni s’entre — punir les uns les autres. Au dessus des
Etats, il n’existe ni loi pénale internationale, ni tribunal chargé de
l’appliquer » (
11
). Selon Charles Chaumont; il existe bien « un corps
de règles suffisantes pour que le principe de la non-intervention, en
tant qu’élément du droit international positif... soit solidement
assuré » (
12
). Enfin François Rigaux affirme : « On ne saurait...
accepter que les violations des droits fondamentaux dont un Etat
est accusé justifient une forme d’ingérence s’accompagnant du
recours à la force » (
13
).
Certes deux résolutions avaient été adoptées, l’une le 8 décembre
1988 (Résolution 43/131), l’autre le 14 décembre 1990 (Résolu-
tion 45/100) — La première intitulée « Assistance humanitaire aux
victimes des catastrophes naturelles et situations d’urgence du
même ordre », bien qu’elle pose le principe selon lequel l’accès aux
victimes est indispensable, organise une procédure de subsidiarité
permettant à l’Etat sur le territoire duquel la catastrophe a eu lieu
Rev. trim. dr. h. (2002) 905
(10) Déclaration du Millénaire adoptée par les représentants des pays siégeant
aux Nations Unies, lors de l’Assemblée générale du Millénaire (55
e
session) qui s’est
tenue à New York du 6 au 8 septembre 2000.
(11) Rougier, « La théorie de l’intervention d’humanité », R.G.D.I.P, 1910,
p. 499.
(12) Ch. Chaumont, « Analyse critique de l’intervention américaine au Vietnam »,
R.B.D.I, 1968/1, p. 63.
(13) F. Rigaux, « Le concept de territorialité : un fantasme en quête de réalité »,
In Liber Amicorum M. Bedjaoui, Kluwer Law International 1999, p. 221.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%