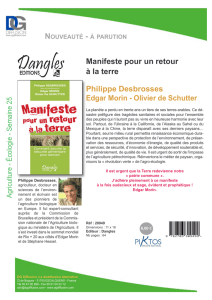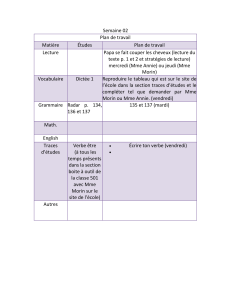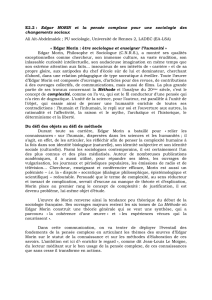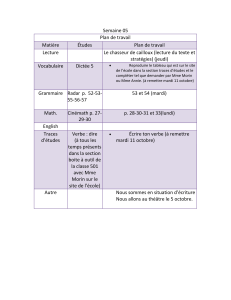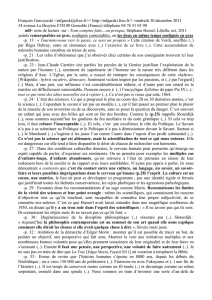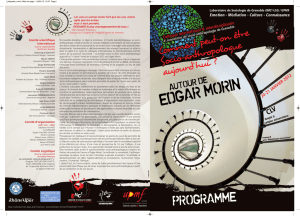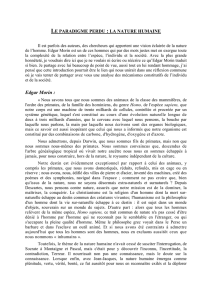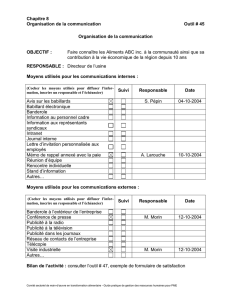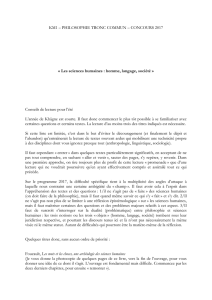Études sur la place et la signification de la philosophie de la

République Française
Discours de présentation à l’occasion de la soutenance du Mémoire
d’Habilitation à Diriger des Recherches
(HDR)
Année Universitaire : 2014-2015
Date : lundi, 9 novembre 2015
Lieu : Université Paul Valéry, Montpellier 3, France
Heure : 10h30
UFR : V
Thème du mémoire :
Etudes sur la place et la signification de la philosophie
de la connaissance dans le parcours anthropologique
d’Edgar Morin
Présenté et soutenu publiquement par
Auguste Nsonsissa,
Maître de Conférences en Philosophie

2
Intuition directrice et Résumé du mémoire
Monsieur le Président du Jury,
Messieurs les membres du jury
Pour commencer, nous nous faisons l’agréable devoir de vous dire de tout cœur et en
toute raison, notre reconnaissance inchangée pour la disponibilité dont vous aviez fait
preuve ; aujourd’hui, chacun de vous, par-delà vos multiples occupations universitaires ;
disponibilité à la faveur de laquelle cette soutenance a été rendue possible, ici et maintenant.
Qu’il nous soit également permis de saluer, avec déférence, la présence dans cette
salle de Monsieur Edgar Morin et Monsieur Charles Zacharie Bowao dont nous sommes le
disciple, pourrait-on dire, depuis de longues années. Si premier est celui qui nous a inspirés
dans la mise en route inédite de l’épistémologie de la complexité, le second est à notre
humble avis un véritable maître à penser. Depuis 1997, son appui presque inconditionnel à
tout ce que nous esseyons d’entreprendre comme recherches universitaires entre le Congo-
Brazzaville notre Pays d’origine et la France, et ce dans le domaine de la logique,
l’épistémologie et histoire des sciences de la complexité, nous remplit de bonheur et nous
autorise à en éprouver une fierté légitime.
Pour toutes ces raisons doublées de saines convictions, nous
1
montrons les éléments de
la philosophie
2
des reliances ou de la reliance des connaissances au cœur de la philosophie
contemporaine des sciences qui suscite, dans le « contexte académique africain » qui est le
nôtre, particulièrement, du vague à l’âme chez la plupart de ceux des métaphysiciens et
autres historiens de la philosophie dits de pure souche qui pensent que les sciences
anthroposociales n’ont une aucune dimension philosophante avec Edgar Morin. A dire vrai,
ce mémoire est une réponse à ceux de nos contradicteurs potentiels. Il se propose donc de
critiquer les dénégations outragées lancées à l’égard d’Edgar Morin, notre auteur de
prédilection, pourtant Philosophe et anthropo-sociologue français, en raison parfois face à
de telles hypothèses audacieuses, des malentendus déjà entendus qui sont nés et qui sont de
nature à rappeler ce que le « Penseur » français appelle : « l’intelligence aveugle »,
3
c’est-à-
dire l’incapacité d’articuler le contexte et le complexe planétaire et qui est aussi
1
Auguste NSONSISSA est Maître de Conférences de Philosophie à l’Université Marien Ngouabi de
Brazzaville, République du Congo, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (F.L.S.H), Parcours-Type
Philosophie où il enseigne la logique, l’épistémologie et la philosophie analytique, Chercheur Associé au Centre
Edgar Morin de l’IIAC/EHESS/CNRS, Chercheur Associé au Centre d’Etude sur l’Actuel et le Quotidien (Ceaq)
Paris-Descartes, Sorbonne, Membre de la Société de Philosophie des Sciences (SPS). Auteur de six ouvrages.
2
N. Truong, « Edgar Morin. Le philosophe indiscipliné », in Le Monde, Hors série, 2010.
3
Edgar Morin pense que « l’intelligence qui ne sait que séparer brise le complexe du monde en fragments
disjoints, fractionne les problèmes, unidimensionnalise le multidimensionnel. Elle atrophie les possibilités de
compréhension et de réflexion, éliminant aussi les chances d’un jugement correctif ou d’une vue à long terme. »
Cf. La tête bien faite. Repnser la réforme, réformer la pensée, Paris, Seuil 1999, p. 14.

3
caractéristique de la « pathologie du savoir. »
1
Contre ces carences intellectuelles, nous plaidons en faveur de l’instauration d’une
pensée intersticielle qui pourra se présenter comme une « symbiosophie ». Cela étant posé,
peut-on savoir plus que l’on sait sur « la reliance des connaissances »
2
chez Edgar Morin ?
Reliance sans laquelle il ne serait pas possible d’entrevoir l’épistémologie de la complexité
aujourd’hui. De l’intérieur du monde de la logique, notre domaine de spécialité, comment
s’en approprier en contexte anthropo-philosophique qui est la jointure épistémologique des
deux domaines qui nous servent d’angle de vue pour penser la dialogique des phénomènes,
des savoirs et des cultures.
En revanche, il ne s’agit pas seulement de l’appropriation de la reliance des
connaissances philosophiques et anthropo-sociologiques en tant que telle, mais aussi et
surtout de la capitalisation de la décolonisation conceptuelle de la philosophie, en vue d’en
extirper la parenté de substance méthodologique entre les humanités et les sciences
naturelles.
Au-delà donc de la controverse avec ses critiques patentés et de ce que l’on peut
comprendre et dire à propos de l’épistémologie morinéenne, encore en chantier, nous avons
choisi d’épingler concept communicationnel de « reliance » comme pensée interstitielle
pour justifier notre contribution critique à la complexification du projet transdicsiplinaire de
Morin dont les carences, les imperfections, les impasses et les paradoxes méthodologiques
ont déjà été relevés dans notre thèse doctorale soutenue le 10 juin 2006, ainsi que dans notre
mémoire d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)présenté le 9 novembre 2015.
Quoi qu’il en coûte, il nous faut dire d’abord un mot sur le contexte et la genèse du
sujet de la reliance en question. Que peut-on alors en penser ?
Mots-clés : Connaissance, Complexité, Equicontextualité, Pensée, Reliance,
Symbiosophie.
1
Ce disant Edgar Morin plaide pour « l’inter-poly-trans-disciplinarité », parce qu’il estime qu’il ne suffit pas
d’être à l’intérieur d’une discipline pour connaître tous les problèmes afférents à celle-ci. » Cf. Ibid., Annexe 2,
p. 127.
2
Edgar Morin, Relier les connaissances. Le défi du XXIè siècle, (dir.), Paris, Seuil, 1999, p. 19.

4
Introduction à l’histoire et l’état des lieux d’une pensée interstitielle
Tel qu’il se donne à comprendre historiquement et théoriquement le concept
communicationnel de « reliance » n’apparaît pas immédiatmement dans Le Paradigme
perdu : la nature humaine ouvrage
1
de percée et annonciateur de La Méthode d’Edgar
Morin qui se décline en 6 volumes. Il n’est ni ici, ni dans le 4è volume
2
consacré
essentiellement à la « connaissance de la connaissance ». A dire vrai, son usage est attesté
visiblement dans Terre Patrie.
Maintenant, on saurait interroger les perspectives sur Morin à partir du concept de
« reliance » sans travailler, également, à la « complexité
3
» épistémologique. Ce concept qui
tient lieu de paradigme assez souvent contesté, à cause de son hybridisme, devrait apparaître
à d’autres tenants de la science classique comme totalement hérétique. Sous prétextes
qu’Edgar Morin qui en vise l’instauration, ne va jamais au fond des choses. Encore faut-il
1
Edgar Morin, Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, Seuil, 1973.
2
Edgar Morin, La Méthode 4. Les idées, leur habitat, leur vie, leurs mœurs, leur organisation, Paris, Seuil,
1991.
3
D’après Morin la complexité est un défi : « Le défi de la globalité est en même temps un déi de complexité. En
effet, il y a complexité lorsque sont inséparables les composants différents constituant un tout (comme
l’économique, le politique, le sociologique, le spychologique, l’affectif, le mythologique) et qu’il ya tissu
interdépendant, interactif et inter-rétroactif entre les parties et le tout, le tout et les parties. Or les développements
propres à notre siècle et à notre ère planétaire nous affrontent de plus en plus souvent et de plus en plus
inéluctablement aux défis de la complexité. », Ibid., p. 14.

5
qu’on nous dise s’il existe un penseur, un seul, au monde, qui peut oser affirmer avec
certitude que les choses, en question, ont réellement leur fond et qu’on y accéder par la
philosophie seule. Cela ne peut pas aller de soi pour tous. Il faut donc critiquer et dépasser
le positivisme réflexif des philosophes pour aller au-delà du contexte purement
métaphysique de la philosophie contemporaine des sciences. Telle la légitimité
épistémologique du contexte de la découverte du paradigme de la complexité et le contexte
de sa justification.
Cela étant dit, nous avons voulu, en nous inspirant, du mieux qu’il nous est possible,
des travaux disponibles sur l’état de la question relative à la reliance des connaissances,
essayer d’aller encore plus loin, non pas dans la provocation, mais dans l’évocation d’une
intuition lumineuse, pour affirmer, avec nuances, que sur le plan de la connaissance
relationnelle et de la reconnnaissance des énigmes de ces relations interdisciplinaires, en
vue de promouvoir l’indispensable radicalité de la pensée des reliances, sur ce plan là,
Edgar Morin est, sans doute, en passe de marquer durablement des générations de socio-
anthropologues qui considèrent volontiers que leur champ de recherche doit être ouvert à
toutes les approches possibles.
Parmi les disciplines que Morin met en oeuvre, on peut prendre comme angle de
vision, la « philosophie anthropologique » qui occupe une place singulière dans cette
dimension de la « socio-anthropologie philosophante ». Cet élan de problématisation de ses
recherches anthroposociales est resté très présent dans ses réflexions transdisciplinaires, en
suivant le sillon planté aussi par Platon et Aristote. Grâce à eux deux, nous avons senti
l’impérieuse nécessité d’élaborer une réflexion qui, loin de minimiser la corélativité des
phénomènes complexes et leur absence (ou leur vacuité) de nature propre, la prend, plutôt,
pour prémisse épistémologique de sa tension éthique vers une manière d’être ouverte au
dialogue entre les disciplines ; « interlocution dialogique » qui nous prédispose déjà à ce
que Morin appelle une « Symbiosophie ».
Ce trait particulier, est-il besoin de le souligner, se reconnaît dans le propos
canonique d’Edgar Morin, qu’il a prononcé, en 2011 lorsqu’il soulignait, au Colloque
international et interdisciplinaire
1
que : « Je n’aime pas être enfermé dans l’étiquette de
sociologue. Tout ce que j’ai écrit a une dimension sociologique, mais ne s’y réduit pas. »
Cela étant, partant de cette affirmation, nous nous sommes donc donné les moyens
d’interroger le parcours de La Méthode dans laquelle Edgar Morin ne rejette ni la socio-
anthropologie, ni la philosophie de la connaissance. Nous pensons qu’il y a, pourtant là, un
1
Auguste Nsonsissa, « La position d’Edgar Morin dans le débat contemporain sur la fin de la sociologie
classique », Communication au Colloque International et Interdisciplinaire, 4è rencntres de socio-anthropologue
de Grenoble, Comment peut-on être Socio-anthropologue aujourd’hui ? Autour d’Edgar Morin. Ce colloque
auquel nous avons été invité en qualité de Conférencier et de Membre du Comité scientifique, a été organisé par
Laboratoire de Sociologie de Grenoble EMC2-LSG/UPMF, Emotion-Médiation-Culture-Connaissnce, Université
Pierre Mendez France, Sciences sociales et Humaines, les 20 et 21 janvier 2012, Amphi G, Campus
Universitaire, (dir.), Florent Gaudez, p. 41.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%