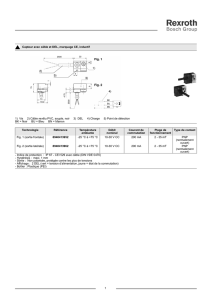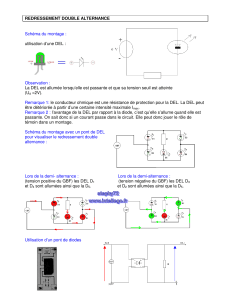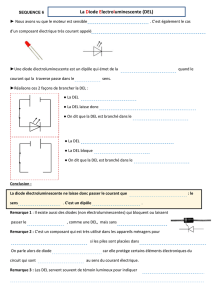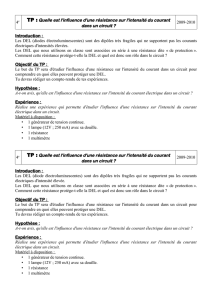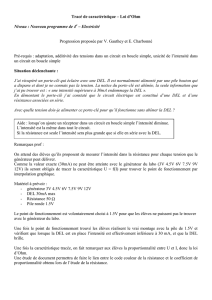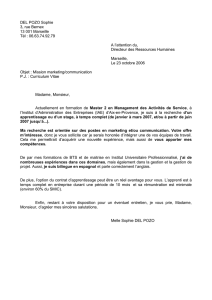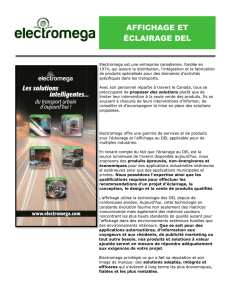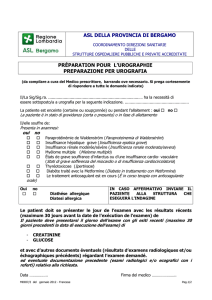Le déveLoppement économique LocaL en afrique, miSe en œuvre

2015
Dialogue et renforcement des capacités
des autorités locales et régionales des
pays partenaires de l'UE dans les
domaines du développement
et de la gouvernance locale
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LOCAL EN AFRIQUE,
MISE EN ŒUVRE,
CONTRAINTES ET
PERSPECTIVES
AFRIQUE

Le développement économique local en Afrique,
mise en œuvre, contraintes et perspectives
PLATFORMA – 2015
CLGF – 2015
Autheur : François Paul Yatta
Ce document a été conçu comme le point de départ pour le “Séminaire pour le Dialogue et le
développement des capacités des autorités locales et régionales en Afrique dans les domaines du
développement et de la gouvernance locale” qui s’est tenu du 13-14 Mai 2013, à Kampala.
PLATFORMA Partenaires du projet : Dialogue et renforcement des capacités des autorités locales et régionales
des pays partenaires de l’UE dans les domaines du développement et de la gouvernance locale
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE)
Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
Association française du CCRE (AFCCRE)
Agence pour la coopération internationale de l’Association des Communes Néerlandaises (VNG International)
Association suédoise des autorités locales et des régions (SKL)
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP)
Cités Unies France (CUF)
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)
Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE)
Association internationale des maires francophones (AIMF)
Forum des administrations locales du Commonwealth (CLGF)
Ville de Paris
Province de Barcelone
Régions Unies – FOGAR
Avertissement : La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de
la publication, relève de la seule responsabilité de PLATFORMA et du CLGF, et ne peut être
considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.
Design : acapella.be – Printing : Daddy Kate – Photo : EuropeAid Photo Library
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution 4.0 International.

3
Sommaire
INTRODUCTION 4
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL EN AFRIQUE, UNE LONGUE GESTATION 5
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL : PRINCIPES DIRECTEURS, ACTEURS, ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
7
Les acteurs du processus de DEL 8
Les étapes de la mise en œuvre du DEL 9
LA MISE EN ŒUVRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL EN AFRIQUE 11
Analyse de l'environnement national du DEL 11
Analyse des processus de développement économique local 14
Leçons tirées pour une meilleure efficacité de l'Aide Publique au Développement 20
RECOMMANDATIONS POUR LES DÉBATS 22
BIBLIOGRAPHIE 25

4
1. INTRODUCTION
Vaste réforme institutionnelle, la plus importante depuis les indépendances selon de nombreux analystes, la décentralisation
est aujourd’hui une lame de fond qui couvre les 31 millions km2 de l’Afrique et son milliards d’habitant. Conçu comme étant
une stratégie politique de fourniture de services publics locaux au plus grand nombre, la décentralisation est confrontée à
deux défis : la croissance rapide de la population (> 2,5 % par an en moyenne) qui est par ailleurs caractérisée par son extrême
jeunesse (âge médian, 20 ans) et composée d’une mosaïque de peuples utilisant une pluralité de langues ; une urbanisation
rapide, le taux d’urbanisation se situant entre 40 à 70 %, avec un fort développement de métropoles de plus d’un million
d’habitants (au nombre de 34) confrontées, à des degrés divers, à une certaine paupérisation des banlieues, à la déficience des
infrastructures, des transports publics et de la fourniture de services urbains de base.
Le contexte économique de la décentralisation n’est pas des plus reluisants. En effet, après près de trente années de mise en
œuvre des politiques d’ajustement structurel, les pays africains retrouvent une santé financière avec un taux de croissance
annuel positif situé entre 4 % et 6 % en moyenne. Malgré ces signes positifs, l’Afrique reste une région économiquement peu
développée : elle ne représente que 2 % du commerce mondial et ne capte que 3 % des investissements directs étrangers (alors
qu’elle représente 15 % de la population mondiale). Sur les 47 pays les moins avancés identifiés par les Nations unies de par le
monde, 18 sont situés en Afrique subsaharienne. Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) n’a pas
encore été en mesure de drainer des flux significatifs d’aides et d’investissements vers le continent ni de mobiliser l’épargne
africaine dont les experts estiment que 40 % s’investissent hors d’Afrique. Toutefois, certaines dispositions prises par la com-
munauté internationale, notamment l’initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE), devraient permettre d’accroître les
capacités financières et d’intervention des pouvoirs publics et des collectivités locales de certains pays, en particulier dans la
lutte contre la pauvreté, l’accès aux services et l’amélioration des conditions de vie des populations. Mais la crise financière
qui s’est installée depuis 2008 et ses conséquences sur l’économie réelle ont fragilisé la base économique de bien de pays.
Les fluctuations récurrentes du coût des matières premières ainsi que certains chocs naturels (inondations, sécheresses,
etc) ont annihilés bien d’efforts de développement dans de nombreux pays africains.
Le contexte politique de la décentralisation n’est pas non plus des plus positifs. Certes on note une progression impor-
tante du nombre de régimes politiques démocratiques sur le continent, contrairement à ce qui se passait au cours des
deux décennies qui ont suivi les indépendances, mais les coups d’Etat existent encore. Les pays « fragiles » connaissant
une instabilité politico-institutionnelle sont encore trop nombreux au goût des africains : en Afrique centrale (Répu-
blique démocratique du Congo, Centrafrique, Tchad), en Afrique de l’Ouest (Mali, Côte d’Ivoire, Liberia, Guinée- Bissau,
Sierra Leone, Togo) et en Afrique de l’Est (Ethiopie, Erythrée, Somalie, Soudan). De manière générale, les systèmes politiques
consacrent le multipartisme et le suffrage universel comme modalités du choix des dirigeants même si cette règle n’est pas
générale en ce qui concerne les élus locaux. Dans certains pays encore, on, assiste à des situations où les dirigeants locaux sont
nommés par le pouvoir central et où le cycle des élections locales est interrompu souvent durant de longues années. Cepen-
dant, la décentralisation est renforcée par la logique du désengagement de l’Etat et de l’administration centrale, même si cette
tendance s’avère en réalité problématique, voire contreproductif, en l’absence de transfert réel des compétences et des moyens
financiers et en raison de la persistance de l’emprise des pouvoirs centraux sur les finances et la fiscalité locales et sur les aides
et financements étrangers.
Mais indéniablement, la décentralisation a connu un saut qualitatif. Alors qu’elle était longtemps perçue comme une simple
technique administrative dans la grande majorité des Etats, et ce, pour diverses raisons historiques, politiques et sociologiques ;
elle implique aujourd’hui des pouvoirs de décision autonomes accompagnés d’une consolidation progressive de la légitimité
électorale et d’un renforcement de la crédibilité des autorités décentralisées, même si cette évolution semble contrastée et,
dans certains pays, remise en cause. D’autre part, on observe aussi un peu partout sur le continent, une croissance sensible et
continue, depuis les indépendances, du nombre des collectivités locales couvrant ainsi de plus en plus largement les territoires,
en particulier les tissus urbains africains. On observe également une diversification et une hiérarchisation plus affinée et parfois
plus complexe des structures et des échelons territoriaux de la décentralisation. De nos jours, l’Afrique compte près de 12 000
collectivités locales dont plus de 4 000 en Afrique du Nord, 3 000 en Afrique de l’Ouest, 1 000 en Afrique Centrale, 2 000 en
Afrique de l’Est et 1 300 en Afrique Australe.
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL EN AFRIQUE, MISE EN ŒUVRE, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES | 2015

5
Enfin, l’une des avancées significatives en matière de décentralisation est l’accroissement relatif des responsabilités des collec-
tivités locales dans de nombreux pays. La gamme des compétences s’est en effet étoffée progressivement : les compétences
pour lesquelles les collectivités locales agissent comme des agences de l’Etat (Etat civil, Police, Politique de développement
économique, Politique d’aménagement du territoire, Politique de l’emploi…) ; les compétences pour lesquelles les collectivités
locales jouent partiellement le rôle d’agence pour l’Etat (politiques nationales sectorielles, politiques d’équité et politiques
d’aide sociale, politique d’appui aux jeunes, aux femmes, aux retraités, aux handicapés, …) ; et les compétences propres des
collectivités locales qui étaient autrefois exercées par l’Etat et qui sont désormais transférées aux collectivités territoriales.
Parmi ces compétences, le développement économique local se positionne en bonne place dans l’action des collectivités
territoriales.
2. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
EN AFRIQUE, UNE LONGUE GESTATION
Les années postindépendances en Afrique ont été caractérisées par une gestion centralisée, macroéconomiques et sectoriel-
les. Cette gestion centralisée des politiques publiques a engendré des inégalités importantes de revenus, d’accès au logement,
d’accès aux services essentiels comme l’eau et l’électricité, la santé, l’éducation, etc. La centralisation s’est traduite par une
certaine inefficience flagrante dans la fourniture des services publics locaux pour plusieurs raisons ; coûts des services publics
locaux élevés et services publics locaux peu adaptés aux préférences des populations au niveau local. De ces deux raisons,
l’inadaptation des services publics locaux est la plus importante. En effet une uniformité de services publics locaux sur
toute l’étendue du territoire national se traduit par un gaspillage de ressources et une inefficiente allocation qui freine
le bien être national. En plus de se situer à une échelle macroéconomique, et dirigées du niveau central vers le bas, ces
politiques étaient tirées par l’offre, généralement as-spatiales, sectorielles, délivrées localement à l’échelle de quartiers,
et peu durables (à l’échelle infra communale).
Progressivement, les préoccupations locales sont apparues de plus en plus évidentes dans les différents pays. Le concept
du local prend de plus en plus de l’importance dans les stratégies de développement, et l’on commence par élaborer
des politiques qui ont une portée territoriale et spatiale. Puis dans un second temps est apparu une autre nouveauté
dans les théories et pratiques du développement ; le concept de développement participatif1. Pour beaucoup d’analystes
internationaux et africains, il s'agit de remettre en question les approches traditionnelles du développement, en particulier
leur capacité à jeter les bases d'un développement durable. Même si le degré de participation envisagé et les objectifs poursui-
vis par les agences divergent, les bailleurs de fonds tant publics que privés considèrent que la participation est davantage qu'un
moyen d'améliorer l'efficacité et d'assurer la viabilité des projets, elle constitue une fin en soi.
C’est dans cette même lignée de reformes que la décentralisation est apparue avec entre autres l’objectif d’éliminer les nom-
breuses entorses à l’élaboration et à l’exécution des politiques publiques ; à savoir l’existence de plusieurs centres de décision
qui ne sont pas toujours guidés par l’intérêt public mais qui sont par ailleurs influencés par la recherche de rentes ou par des
groupes de pression, la bureaucratie inefficace ou corrompue ou les deux, le problème lié aux relations principal – agent, etc.
C’est pourquoi, en plus de la différenciation institutionnelle, la décentralisation africaine intègre depuis le critère des élections
locales. Aujourd’hui la décentralisation est indissociable de la légitimité démocratique des autorités locales et dans tous les
pays, la mise en place de conseils locaux élus est la règle. En dehors du fait que l’élection des autorités locales fait prendre à la
décentralisation une tournure politique, cette nouvelle donne n’est pas aussi anodine qu’elle n’y parait. En effet, à partir du
moment où les autorités locales sont élues, cela implique une forme de responsabilité de ces élus locaux par rapport à leurs
électeurs. Elle fait passer le sens de la redevabilité (accountability) qui était auparavant vers l’Etat pour désormais être vers les
populations électrices.
1 Pour la Banque Mondiale le développement participatif est « un processus à travers lequel les différents acteurs influencent et partagent le contrôle sur des
initiatives de développement, des décisions et des ressources qui les concernent ». Le principal objectif de la Banque Mondiale dans sa volonté de promouvoir la
participation est d'améliorer l'efficacité et la durabilité des programmes qu'elle finance.
Le PNUD définit le développement participatif comme étant « un processus dont l'objectif est de rendre les gens capables d'initier une action pour un dévelop-
pement self-reliant et d'acquérir la capacité d'influencer et de gérer le changement dans leur société » ; Pour l'ACDI « le développement participatif se réfère à
un processus par lequel la société est activement impliquée dans toutes les phases d'une action de développement ; la Commission Européenne considère que
« le développement participatif constitue une approche globale du développement qui implique la mise en place de mécanismes visant à associer, dès le départ,
les populations aux différentes étapes du processus de développement ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%