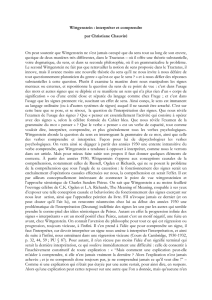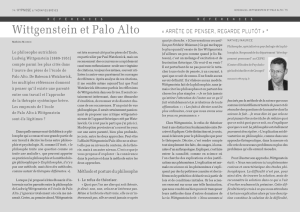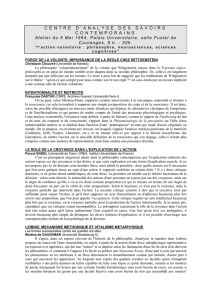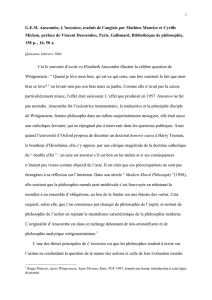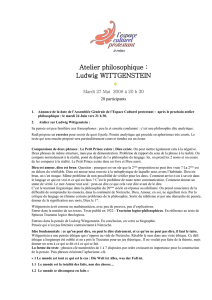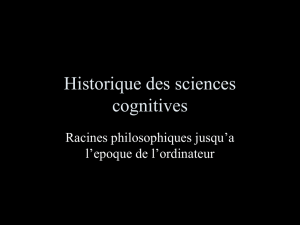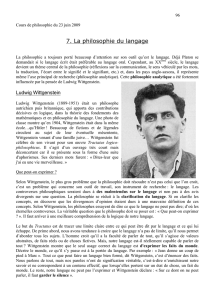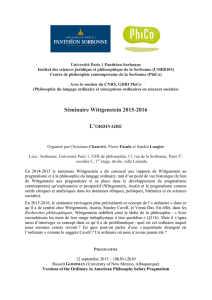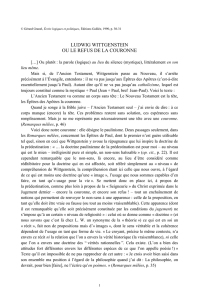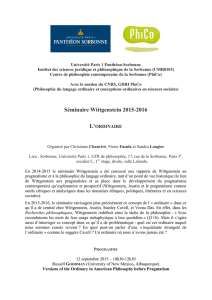La tension anthropologique

141
La tension anthropologique
Maïa Ponsonnet
(Australian National University, CREDO)
Cet article traite du rapport de Wittgenstein à l’anthropologie – non pas à
l’anthropologie en tant que discipline, mais à l’ingrédient anthropologique de sa
pensée. Bien que l’argument ouvre sur des questions relatives à la discipline
elle-même, je n’évoquerai celle-ci que très ponctuellement. Pour des raisons
conceptuelles (que l’article aborde, d’ailleurs), les arguments philosophiques se
plient difficilement à l’exercice de la référence concrète à des données
ethnographiques : la discipline philosophique, sa méthode, ses règles, ses
objectifs, se prêtent peu à l’introduction d’éléments discursifs qui revendiquent
leur référence directe au réel. Mes recherches anthropologiques et
ethnolinguistiques auprès du groupe dalabon (Australie du Nord) m’ont
toutefois donné l’occasion d’établir des liens entre des faits anthropologiques et
des questions philosophiques, ou même des questions wittgensteiniennes
330
,
mais ces articulations s’inscrivent plus facilement au sein d’arguments relevant
au départ de l’anthropologie. Toutefois, mon analyse du rôle de la tendance
anthropologique chez Wittgenstein est naturellement informée par ma pratique
de l’anthropologique et mes questionnements épistémologiques quant à cette
discipline.
Je n’aborderai pas non plus le problème, philosophique, de la croyance,
pourtant soulevé par les Remarques sur le Rameau d’or de Frazer de
Wittgenstein. Philippe de Lara offre sur cette question un panorama limpide,
fin, informé d’une connaissance pointue des théories ethnographiques
331
. Si mes
recherches ethnolinguistiques touchent de près au problème de la croyance –
puisque j’explore entre autres la sémantique et les théories de l’esprit en langue
dalabon – le format de cet article ne se prête pas à un développement construit
en la matière.
Je ne traiterai pas non plus de la question de la méthode wittgensteinienne
des « saynettes fictives », qui renvoie à l’anthropologie dans la mesure où
330
M. Ponsonnet, « Aspects of the Semantics of Intellectual Subjectivity in Dalabon (South-
Western Arnhem Land) », Australian Aboriginal Studies, 2009/1, p. 17-28 ; « Aspects of the
Semantics of Emotions and Feelings in Dalabon (South-Western Arnhem Land) », The Australian
Journal of Anthropology, à paraître.
331
Cf. P. de Lara, Le rite et la raison. Wittgenstein anthropologue, Paris, Ellipses, 2005.

Maïa Ponsonnet
142
Wittgenstein y imagine « d’autre hommes ». À mon sens, cette démarche n’est
pas réellement anthropologique. Christiane Chauviré, reprenant une expression
de Wittgenstein, parle à son sujet de la « manière ethnologique »
332
.
L’expression me semble bien choisie, car à mon sens le rapport à
l’anthropologie reste formel en l’occurrence. En effet, les phénomènes
« humains » imaginés par Wittgenstein sont bien imaginaires. Or, d’une part
l’anthropologie traite avant tout de la réalité des sociétés humaines ; et d’autre
part, y a-t-il un sens à parler de « phénomènes humains imaginaires » ? À mon
sens, il s’agit plutôt de phénomènes conceptuels (au sujet de l’humain) – et non
de phénomènes constatés parmi les sociétés humaines, objets de
l’anthropologie. Cette méthode originale soulève des questions qui pourront être
démêlées ailleurs. Mais il me semble que son rapport à l’anthropologie n’est pas
si direct qu’il n’y paraît. J’ai donc préféré écarter cette question pour l’instant.
Ma présente approche s’en tient donc à des problématiques philosophiques
liées à la dimension « anthropologique » des écrits de Wittgenstein, leur
« coloration » anthropologique si l’on peut dire. Il convient de préciser encore,
toutefois, que mes intentions ne sont pas exégétiques. Je ne cherche pas à
déterminer quelle a été la pensée de Wittgenstein à telle ou telle période. Je ne
me trouve pas en accord avec tous les principe de Wittgenstein, au contraire : et
je suis sensible à certaines tensions internes à sa propre pensée, et cette
sensibilité correspond probablement à des désaccords de fonds avec ses
propositions en philosophie. L’objectif de cet article consisterait donc plutôt à
souligner ces tensions pour mettre au jour ce qu’elles peuvent révéler au sujet
de la pensée de cet auteur d’une part, et au sujet de questions philosophiques ou
épistémologiques plus générales d’autre part.
Il est communément admis que la pensée de Wittgenstein est traversée par
une sorte de « coloration anthropologique », s’étirant, à partir de la notion
d’« homme cérémoniel » soulignée par Jacques Bouveresse
333
, à travers
l’ensemble de ce que Christiane Chauviré appelle le « moment
anthropologique » de Wittgenstein. Cet article questionne le rôle du regard
anthropologique dans la pensée wittgensteinienne, et souligne notamment
comment cette pensée se développe dans une tension avec, ou une forme de
résistance à, cette dimension anthropologique. Je commencerai par souligner, à
partir des Remarques sur le Rameau d’or de Frazer et de leur apologie de la
méthode descriptive, comment l’objet de l’anthropologie coïncide avec la
méthode de clarification philosophique défendue par Wittgenstein. Cela confère
donc aux questions anthropologiques un statut particulier. J’explorerai ensuite
332
C. Chauviré, Le moment anthropologique de Wittgenstein, Paris, Kimé, 2004, p. 7.
333
J. Bouveresse, « « L’animal cérémoniel : Wittgenstein et l’anthropologie », dans : L.
Wittgenstein, Remarques sur le Rameau d’or de Frazer, tr. fr. J. Lacoste, Lausanne, Paris, l’Âge
d’homme, 1982.

La tension anthropologique
143
ce statut, à partir des ouvrages de Philippe de Lara et de Christiane Chauviré. Le
premier indique pourquoi les questions anthropologiques constituent un noyau
de l’œuvre de l’auteur : la nature de l’homme, plus précisément ce qu’il appelle
sont instinct rituel, fournit le point d’attache qui permet de comprendre les
pratiques humaines, mettant ainsi l’accent sur un constat relativement mystique.
Dans un texte complémentaire à celui de Philippe de Lara, Christiane Chauviré
montre comment le philosophe autrichien élabore à partir de ce noyau un
paysage conceptuel riche et producteur de sens, en développant l’idée de la
grammaire, fondée par la pratique et l’accord qui s’y établit. La troisième partie
dessine un certain nombre de fils, de tensions et de résistances internes à la
pensée de Wittgenstein. D’abord, l’élaboration de la dimension grammaticale
peut être comprise comme une réponse à un constat anthropologique un peu
« court ». Ensuite, cette dimension soulève plusieurs problèmes au sein de la
pensée wittgensteinienne elle-même. Je défendrai en effet l’idée qu’avec l’idée
de la grammaire, Wittgenstein s’écarte en fait de son idéal descriptif, car
l’exercice de clarification de nos illusions métaphysiques est en fait une
démarche prescriptive. Je montrerai comment l’antidote contre ces illusions se
présente sous deux aspects, celui de la référence, anthropologique, au réel, et
celui de la grammaire, qui renie le besoin de se référer au réel. La dernière
partie examine la manière dont ces deux antidotes entrent en tension d’une avec
l’autre.
L’
ANIMAL CEREMONIEL ET LA METHODE DE LA DESCRIPTION
1. Le religieux, l’esthétique, la description
Si la question de l’anthropologie traverse l’ensemble des travaux de
Wittgenstein, son texte le plus célèbre sur cette question demeure bien sûr ses
Remarques sur le Rameau d’or de Frazer. Ces écrits ne constituent pas un texte
construit mais une série de notes, dont la première partie aurait été rédigée en
1931 et la seconde bien plus tard (en 1948). Ces remarques fournissent
néanmoins certaines clefs quant à l’intérêt de Wittgenstein pour l’anthropologie,
car elles indiquent les connexions établies par l’auteur entre les questions
anthropologiques et sa propre méthode d’investigation, celle de la description.
Bien sûr, Wittgenstein s’intéresse à l’œuvre de Frazer parce que la question
du rituel, expression d’une tendance fondamentale de l’homme, l’interpelle –
c’est un pivot crucial de l’ensemble de son œuvre. Les Remarques sur le
Rameau d’Or de Frazer nous éclaire sur le rôle de ce pivot. Dans ces écrits,
Wittgenstein s’exprime de manière particulièrement explicite quant à sa
préférence pour une approche descriptive en philosophie. L’auteur oppose ce
qu’il appelle l’explication des phénomènes humains (que sont les rituels) –
explication en termes historiques, évolutionnistes, causaux – à une appréhension

Maïa Ponsonnet
144
d’un autre ordre. Cette appréhension à laquelle Wittgenstein prête faveur est
contemplative plutôt qu’explicative : il s’agit d’observer la manière dont sont
constitués les phénomènes humains, de manière synchronique, pour saisir leur
agencement, leur structure profonde. La méthode évite les références aux
explications, qu’elles soient historiques, psychologiques ou autres : toutes
s’inscrivent en derniers recours dans la recherche des causes. Or les causes ne
nous permettent pas de saisir la profondeur des phénomènes humains, pour
lesquels les raisons se révèlent plus pertinentes. La poursuite des causes nous
égare dans un regressus à l’infini, d’une explication causale à l’autre, le long
d’une chaîne sans point d’arrêt. Pour Wittgenstein, l’attitude descriptive permet
au contraire de saisir en quoi les phénomènes rituels font sens pour, et
impression sur, les humains qui y participent. Cette appréhension s’appuie sur
des ressorts qui renvoient à l’appréhension esthétique, dans la mesure où elle
s’appuie sur l’observation synchronique de ce qui se donne à voir : il s’agit de
« présenter » le sens des pratiques, et non de les expliquer de manière
discursive.
Les préoccupations et propos de Wittgenstein quant à l’esthétique peuvent
être rapprochés des questions relevant de l’éthique et du « religieux », auxquels
l’auteur s’intéressait aussi à l’époque où il rédigeait ses premières remarques sur
Frazer, comme en témoigne sa Conférence sur l’éthique et les Conversations
avec Waismann produites autour de 1930. Ces registres ont en commun de
chercher à échapper, par des moyens différents, à l’emprise de l’explication,
c’est-à-dire à la tendance à établir des chaînes de relations causales. En réalité,
pour Wittgenstein, les « expressions éthiques et religieuses » cherchent à
échapper au langage tout court :
[…T]out ce à quoi je voulais arriver avec [des expressions éthiques et
religieuses] c’était d’aller au-delà du monde, c’est-à-dire au-delà du langage
signifiant
334
.
Pour Wittgenstein, ces élans, voués à l’échec, reviennent à « donner du front
contre les limites de notre langage »
335
. Mais il faut souligner qu’il ménage à cet
élan une place de choix dans le paysage des phénomènes humains :
[…L]’éthique ne peut pas être une science. […] Mais elle nous documente sur
une tendance qui existe dans l’esprit de l’homme, tendance que je ne puis que
respecter quant à moi et que je ne saurais de toute ma vie tourner en dérision
336
.
334
Conférence sur l’éthique, dans : LC, tr. fr., p. 154.
335
Ibid., p. 155.
336
Ibid.

La tension anthropologique
145
L’appréhension esthétique vise elle aussi cet autre registre de sens, cet au-
delà du langage : « la compréhension de la musique chez l’homme est une
manifestation de la vie en général », indique Wittgenstein dans les Remarques
mêlées
337
. Mais contrairement à la tendance religieuse, la tendance esthétique
n’est pas un échec, car l’attention à la forme, aux « physionomies », permet
effectivement de saisir leur expression sans passer par l’explication. Cette
attention au visible et au voir, pivot des Recherches philosophiques, invite à une
approche descriptive, qui fonctionne en fait selon des ressorts qui sont aussi
ceux de l’appréhension esthétique. Ainsi, toute la pensée Wittgensteinienne
s’inspire de l’expérience esthétique, car l’idée d’appréhension descriptive
synoptique d’une part, et l’appréhension esthétique d’autre part, partagent des
traits communs, s’appuient sur un même principe, celui de la présentation de ce
qui se donne à voir.
Je défends donc l’idée que, si la méthode descriptive et l’expression
esthétique parviennent à faire sens là où l’élan religieux échoue, ces trois
attitudes ont néanmoins en commun des traits fondamentaux. Elles visent toutes
les trois une dimension alternative du sens, libéré non pas du langage (ce qui est
impossible), mais de sa tendance à l’explication causale. Tendance religieuse ou
éthique, appréhension esthétique, et méthode descriptive, s’opposant toutes à
l’explication, représentent trois aspects d’une même tendance fondamentale de
l’homme qui vise au-delà de l’expression purement discursive.
2. Coïncidence de l’objet anthropologique avec la méthode wittgensteinienne
Or justement, les textes de Frazer, au sujet desquels Wittgenstein affirme si
clairement l’importance de la méthode descriptive, traitent de l’homme en tant
qu’« animal cérémoniel ». Cette expression de Wittgenstein, reprise par ses
commentateurs et notamment par Jacques Bouveresse dans son célèbre
commentaire, entend caractériser l’homme par cette tendance, cet élan de
dépassement de l’explication, évoqué ci-dessus. « C’est précisément ce qui
caractérise l’esprit humain à son éveil, qu’un phénomène devienne pour lui
important », souligne Wittgenstein dans la première partie des Remarques sur le
Rameau d’or de Frazer, juste avant d’avancer la formule de l’« homme
cérémoniel ». Attribuer de l’importance aux phénomènes, s’en « s’étonner »
(expression des Remarques mêlées), c’est-à-dire en être impressionné, au sens
esthétique, sont des tendances qui caractérisent et même définissent l’esprit
humain – c’est cela que Wittgenstein reproche à Frazer de n’avoir pas compris.
L’homme, face au monde, l’appréhende instinctivement sur un mode esthétique,
et cette manière d’appréhender le monde est ce qui définit l’homme et lui
imprime son élan religieux – comme le souligne Philippe de Lara, « il est clair
337
Cf. VB, tr. fr.. p. 84.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%