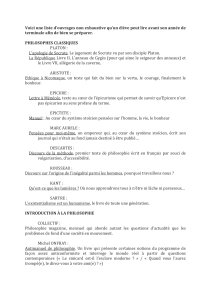version complète - Cégep de Sainte-Foy

PHILOSOPHIE ET RATIONALITÉ
340-103-04
1. Identification
Collège : Cégep de Sainte-Foy
Département : Philosophie
Identification du cours : 340-103-04 Philosophie et rationalité
Composante : Formation générale commune
Pondération : 3-1-3.
Professeur : Louis Brunet (bureau: E-310; [email protected]; tel.: 659-6600 poste 6108)
Session : Automne 2008
Disponibilité en dehors des cours : voir sur Omnivox.
2. Thématique générale du cours
Le thème général du premier cours est celui de la nature de la philosophie, de la rationalité. La
définition de la philosophie, de la rationalité, constitue le sujet principal de ce cours. La question
de ce cours est : «Qu’est-ce que la philosophie?».
3. Objectifs et habiletés, contenus et évaluation
3.1 : Objectifs
• Traiter d’une question philosophique de façon rationnelle :
1. Distinguer la philosophie des autres discours sur la réalité.
2. Présenter la contribution de philosophes de la tradition gréco-latine au traitement de
questions.
3. Produire une argumentation sur une question philosophique.
3.2 : Habiletés et contenus
Présentation du cours, de ses objectifs et de la méthode privilégiée. (1ere et 2e semaines)

1. Apprendre à décoder ce que des représentations imagées font comprendre
de la philosophie. (C1 + C4) 1
1.1 Une célèbre allégorie de la philosophie : l’allégorie de la caverne, de Platon.
Qu’est-ce qu’une allégorie ? Exploration de la caverne et de ses éléments, découverte de leur symbolisme.
Applications:
1. Ce que tente de faire Socrate avec Euthyphron et avec Hippias (dans le film de Rossellini Socrate) de
même qu’avec Lachès et Nicias (dans le film Socrate, mort ou vif, de Nicole Catellier) illustre-t-il ce qui
se passe dans la caverne ?
Comparaison avec d’autres allégories :
1. Ce que Cicéron rapporte concernant Pythagore et l’invention du mot philosophie rejoint-il le message
de l’allégorie ? Sa comparaison avec ce qui se passe aux jeux olympiques donne-t-elle une meilleure
image de la philosophie ?
2. Ce qu’on pourrait appeler «l’allégorie de la lecture d’un roman à mystère» imaginée par Einstein et
Infeld (L’évolution des idées en physique) donne-t-elle une image de la science apparentée à celle d’une
sortie de la caverne ?
Actualisation et objection :
1. La déclaration de Paris (à l’occasion du colloque «Philosophie et démocratie» organisé par l’Unesco)
rejoint-elle le message de l’allégorie ?
2. Ce que Alexis de Tocqueville fait comprendre concernant la nécessité de ce qu’il appelle les «croyances
dogmatiques» est-il compatible avec le message de Platon ?
1.2 La matrice (Matrix) : un film philosophique ? (3e et 4e semaines)
En quoi le film La matrice pourrait-il être qualifié de philosophique?
Un questionnement dans le prolongement du film : «Que pouvons-nous savoir ?». La lecture de «Doutes
sur notre connaissance de la réalité extérieure» et «Pensées sur la connaissance de la réalité» (dans Débats
philosophiques – Une initiation, de Laurent-Michel Vacher) donnera un avant-goût de l’aventure
philosophique, par une initiation au débat philosophique.
(C1+C11)
2. Apprendre à dégager ce que la lecture de dialogues de Platon fait
comprendre d’important concernant le philosophe et l’activité
philosophique.
(5e et 6e semaines)
Ce que la lecture de l’Hippias majeur révèle, par le contraste entre Hippias et les anciens sages, du
philosophe et de sa motivation de vie.
Ce que cette lecture révèle concernant les attitudes favorables ou défavorables à la recherche du savoir.
Ce que cette lecture révèle de l’activité philosophique et de sa méthode.
Approfondissement, à l’aide d’un texte contemporain (Marc Le Ny, Opinion, connaissance et vérité,
chapitre «Croire et savoir»), de notions importantes pour comprendre Socrate et la philosophie : dialogue,
vérité, rationalité, connaissance, opinion, étonnement.
(C1+C4)
1 Les cotes renvoient aux critères de performance minimaux établis par le département et qui précisent les critères de performance
du Ministère que vous trouvez dans le document que vous avez reçu par le Collège.
2

Retour réflexif sur les actes de la raison représentés dans ce dialogue : définir, raisonner, contredire. Les
instruments logiques impliqués : la définition, l’exemple, l’énonciation, la contradictoire, le raisonnement,
l’objection. (C5+C6+C7+C8+C10)
Un film contemporain, Douze hommes en colère, donne aussi, à sa façon, une représentation de l’activité
de la raison qui donne beaucoup à réfléchir sur les attitudes favorables ou défavorables à la recherche de la
vérité.
Retour réflexif sur les actes de la raison représentés dans le film : persuader, raisonner en apparence. Les
instruments logiques impliqués : le raisonnement rhétorique, le sophisme. (C6+C7+C8+C10)
(7e semaine)
Ce que la lecture du début de l’Euthyphron, un autre dialogue de Platon, révèle quant à l’importance de la
philosophie et ses liens avec la vie concrète des hommes. (C4)
Approfondissement, à l’aide d’un texte contemporain (Marc Le Ny, Opinion, connaissance et vérité,
chapitre «Pourquoi la vérité ?», sur les rapports parfois difficiles entre le projet philosophique et
l’existence pratique.
Retour réflexif sur les actes de la raison représentés dans l’Euthyphron : saisir l’essence d’une chose,
connaître une chose à travers ses «accidents», définir avec précision, énoncer clairement, raisonner à partir
d’opinions admises. Les notions logiques impliquées : l’essentiel et l’accidentel, les lois de la définition, le
syllogisme dialectique. (C5+C8)
(8e et 9e semaines)
Ce que la lecture de l’Apologie de Socrate révèle de Socrate, des accusations contre lui, de sa défense lors
de son procès ; ce qu’on y apprend d’essentiel concernant l’activité philosophique, ses difficultés et ses
exigences.(C1+C4)
Retour réflexif sur les actes de la raison représentés dans l’Allégorie : raisonner à partir du semblable,
passer à l’universel à partir des cas singuliers, déduire, tirer une conséquence absurde de la position
adverse. Les instruments logiques impliqués : le raisonnement analogique, l’induction, la déduction, la
réduction à l’absurde. (C8+C9)
Bilan de la contribution de Socrate et de Platon. (C4)
3. Apprendre à distinguer la philosophie des autres façons de rendre compte
de la réalité.
2.1 La distinction entre mythologie et philosophie, dans le contexte des débuts historiques de la
philosophie. (10e et 11e semaines)
Vue d’ensemble de la philosophie grecque, à partir du documentaire Histoire du monde, Grèce antique,
Pensée et philosophes.)
Retour sur ce qu’on y apprend concernant la philosophie et son histoire, sur le contexte socio-historique et
sur la distinction entre la philosophie et la mythologie. (C1+C2+C3 + C4)
Retour sur l’Euthyphron de Platon : ce qu’on y apprend sur ce qui distingue l’homme du mythe et le
philosophe. (C2 + C4)
3

Thalès, le premier philosophe : qu’a-t-il fait de nouveau et de différent, par rapport à ce qui se faisait avant
lui, pour être considéré tel ? (C2+C4)
Actualisation de cette distinction : le mythe a-t-il perdu sa place dans notre pensée ? Serge Carfantan
(«Science, mythe et philosophie») ouvre le débat.
Retour réflexif sur les actes de la raison sous-jacents au discours de Carfantan : problématiser, distinguer
les sens d’un mot, énoncer les propriétés d’un sujet, démontrer, s’appuyer sur des opinions qui font
autorité, réfuter. Les instruments logiques impliqués : l’argument pour et contre, le mot analogue, la
propriété, le syllogisme, le syllogisme démonstratif, le syllogisme dialectique, la réfutation. (C8+C9+C10)
2.2 La distinction entre religion et philosophie. (12e et 13e semaines)
Religion et philosophie sont-elles compatibles ? Ont-elles des choses en commun ? Qu’est-ce qui les
distingue ? Un texte de Guy Maximilien («Philosophie et religion») servira d’amorce au débat. (C2)
Retour sur les actes de la raison sous-jacents au discours de Maximilien : faire connaître un sujet à partir
de prédicats qui en révèlent l’essence ou les accidents. Les instruments logiques impliqués : les
prédicables (genre, différence spécifique, espèce, propre, accident), la définition par genre et différence.
(C5)
Un extrait des Confessions de saint Augustin (sa fameuse réflexion sur le temps) permettra d’observer
l’activité philosophique intense d’une personne intensément croyante, de se questionner sur les rapports
entre la foi et la raison et de réfléchir à ce qui s’est produit dans l’histoire de la philosophie en Occident
suite à l’avènement du christianisme. (C2+C4)
2.3 La distinction entre science et philosophie. (14e et 15e semaines)
À partir d’une interrogation sur les origines de la science et sa naissance (Warren Murray), on pourra
mieux comprendre ce qui unit et ce qui distingue la philosophie de la science expérimentale.
Un texte de Pierre Wagner (Les philosophes et la science) aidera par ailleurs à comprendre que la
distinction entre science et philosophie n’a pas toujours été évidente...
(C2)
3.3 : Méthodes pédagogiques
Lectures préalables aux cours, questionnements, exposés, discussions, débats, exercices, tout ce qui peut
favoriser la réflexion philosophique sera mis à contribution. La présence en classe et la participation de
l'élève est indispensable. Il est responsable des lectures obligatoires. Il est responsable de partager son
questionnement et ses intuitions avec les autres. Il doit faire assidûment les travaux et bien se préparer aux
examens.
3.4 : Activités d’évaluation
L’évaluation formative
Pour ce cours, l’évaluation formative est constante et étalée sur l’ensemble de la session. Elle
se présente sous forme d’exercices, de discussions dirigées, de tests de lecture, de courts
résumés ou de réponses brèves à des questions préparatoires au cours. La correction de ces
activités formatives est effectuée en classe ou par le biais d’annotations indiquant dans quelle
mesure les apprentissages du cours sont en bonne voie d’intégration. Pour stimuler une
participation assidue à ces activités formatives, assurer la constance au travail et ainsi garantir
4

une bonne préparation aux examens et au travail de rédaction, j’accorde 10% de la note finale
à ces activités.
Une évaluation formative formelle aura lieu le 15 ou 16 septembre, de façon à permettre à
l’étudiant d’évaluer s’il est à risque avant la date d’abandon de cours.
L’évaluation sommative
Pour ce cours, l’évaluation sommative comporte quatre moments forts : trois examens,
réalisés en classe, et la rédaction d’un texte argumentatif d’au moins 700 mots, qui doit être
rédigé à la maison.
Le tableau suivant indique les critères de performance et les éléments de contenu visés par
chacune des évaluations sommatives:
évaluation date Contexte de réalisation pondération
Habiletés et contenus
visés
Examen de
mi-session 10 octobre En classe 30 points C1+C4+C5+C6+C7+C8+
C10
Travail long À remettre au plus tard
le 24 novembre À la maison
25 points C11
Examen final En fin de session
En classe 35 points C1 à C10
Ateliers
d’aide à la
réussite
Voir l’horaire des
ateliers sur le site du
département de
philosophie
Possibilité de
se procurer
jusqu’à 5
points bonis
(voir les
modalités sur
le site)
Travaux
courts 10 points pour
l’ensemble
Toutes les évaluations sont faites à partir des balises que vous retrouvez dans le document
remis par le Collège.
Pour les examens, l'usage du dictionnaire, du Bescherelle ou d'une grammaire n'est pas autorisé.
Les questions d'examen ne sont jamais identifiées à l'avance. L'enseignant peut cependant, s'il le juge
pertinent, fournir à l'avance une banque de questions ou un mémo pour aider l'élève à se préparer à
l'examen.
5
 6
6
1
/
6
100%