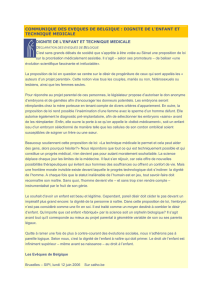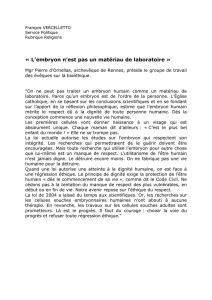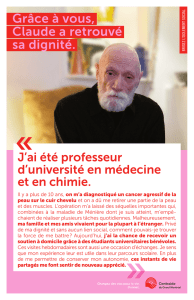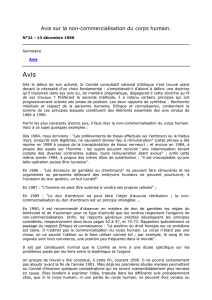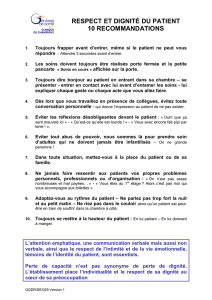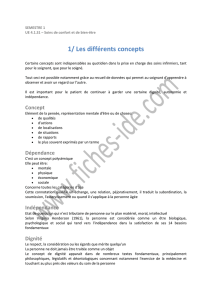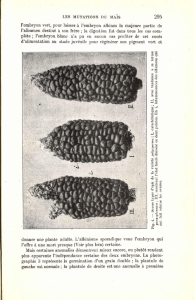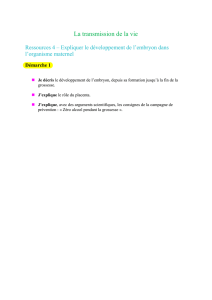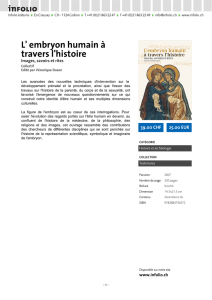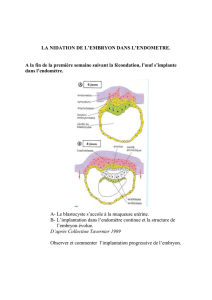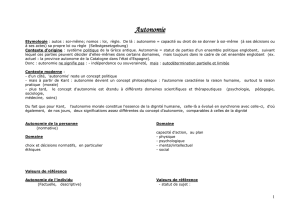Dignité de l'embryon humain: Article de bioéthique

LA DIGNITÉ DE L’EMBRYON HUMAIN
par
Léon CASSIERS
Professeur émérite
à l’Université catholique de Louvain,
Président du Comité consultatif de Bioéthique
Introduction
La question de la dignité que nous devons reconnaître à l’em-
bryon (
1
) humain est difficile, les enjeux scientifiques et économi-
ques qui y sont liés étant considérables. De nombreux progrès dans
le domaine de l’infertilité ont été acquis et continueront d’être
acquis par des recherches qui, à un moment donné, ont concerné des
embryons humains. Dans l’avenir on espère des cellules souches,
dont les embryons sont une des sources possibles, qu’elles permet-
tront de régénérer divers organes adultes malades. L’embryon offre
également un des accès possibles à la génétique et, par là, à la guéri-
son de maladies héréditaires, voire à la réalisation de médicaments
entièrement neufs. Toutes ces perspectives, même si elles restent
aujourd’hui encore largement aléatoires, engendrent d’innombrables
pressions visant à considérer l’embryon humain, dans la mesure où
il serait destiné à la recherche, comme un banal matériel biologique.
Contre ces pressions s’élève la voix de ceux qui voient d’abord
dans cet embryon une vie humaine commençante, à protéger avec
d’autant plus de soin qu’elle est plus fragile. A défaut, pensent-ils,
nos sociétés régresseraient gravement quant au respect, qu’elles
défendent par ailleurs, de toute vie humaine. Pour être moins immé-
diatement matériel, cet enjeu ne pèse pas moins lourd que les précé-
dents. Le respect de tout humain est une valeur qui fonde la vie
sociale et nous protège tous. Il n’existe que signifié par des règles
exigeantes et rigoureuses qui, toutes ensemble, en créent la réalité
et la perception par tous. A leur apporter des exceptions, ne risque-
(1) Selon un usage fréquent, nous réserverons le terme ‘embryon’ aux quatorze
premiers jours du développement, et de ‘foetus’ au-delà de cette période. Cette dis-
tinction peut varier selon les auteurs.

t-on pas d’affadir cette valeur de respect que les citoyens se doivent
entre eux? Nombreux sont ceux qui craignent que toute entorse ou
exception mise à ces règles ne soit un premier pas, ou un pas de
plus, vers la chosification, voire la commercialisation de l’humain.
La gravité de ces enjeux avive les passions dans les débats concer-
nant le statut plus ou moins humain de l’embryon. Comment trou-
ver un terrain qui nous assure une réflexion rigoureuse et honnête?
I. — L’héritage philosophique
et théologique classique
Une des grandes traditions occidentales est de faire confiance à la
rationalité de notre esprit pour garantir l’objectivité de nos juge-
ments et de nos choix. C’est ainsi sur la pensée philosophique, puis
théologique, que s’est appuyée l’éthique en occident.
Les philosophes se sont d’abord souciés de définir le statut de
l’humain adulte : plus qu’une chose ou un animal, mais moins qu’un
pur esprit, ange, diable ou Dieu. Animal par son corps, l’homme est
« animal raisonnable » par sa conscience réflexive. Il est capable de
se savoir existant et de se prendre comme objet de sa réflexion. Sur-
plombant de la sorte par sa pensée l’espace et le temps dans lesquels
il reste cependant immergé, il se donne une permanence, une iden-
tité stable, de quelque manière « méta-physique ». Il lui paraît évi-
dent dès lors de se reconnaître un « esprit », une « âme » qui désigne
cette constance du « Je » à partir duquel il se parle.
La tradition théologique chrétienne n’a pas manqué de s’appuyer
sur cette dimension « métaphysique » de l’esprit humain pour lui
rattacher, voire y assimiler une vie spirituelle donnée par Dieu.
Acceptant ou non cette référence à Dieu, l’immense majorité des
philosophes ont vu et voient encore dans la conscience réflexive
l’apanage spécifique de l’homme, la ‘fonction’ psychique par
laquelle il est capable de liberté, de choix moraux, de responsabilité,
et de ce fait titulaire d’une dignité spécifique qui, selon la formula-
tion de Kant, oblige à le traiter toujours aussi comme une fin et non
pas seulement comme un moyen.
Il n’est pas difficile de voir que cette manière de fonder la dignité
humaine n’apporte pas de réponse à la question de la dignité
humaine de l’embryon ou du foetus, ni même du nouveau-né, qui
ne disposent pas d’une conscience réflexive ni d’une véritable auto-
nomie psychique. Cependant, il est évident que l’enfant né vivant
404 Rev. trim. dr. h. (54/2003)

et viable porte en lui la potentialité de devenir une personne adulte,
s’il est convenablement pris en charge. Ainsi, très rapidement et de
manière croissante au fil des siècles a-t-il été considéré comme équi-
valent à une personne humaine à part entière, ayant droit au même
respect.
Le statut de l’embryon et du foetus a posé plus de problèmes, en
raison du caractère énigmatique du développement d’une nouvelle
vie humaine depuis l’union féconde de l’homme et de la femme jus-
qu’à l’apparition du nouveau-né. A quel moment le fruit de cette
union se distinguait-il de la vie viscérale de la femme? La théologie
morale s’y est intéressée pour distinguer l’avortement tardif comme
meurtre de l’avortement précoce, délictueux sans doute, mais moins
grave qu’un meurtre. La question de « l’animation » de l’embryon ou
du foetus a fait l’objet de nombreuses considérations, cette « anima-
tion » traçant la frontière entre le « foetus informis »etle«foetus for-
matus ». A la suite des idées déjà émises à ce sujet par Aristote,
St-Thomas d’Aquin a fixé cette frontière à cinquante jours pour le
garçon et nonante jours pour la fille. Au-delà de ces délais, le foetus
devait être considéré comme l’équivalent en dignité d’un nouveau-
né, et donc d’une personne à part entière.
Le progrès des connaissances biologiques nous permet aujourd’hui
de fixer le commencement d’une vie distincte de celle des parents
au moment de la fusion des gamètes, c’est-à-dire au moment de la
fusion des patrimoines génétiques masculin et féminin au sein de
l’ovule fécondé. Tout naturellement la théologie catholique et les
philosophes d’inspiration chrétienne ont donc fait remonter à ce
stade l’apparition d’une nouvelle « personne » humaine, titulaire de
tous les droits de celle-ci même si cette personne n’est encore que
« potentielle » (
2
). On comprend sans peine que, pour cohérente
qu’elle soit d’un point de vue logique, cette position interdit toute
expérimentation sur les embryons humains et suscite ainsi de vives
résistances.
Léon Cassiers 405
(2) Le concept de ‘personne potentielle’ a pris une large place dans les discussions
autour de l’embryon, depuis que le Comité consultatif national d’éthique français l’a
utilisé dans son avis du 15 décembre 1986 : ‘Avis relatif aux recherches sur les
embryons humains in vitro et à leur utilisation à des fins médicales et scientifiques’.
Signalons à ce propos également le Warnock Report britannique (1985) ‘A question
of life, The Warnock report on human fertilisation and embryology’, qui utilise le terme
de ‘personne en devenir’.

II. — Une approche objective « scientifique »
Pour sortir de cette impasse, un certain nombre de scientifiques
et de penseurs, même chrétiens, ont interrogé les divers stades de
développement que présente un embryon dans l’espoir d’y trouver
une frontière déterminante qui fixerait le moment où cet embryon
deviendrait « humain ». L’idée est la même, en quelque sorte, que
celle de distinguer le moment de « l’animation » de l’embryon, mais
en s’efforçant de la fonder sur des données objectives.
Une des caractéristiques de la personne humaine est qu’elle est
originale, une et indivisible. Certains ont ainsi proposé qu’aussi
longtemps que chaque cellule de l’embryon, détachée des autres,
restait capable de donner à elle seule un nouvel embryon, l’ensemble
embryonnaire ne devait pas être considéré comme un véritable indi-
vidu. (±14 premiers jours — McCormick). D’autres (Singer et
Khuse) estiment qu’un trait nécessaire pour qu’il y ait un sujet
humain est qu’il soit capable d’un minimum de perceptions, les-
quelles demandent la présence d’un début au moins de système ner-
veux. Celui-ci apparaît, dans ses premiers linéaments, entre le qua-
torzième et le vingt-huitième jour. D’autres encore (B. Brody) font
le parallèle avec la mort cérébrale : comme la mort est déterminée
par l’absence de toute activité électrique cérébrale, ainsi le début de
la vie (humaine) commencerait avec celle-ci, soit ±six semaines
après la conception. Dans la même ligne de pensée, on pourrait
prendre comme signe de vie humaine les premiers mouvements du
foetus, ou encore le moment où il devient capable de vie autonome
hors de l’utérus maternel, etc.
Ne fut-ce que par leur multiplicité, ces propositions ne nous sor-
tent pas de l’impasse : pourquoi choisirions-nous un de ces repères
plutôt qu’un autre? Mais elles ont ceci d’intéressant que par leur
arbitraire même, elles nous montrent une faille de ce type de raison-
nement. Ces propositions, comme la précédente qui fait débuter la
vie humaine à la fécondation, rattachent le concept de « vie
humaine » à son seul support physiologique. C’est la matérialité de
la fusion chromosomique, ou de l’inséparabilité des cellules, ou des
premiers neurones, etc. qui entraîne, comme une nécessité logique,
que nous admettions qu’il y a là désormais un nouvel être humain
qui doit être traité avec toute la dignité qui revient à une personne
à part entière. Sous son apparente évidence, ce type de raisonne-
ment méconnaît tout à fait que la notion de « personne humaine »
affectée de « dignité » est en réalité une création éthique d’ordre
culturel qui ne surgit pas de manière obligée de la « nature » physi-
406 Rev. trim. dr. h. (54/2003)

que des « objets » auxquels nous attribuons cette dignité. Ainsi, dans
certaines cultures, les vaches sont-elles sacrées; dans la nôtre, les
animaux vertébrés ont assez de « dignité » pour faire l’objet d’un
protection légale contre la maltraitance. Et dans presque toutes les
cultures que nous pouvons connaître, les cadavres humains ne peu-
vent pas être « profanés » alors qu’ils ne sont plus, quant à leur
nature physique, des « vies humaines » et encore moins des « per-
sonnes humaines ». Ces quelques exemples suffisent pour com-
prendre qu’il y a quelque chose d’erroné ou d’excessif à vouloir lire
dans la nature objective de l’embryon ou d’un de ses stades le seul
ou l’inéluctable fondement du respect que nous lui devons.
III. — Un renversement vers le culturel
Forts des considérations qui précèdent, certains sont tentés de
renverser la problématique de la dignité due à l’embryon en la liant
toute entière aux intentions des adultes qui les manient. L’embryon
n’est une « personne potentielle », équivalente à une personne
humaine, que parce que les adultes actuellement présents dans la
société lui donnent éventuellement ce statut. C’est-à-dire, in fine,
parce qu’ils ont l’intention d’en faire une personne humaine. Non
soutenu par une telle intention, l’embryon ne deviendra jamais une
personne. Sa « potentialité » humaine est ainsi entièrement suspen-
due aux projets auxquels les adultes présents le destinent.
Un embryon en éprouvette qui fait l’objet d’un projet parental
est ainsi à respecter dès sa conception au titre de l’enfant — puis
de l’adulte — qu’on espère qu’il deviendra. Mais lorsqu’il ne fait
plus l’objet d’un projet parental, comme par exemple les embryons
surnuméraires de la fécondation in vitro, les parents eux-mêmes
trouvent assez évident d’accepter qu’il soit décongelé et donc
détruit. Totalement précieux aussi longtemps qu’il faisait partie de
leur projet de parentalité, une fois celui-ci réalisé, il n’est plus qu’un
des éléments qui ont été nécessaires à la réalisation de ce projet,
mais n’a plus de véritable statut humain.
Dans la ligne de ce raisonnement, assez évident pour la plupart
de nos esprits, pourquoi ne pas consacrer à la recherche — d’ailleurs
rapidement suivie de destruction — ces embryons surnuméraires
plutôt que de les détruire simplement? Ceci d’autant plus que la
recherche, en vertu des maux qu’elle permettra de soulager dans le
futur, est en soi une activité éthiquement légitime sinon même
nécessaire.
Léon Cassiers 407
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%