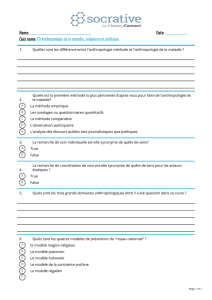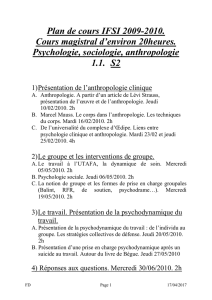l`alimentation, fait total de la societe de communication planetaire1

1
L’ALIMENTATION, FAIT TOTAL DE LA SOCIETE DE
COMMUNICATION PLANETAIRE
1
Paul Rasse, Frank Debos
Si l’Anthropologie s’intéresse aux sociétés disparues, c’est moins pour leur économie interne,
domaine de l’Ethnographie, ou pour leur propre histoire et les relations qu’elles entretiennent
avec leurs voisins, domaine de l’Ethnologie, que pour ce qu’elles nous enseignent sur
l’histoire de l’humanité tout entière et sur le mouvement des civilisations ; depuis les premiers
chasseurs cueilleurs, vivants en clan isolés les uns des autres par le désert, la mer, la jungle ou
la forêt amazonienne et par la guerre perpétuelle qu’ils se livrent entre eux, jusqu’à notre
civilisation mondiale, pétrie par l’essor des moyens des communication, brassant les hommes
et les cultures comme jamais auparavant. Autrement dit, si l’on accorde à l’anthropologie
culturelles les objectifs que lui assignent Lévis Straus et Héritier d’engager une réflexion sur
les principes qui régissent l’agencement des groupes et la vie en société sous toutes ses formes
et à toutes les époques, on voit se dessiner la perspective d une anthropologie culturel de la
communication qui utilise les connaissances accumulées sur les mondes éteignent pour penser
les mutations actuelles liées à l’essor de moyens de communication
2
. En effet, l’anthropologie
constitue un formidable panoptique du savoir, au sens ou l’entendent Foucault ou Latour, a
mobiliser pour donner du relief à notre monde actuel écrasé par l’uniformisation des modes de
vies. À partir de matériaux accumulés par elle sur l’histoire des civilisations, elle peut nous
permettre de prendre la mesure de mouvements imperceptibles et de présager de leurs
conséquences, là où on ne les attendait généralement pas. Là, une ethnographie de terrain
rencontre une anthropologie qui se souvient des mondes éteint, qui utilise le matériel
accumulé par les ethnologues sur une multitude de sociétés et de civilisations disparues pour
penser les mutations, leur donner du relief, prendre la mesure de ce qui se perd, de ce qui
s’invente, et de ce qui peut se comparer et s’interpréter à la lumière de pratiques séculaires
aujourd’hui abandonnées.
L’alimentation est un bel objet pour ressaisir les mutations du monde liées à l’essor des
processus de communication. L’anthropologie, qui se souvient de la diversité des sociétés
disparues et garde la trace des anciennes matrices culturelles qu’elles constituaient, nous
permet permettent de mettre en évidence quelques caractéristiques de notre modernité,
notamment les processus de fluidification et d’uniformisation des modes de vie, pour
accélérer la circulation des individus dans les réseaux formatés.
1
Cet article est, en partie, issu d’un chapitre de livre publiées in Paul Rasse, La rencontre des mondes, Diversité
culturelle et communication, Armand Colin 2006.
2
Levi-Strauss Claude, Anthropologie structurale, Presses pocket, 1990 (1
ère
édition chez Plon 1958), p. 411 et
suivantes. Le point de vue à été repris plus récemment par Françoise Héritier in : Héritier Françoise, Masculin /
féminin, la pensée de la différence, Ed. Odile Jacob 1996, p.32 et suivantes

2
Unité et diversité des pratiques alimentaires
L’alimentation ne peut se réduire à la couverture de simples besoins physiologiques
3
, les
pratiques qu’elles suscitent constituent un élément essentiel de la diversité des cultures.
L’ingestion de nourritures crues ou cuites, grillées, bouillies, revenues, amères ou douces,
sucrées ou salées, revêt une forte charge symbolique, qui suscite plaisir ou dégoût et
s’accompagne de multiples croyances, tabous ou injonctions. Dans les sociétés traditionnelles,
les repas réactualisent quotidiennement la complexité des formes d’organisation sociale ayant
conduit à produire et à préparer les aliments servis à ce moment-là. Ils cristallisent les
rapports sociaux, les jeux de pouvoir ; on y restaure la place des uns et des autres dans la
société, les clivages hommes et femmes, parents et enfants, maîtres et sujets ; on y affirme son
statut et on s’y donne en représentation s’il y a des hôtes ; on y règle la vie sociale, la
coordination des tâches au quotidien. La société y assume son existence et son économie
interne. On y partage les fruits du travail collectif, des communautés familiales arc-boutées
sur un territoire pour produire tant bien que mal les éléments nécessaires à leur existence.
Chacune, en chaque endroit, s’ingénie à en tirer le meilleur parti, en fonction des possibilités
climatiques et géophysiques, en fonction de son expérience, de son inventivité, de ses
croyances. Vaille que vaille, aurait dit Braudel, en ne comptant jamais que sur ses propres
forces. Va pour la belle saison et les moments d’abondance, mais il faut encore assumer les
périodes de disette, les hivers interminables, ailleurs la sécheresse ou les automnes pourries
qui vident les greniers et limitent considérablement les possibilités de varier les repas.
Car à partir du moment où l’homme se sédentarise, où il renonce à son errance sans fin de
chasseur cueilleur toujours en quête de nourriture, il n’a plus le choix, l’espace se referme sur
lui, il devient prisonnier du milieux qu’il habite, du territoire où il s’est installé, il doit
produire l’essentiel de ce qui est nécessaire à son existence quotidienne en exploitant au
mieux les ressources du milieux qu’il habite désormais. Et l’on ne vit pas de la même façon
selon que l’on s’est installé au bord de la mer ou à l’intérieur des terres, dans des zones
clémentes, fertiles et arrosées, où arides et désertiques. Dans l’identité de la France, mais
aussi dans ses ouvrages consacrés à la méditerranées, Braudel raconte longuement comment
la diversité des milieux à forgée la diversité des cultures. L’alimentation en ce qu’elles
cristallise les façon de vivre ensemble est bel exemple de ces caractéristiques et leur
mutations.
Les comportements alimentaires des sociétés traditionnelles relèvent de ces phénomènes que
Marcel Mauss qualifie de « fait social total », qui ne peuvent s’appréhender que par une
approche holiste prenant en considération la société dans sa globalité. Et cela permet de mieux
comprendre comment la diversité des sociétés dispersées de par le mondes a produit
l’immense diversité des pratiques alimentaires qui ont tant intrigué et fasciné les voyageurs,
avant que les ethnologues ne s’efforcent de les recenser, comme un traits caractéristiquement
3
Martine Garrigues-Cresswell, Marie Alexandrine Martin, « L’alimentation entre mondialisation et pratiques
identitaires », Techniques et cultures, n° 31-32, janvier-décembre 1998, p. 1.

3
des sociétés étudiées. Mais attention ! la diversité n’est pas fantaisie, elle ne s’appréhendent
qu’au plan global, car au plan local au contraire, l’alimentation met en jeu, pour chaque
société, des règles stables, des rituels, des formes d’organisation bien spécifiques, toutes liées
entre elles, et qui jusque-là évoluaient peu, car même si elles pouvaient changer en fonction
des activités du moment, du rythme saisonnier, de l’alternance des fêtes, elles revenaient dans
un ordre immuable.
Dynamique et limites des échanges dans les sociétés traditionnelles
Si les pratiques alimentaires doivent probablement, aujourd’hui, se penser à l’échelle d’une
société planétaire, elles étaient jusque-là l’expression de microsociétés, isolées les unes des
autres, contraintes à l’autarcie ; ce qui pour autant ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu
d’échanges entres-elle
Les plantes, les graines, les animaux domestiques, comme les savoirs et les religions voyagent
lentement, mais ils voyagent. À la différence des denrées alimentaires, qui une fois
consommées doivent être réapprovisionnés, ce qui les réservait aux plus puissants, les
espèces, les semences une fois adaptées font souches et se reproduisent sur place. Même
quand les contacts entre les sociétés sont rares, et même quand certaines s’efforcent d’en
garder le secret, à la fin, un jour, il leur échappe et les voisins adoptent les nouveaux éléments
tant bien que mal, souvent avec réticence, avant qu’ils ne s’imposent, au final, s’ils leur
permettent de mieux vivre.
À survoler l’histoire de l’humanité, on voit bien qu’il n’y a pas d’élément original
caractéristique de l’alimentation de telle nouvelle société, toutes les cuisines sont faites
d’emprunts continuels aux unes et aux autres, mais chaque fois refondus dans un contexte
culturel et environnemental. Ainsi les agrumes sont-ils arrivés depuis l’Inde, à partir d’un
citron, le cédrat. Au Moyen-Âge, nous dit Aymard, l’Europe emprunte au Proche-Orient les
asperges, les laitues, les aubergines, les courges et les melons, les poires et les prunes, les
pêches, la canne à sucre et le mûrier, les roses de Damas. Ils arrivent moins par les croisades,
que par les jardins des horticulteurs musulmans en Sicile et en Andalousie, qui les ont
acclimatés, en même temps qu’ils ont perfectionné les systèmes d’irrigation
4
.
La découverte de nouveaux mondes a non seulement permis la diffusion de la pomme de terre
et du maïs, mais encore de la citronnelle, de la patate douce, du piment, alors qu’inversement
le continent américain a bénéficié de la pastèque, du café originaire d’Afrique et de diverses
cucurbitacées importées d’Asie. Ainsi, par exemple, les composants de la cuisine niçoise et de
sa fameuse salade viennent des quatre coins du monde. La tomate d’abord, originaire
d’Amérique du Sud, que les conquistadors trouvent déjà acclimatée dans les jardins de
Mexico et qu’ils ramènent en Europe, où elle a bien du mal à s’imposer, en raison, dit-on, de
4
Maurice Aymard, « Migrations », in Fernand Braudel, Georges Duby (sous la dir. de), La Méditerranée, Paris,
Flammarion, 1986, p. 153.

4
sa robe rouge, diabolique, si bien qu’elle sera longtemps consommée exclusivement cuite ;
trop de superstitions l’entouraient pour oser la goûter crue. L’oignon, lui, serait parvenu du
Moyen-Orient et des côtes de Palestine, où persistent des variétés endémiques. Quant à la
fève, légume merveilleux en dépit de ses qualités gustatives et nutritives médiocres (c’est une
légumineuse qui a le mérite d’enrichir le sol, mais aussi de permettre la soudure, en
fournissant un complément nutritionnel frais au sortir de l’hiver, tandis qu’on peut aussi la
conserver toute l’année séchée et l’ajouter aux soupes), originaire d’Asie Centrale, elle était
fort appréciée des Babyloniens et des Romains. L’ail a, lui aussi, été importé par les Romains,
qui avec l’oignon le réservaient à la plèbe et aux armées. L’artichaut, gros chardon sauvage
d’Afrique du Nord, aurait transité par la Sicile à la fin de l’Antiquité ; quant au basilic,
originaire de Chine, il serait parvenu en Occident par les routes de la soie ou des épices
5
.
On oppose fréquemment cette circulation des plantes comestibles et des animaux domestiqués
aux revendications identitaires, qui font de la cuisine traditionnelle un emblème de leur
culture menacée par la globalisation. La critique n’est pas justifiée. Bien sûr, les sociétés ont
toujours emprunté aux autres, aucune n’aurait trouvé en elle, la force et l’ingéniosité pour se
débrouiller seule. Mais les apports extérieurs étaient peu nombreux, ils ajoutaient des
possibilités nouvelles, des facilités, et finissaient par vaincre les habitudes, la routine, les
craintes, jusqu’à trouver leur place au sein des cultures préexistantes. Ils les modifiaient sans
doute, mais en même temps étaient saisis par elles, car l’ensemble tient toujours mieux que
l’intrus, elles lui faisaient une place, mais au final l’entouraient. Le tout s’en trouvait enrichi,
sans pour autant se dissoudre et perdre sa cohérence. Et la cuisine y gagnait en saveurs, sans
perdre ses caractères, car la dissémination des nouveaux aliments a toujours été lente. Il a
fallu chaque fois dépasser les réticences, mais aussi acclimater les plantes et les animaux
domestiques, à force de sélection, de reproduction intuitive des éléments jugés les mieux
adaptés aux contraintes environnementales, écologiques ou économiques, jusqu’à créer des
variétés nouvelles, et des méthodes culturales tirant le meilleur parti des conditions
particulières du milieu. Pouvaient encore s’ajouter de nouvelles techniques (outillage ou
façons de faire), pour accroître le rendement, ou mieux conserver les récoltes, et parfois de
nouveaux débouchés pour les surplus, qui dynamisaient l’ensemble, tout en maintenant la
culture dans sa totalité. De la sorte chaque région a pu produire ses meilleures recettes et
finalement révéler le meilleur de la cuisine de terroir.
Mutation de l’agroalimentaire
Jusque-là, quelques denrées de base composaient l'essentiel des produits disponibles pour
l’alimentation quotidienne des populations. Durant les longs mois d'hiver, ou pendant les
saisons sèches, elles devaient s'accommoder de quelques rares ingrédients qu'elles parvenaient
à stocker en quantité suffisante. Ici le blé, là le riz, le chou, la pomme de terre, le manioc, la
farine de châtaigne ou la semoule de maïs… Il fallait des trésors d’ingéniosité pour varier la
5
André Giordan, « La Salade niçoise », Alliages, n°24-25, automne-hiver, 1995, pp.145 et suiv.

5
cuisine quotidienne. Sans doute les gens étaient-ils habitués à manger toujours les mêmes
choses. Seuls, les fêtes et le rythme des saisons permettaient de varier les menus.
Les progrès des moyens de transport, les nouvelles technologies de conservation comme la
salaison, la stérilisation, la pasteurisation, le froid, puis la congélation, ont progressivement
permis de développer les filières agro-industrielles, qui, après avoir éloigné les affres de la
famine, ont enrichi la palette du cuisinier de nouvelles saveurs. Peu nombreux au début, les
apports de l’extérieur se sont multipliés de façon exponentielle, comme autant de coups de
boutoir, qui ont fini par faire exploser les ensembles culturels préexistants, construits et
stabilisés dans l’isolement. L’introduction d’éléments nouveaux, formidables par leur
simplicité d’usage ou leur facilité de conservation et leur coût, a profondément transformé les
régimes alimentaires des pays riches, comme celui des régions les plus pauvres et les plus
reculées.
Aujourd'hui, l'agroalimentaire offre à une part croissante de la population une multitude de
possibilités, inimaginables il y a de cela encore quelques décennies. Les cuisines locales
continuent de s'enrichir de ces apports ; mieux, il est possible dans n'importe quelle ville
du monde de manger chinois, niçois, italien, américain, maghrébin. Et pourtant, cet
incomparable enrichissement de la diversité au plan individuel masque un appauvrissement
irréversible au plan de l'humanité, à l'échelle du monde. Prenons les linéaires des grandes
surfaces qui fournissent la majorité des biens de consommation d'une part croissante de
l'humanité. Leur contenu, notamment les fameux 20/80 (20 % des produits de grande
consommation représentant 80 % des ventes), est presque identique d'un bout à l'autre de la
planète. Le mouvement semble encore s’amplifier avec le succès des supermarchés hard
discount, qui ont réduit leur achalandage à 10 % de ce que proposent les hypermarchés, c’est-
à-dire à une sélection de produits relevant des fameux 20/80, en nombre limité, sans marque,
identiques dans tous les magasins de la même chaîne. En quelques années, ils ont séduit une
majorité de la population européenne, pour le prix des denrées et la possibilité de faire ses
courses en peu de temps, comme en témoigne l’expansion rapide de ces chaînes. Bien sûr, on
peut relever la persistance de quelques différences dérisoires ( la formes et la couleur des
emballages, la taille d’un hamburger, l’épaisseur de la pâte à pizza, le sucré de la sauce
ketchup, l’arôme d’un coca ou d’un chocolat…) qui enthousiasment et rassurent les chantres
de la modernité nous assurant que la diversité des cultures n’est pas menacée, seulement en
train de se recomposer.
Et si chaque consommateur a maintenant à sa disposition une variété de fruits et de légumes
comme jamais auparavant, il n'en demeure pas moins, à l'échelle de la Terre, que chaque jour
la diversité des variétés cultivées se réduit comme une peau de chagrin. Il y avait, par
exemple, jusqu’à présent, une infinité de pommiers, alors qu'on ne trouve jamais dans les
supermarchés que trois ou quatre variétés de pommes, toujours les mêmes. Ce sont les
meilleures, c'est-à-dire ici aussi celles qui correspondent aux nouvelles normes de production,
de stockage, de distribution et de consommation. Mais les variétés plus traditionnelles, qui ont
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%