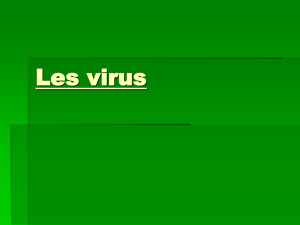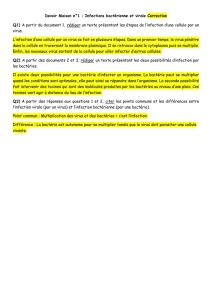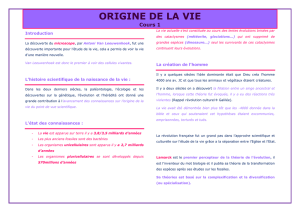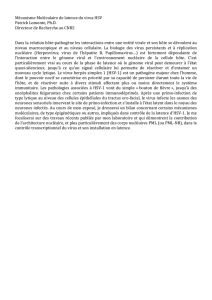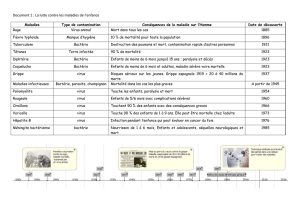Chapitre 13

Chapitre 13
QUESTIONS À COURT DÉVELOPPEMENT
1. Présentez des arguments pour et contre le fait que les virus soient reconnus comme des
êtres vivants.
Le caractère vivant des virus prête à controverse. On définit un processus comme étant un
ensemble complexe de réactions résultant de l’action de protéines codées par des acides
nucléiques qui concourent continuellement à faire fonctionner la cellule vivante. Les virus sont
acellulaires et ne sont formés que d’une capside renfermant un seul des deux acides aminés et
d’un appareil enzymatique très rudimentaire ; ils sont inertes hors des cellules vivantes. De ce
point de vue structural, un virus peut être considéré comme un agrégat exceptionnellement
complexe de substances chimiques, de la matière inanimée en quelque sorte. Par contre, sur le
plan clinique, les virus sont considérés comme vivants, car ils causent des infections et des
maladies. L’acide nucléique viral devient actif une fois à l’intérieur d’une cellule hôte et il en
résulte une prolifération virale. À cet égard, les virus sont donc vivants puisqu’ils se multiplient
dans les cellules de l’hôte qu’ils infectent, bien qu’il s’agisse de microorganismes vivants
extrêmement simples.
2. Sur le plan clinique, les virus sont des agents agresseurs infectieux qui causent des
maladies. Quels avantages l’organisation structurale et fonctionnelle des virus leur confère-
t-elle en regard de l’expression de leur pouvoir pathogène ? Quels sont les effets de
l’infection virale sur la cellule hôte ?
Du point de vue de l’organisation structurale, les virus sont équipés pour se fixer à une cellule
hôte et y pénétrer ; ils possèdent une nucléocapside enveloppée ou non, enveloppe qui peut être
munie de spicules. La capside est une coque protéique servant de protection au matériel
génétique viral ; la présence de sites récepteurs à la surface de la capside permet l’adsorption des

virus non enveloppés sur une cellule hôte. Des capsomères formant la capside peuvent agir
comme enzyme, favorisant ainsi la pénétration du virus dans la cellule hôte. Lorsqu’elle est
présente, l’enveloppe -- composée de lipides, de protéines et de glucides -- est acquise lors de
l’expulsion (bourgeonnement) des virus de la cellule hôte et, par ricochet, elle permet au virus de
pénétrer dans une nouvelle cellule par fusion des membranes virale et cytoplasmique. Certaines
enveloppes sont couvertes de spicules qui peuvent servir de sites récepteurs lors de l’adsorption
des virus sur leur cellule hôte et d’enzymes lors de la pénétration. Le génome des virus est petit
mais contient suffisamment de gènes pour régir les processus essentiels à l’infection, soit la
pénétration, la multiplication et l’expression de dommages possibles dans un hôte.
Du point de vue fonctionnel, le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Son
pouvoir pathogène réside dans deux propriétés. Premièrement, l’acide nucléique viral code pour
des protéines qui inhibent les processus de synthèse de la cellule hôte, ce qui permet au virus de
détourner tout le matériel et le métabolisme énergétique de la cellule au profit de sa propre
réplication. Deuxièmement, d’autre part, l’acide nucléique viral dirige la synthèse des
constituants viraux qui formeront de nouvelles particules infectieuses et commande leur
libération hors de la cellule hôte. En d’autres termes, le virus prend les commandes de la cellule
hôte et la fait travailler à son seul profit. Les virus sont donc des agents infectieux pathogènes
parce qu’ils peuvent se reproduire en causant des dommages cellulaires à l’hôte infecté et parce
qu’ils peuvent se propager d’un hôte à l’autre.
L’infection virale peut causer la mort de la cellule infectée ou perturber gravement son
fonctionnement.
3. En prenant un exemple approprié, expliquez comment l’association d’une bactérie non
pathogène et d’un prophage peut potentiellement accroître la virulence de la bactérie. Quel
avantage le prophage tire-t-il de cette association ?
Corynebacterium diphteriæ est une bactérie qui peut faire partie de la flore normale des voies
respiratoires, où elle n’est pas pathogène. Toutefois, cette bactérie peut être infectée par un phage
lysogénique. Lors du processus de lysogénie, le phage s’incorpore au chromosome bactérien
sous forme de prophage ; il peut alors se produire un phénomène de conversion, c’est-à-dire que
la bactérie va acquérir de nouvelles caractéristiques, souvent associées à une plus grande

virulence comme c’est le cas pour la bactérie responsable de la diphtérie. La virulence accrue de
la bactérie est liée à la présence dans le génome du prophage d’un gène codant pour une toxine
très puissante, en l’occurrence la toxine diphtérique. On assiste ici à une véritable synergie
microbienne : le virus, bien caché dans le chromosome de la bactérie, lui confère des
caractéristiques qui accroissent sa virulence. Plus la bactérie se multiplie et se propage, plus le
virus, sous la forme de prophage, est propagé par la même occasion.
4. On a comparé les prophages et les provirus aux plasmides bactériens. En quoi sont-ils
similaires ? différents ?
Un prophage, un provirus et un plasmide sont des brins d’ADN viral introduits dans une cellule
hôte par un virus.
On rencontre le plasmide et le prophage dans des bactéries ; ils peuvent leur apporter de
nouvelles caractéristiques non essentielles mais habituellement reliées à une plus grande
virulence. Le prophage, au contraire du plasmide, ne peut pas être transféré par le processus de
conjugaison ; la reproduction du prophage peut se faire en même temps que celle de la bactérie
hôte.
Le provirus est de l’ADN provenant de la transcription de l’ARN viral d’un rétrovirus qui
infecte des cellules hôtes animales. Le prophage et le provirus peuvent se multiplier en même
temps que le chromosome de la cellule hôte et être transmis à leur progéniture. Le prophage doit
s’exciser du chromosome pour débuter un cycle de réplication qui conduit à la destruction de la
cellule hôte, alors que le provirus reste intégré et ne s’excise jamais ; la transcription du provirus
peut conduire à la réplication du virus.
APPLICATIONS CLINIQUES
N. B. Certaines de ces questions nécessitent que vous cherchiez des réponses dans les différents
chapitres du livre.

1. Depuis deux semaines, un homme de 40 ans atteint du SIDA présente des douleurs
poitrinaires, une diarrhée persistante, de la fatigue et un peu de fièvre (38 C). Une
radiographie de la poitrine révèle la présence d’exsudats dans les poumons. La coloration
de Gram et la coloration acido-alcoolo-résistante donnent des résultats négatifs. Un
laboratoire spécialisé révèle la cause des signes et symptômes : le HHV-5, un virus à ADN
bicaténaire polyédrique enveloppé, de grande taille, a été mis en évidence dans les cellules
cultivées sous forme d’une inclusion intranucléaire en « œil de poisson ». Quel est ce virus
et à quelle famille appartient-il ? Pourquoi la culture virale a-t-elle été effectuée après
l’obtention des résultats de la coloration de Gram et de la coloration acido-alcoolo-
résistante ? Pourquoi une infirmière non immunisée contre ce virus et qui deviendrait
enceinte ne devrait-elle pas entrer en contact avec ce patient ? (Indice : voir le tableau 13.2
et le chapitre 25.)
HHV-5 est aussi appelé Cytomegalovirus (CMV); il appartient à la famille des Herpesviridæ et
possède les caractéristiques énumérées soit, un virus à ADN bicaténaire polyédrique enveloppé,
de grande taille, mis en évidence dans les cellules cultivées sous forme d’une inclusion
intranucléaire en « œil de poisson ».
Les deux types de coloration auraient permis de mettre en évidence des bactéries, ce qui
n’a pas été le cas, d’où la nécessité de rechercher les causes virales.
L’infection à Cytomegalovirus est transmissible de la mère au fœtus. Si la mère n’est pas
immunisée, le CMV cause des dommages congénitaux graves au fœtus, dommages qui peuvent
entraîner sa mort : naissance prématurée avec ictère hémorragique, pneumopathie,
microcéphalie, etc. Une infirmière non immunisée contre ce virus qui deviendrait enceinte ne
devrait pas donc entrer en contact avec ce patient.
2. Thomas, 6 ans, souffre d’un gros rhume ; il fait 39 C de fièvre depuis 2 jours. Sa mère
l’amène à la clinique parce qu’il présente maintenant de nombreuses lésions vésiculaires et
ulcéreuses sur le pourtour de la bouche et du nez ainsi que sur la poitrine. Quel virus est
probablement responsable de l’apparition des boutons de fièvre ? Pourquoi cette infection
peut-elle survenir à d’autres reprises au cours de la vie de cet enfant ? Quels pourront être

les facteurs ou les situations qui favoriseront la réapparition de l’infection ? (Indice : voir le
chapitre 21.)
Les vésicules, appelées boutons de fièvre, sont probablement d’origine herpétique ; elles sont
causées par le virus de l’herpès humain de type 1, ou virus de l’herpès simplex.
Après la première infection, le virus ne disparaît pas ; il s’installe de façon latente à
l’intérieur des cellules des ganglions du nerf trijumeau qui innerve le visage. Durant la phase de
latence, l'ADN viral ne provoque pas de maladie; le virus latent demeure en équilibre avec
l'organisme hôte pendant de longues périodes; toutefois, une réactivation de l'ADN viral entraîne
la récurrence de l'infection.
Au cours de la vie de Thomas, le virus latent peut être soudainement activé par un
stimulus tel que la fièvre ou les coups de soleil ; cette activation pourra entraîner l’apparition de
nouvelles vésicules.
3. Trente-deux personnes habitant la même ville consultent leur médecin pour les signes et les
symptômes suivants : fièvre (40 C), maux de tête, jaunisse et douleurs abdominales.
Toutes ont bu des boissons glacées préparées dans la même épicerie. Les tests sur l’activité
fonctionnelle du foie des patients présentent des résultats anormaux. Au cours des semaines
qui suivent, les symptômes diminuent et de nouveaux tests montrent que le foie des patients
retourne à une activité normale.
De quelle maladie souffrent les patients ? Quelles sont les deux informations qui vous
ont mis sur la voie du type de maladie ? Cette infection pourrait être attribuée à un virus
appartenant à la famille des Picornaviridæ, des Hepadnaviridæ ou des Flaviviridæ ;
comparez le mode de transmission, la morphologie et le type de matériel génétique des
virus appartenant à ces trois familles. De quel virus peut-il s’agir dans la situation présente
? (Indice : voir les chapitres 13 et 25.)
La maladie touche le foie ; il peut s’agir d’une hépatite.
C’est la présence d’une jaunisse et les tests montrant une activité fonctionnelle du foie
anormale qui indiquent une hépatite. La maladie semble être apparue à la suite d’une
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%