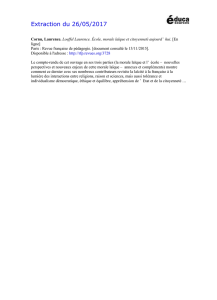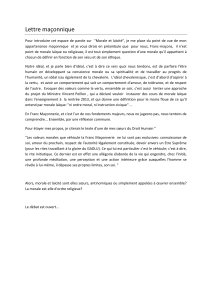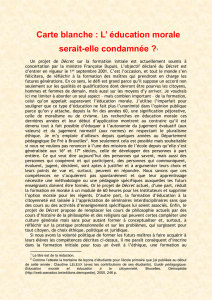Interventions lors de la réunion du 10/11/2012 Gérard: Ce débat est

Interventions lors de la réunion du 10/11/2012
Gérard:
Ce débat est organisé par notre association (IEC) qui a comme objet d'étude l'éthique
contemporaine. Notre motivation philanthropique se détermine humaniste et progressiste.
Nous nous sentons concernés par l'initiative de Mr Peillon puisqu'elle se situe dans une partie
de notre champs de réflexion. Nous avons donc inséré ce sujet à notre ordre du jour, échangé
entre nous, puis écrit un texte qui représente notre contribution à ce projet. Après un rendez
vous avec le cabinet F. Peillon, ce texte leur a été envoyé. Nous attendons une éventuelle
audition.
Notre approche de l'éthique et de la morale qui se place sous l'angle du dialogue et la
réflexion est fondamentalement progressiste. Elle s'oppose à une morale conservatrice qui
lutte pour le maintien absolu des valeurs traditionnelles le plus souvent créées à partir de
«préceptes divins» ou de« paroles de prophètes » ou de « coutumes désuètes ». La remise en
cause du lien entre le “spirituel” et le “temporel” induit un rapide changement de l'éthique et
de la morale. Poussée par une évolution, une transformation des moeurs, l'éthique
contemporaine doit se développer, se construire, s'établir sereinement en adéquation avec les
moeurs.
Il faut impérativement sortir du dilemme : revenir à des valeurs conservatrices ou bien se
trouver dans un vide existentiel avec une carence manifeste des valeurs.
Quelles valeurs reconnaître pour vivre ensemble sans trop d'agressivité ni de mépris, quel sens
trouver à sa vie pour ne pas sombrer dans la déprime ou dans l'addiction. C'est bien là notre
champs de réflexion.
La Laïcité est une des bases nécessaires qui peut permettre d'établir des conditions propices à
l'égalité et à la justice. D'autre part, la laïcité demande à l’élève non pas d’abandonner sa
culture, la religion de ses parents ou son identité, mais de se placer en position de réflexion
grâce à la connaissance de cultures différentes et à l’apprentissage de phénomènes
scientifiques universels. Dans ces conditions, l’école est émancipatrice car elle inculque à tous
un savoir commun permettant l’apprentissage de ce libre arbitre.
La laïcité permet de sauvegarder la liberté de conscience et d'éviter les violences
intercommunautaires.
Notre groupe crée en 2011 est en partie présent aujourd'hui :
Abdel ingénieur-doctorant qui va nous parler de l'opportunité de créer cet enseignement de la
morale laique,
Bernard (ingénieur consultant) qui se consacre maintenant à la philosophie (dialogues
socratiques) qui nous parlera de comment organiser un tel enseignement, comment ouvrir les
enfants et adolescents à la réflexion philosophique),

Antigone (psychologue clinicienne-sexologue) nous parlera des différents éléments qui
permettent de vivre ensemble.
Christian (docteur Vétérinaire) sera le modérateur de ce débat, c'est un rôle essentiel qui est de
gérer la prise de parole, rappeler les règles pour qu'un tel débat puisse se vivre positivement,
faire avancer la réflexion, démocratiser le débat. Il n'est pas concevable que notre groupe
réfléchissant sur l'éthique ne possède pas lui-même des règles précises lors d'un débat.
Moi-même, Gérard (psychothérapeute-psychanalyste) Président de l'association, je vous ai
présenté notre association et pourquoi nous avons choisi ce débat.
Abdel :
Pourquoi poser maintenant la question de remettre au programme scolaire cet enseignement
qui n'existait plus de proposer l’enseignement de la morale laïque maintenant ?
L’actualité est assez alarmante, 3 millions de chômeurs, de profondes réflexions sur des
réformes économiques massives sont en cours, sans parler des critiques violentes contre
l’exercice du gouvernement.
Est-ce que discuter de l’enseignement de la moralité laïque est une priorité dans un
environnement où la priorité est de rétablir un équilibre économique ?
La crise économique actuelle, l’accroissement des inégalités, la crise des valeurs, les tensions
sociales voire les affrontements, tout cela engendrent de multiples frustrations qui génèrent
une dégradation du tissu social.
Les incivilités qui vont du manque de politesse jusqu’à de petites agressions verbales ou
physiques font partie des principales préoccupations des Français. Le développement des
incivilités est une logique sans fin comparable à un effet domino. Les premières discourtoisies
entraînent les suivantes. De l'avis de nombreux enseignants à l'école même, les conditions
minimales d'ordre ne sont plus toujours réunies pour permettre au professeur d’enseigner.
Dans ce sens, certes, la reconstruction d'une instruction civique est impérative et urgente.
D’une part pour faire connaitre le fonctionnement des institutions. Mais aussi et surtout pour
rappeler les règles de sociabilité élémentaires.
Dans la société contemporaine, nous assistons à des superpositions de valeurs multiples et
souvent contradictoires. Suivant nos origines culturelles, religieuses, ethniques, selon nos
préférences politiques, nos références sont très différenciées. Entre la confusion et le manque,
le rapport aux valeurs est souvent problématique et rend difficile la mise en place d'un idéal
qui est un moteur d'excellence irremplaçable à la réalisation de chacun.
D'autre part, les origines de la crise actuelle s’identifient à une irresponsabilité qui était guidée
par une recherche du profit à tout prix, sans conscience des retombées sur « l’autre ». Cette

crise est en définitive une crise de valeurs, car le bien universel se dissout dans une logique
qui ne vise qu’à favoriser des intérêts individualistes. L’enseignement de la morale laïque sera
une chance, pour renforcer un regard critique vis-à-vis de nos agissements, de notre
responsabilité par rapport à l’autre, à l’environnement.
Aussi c'est toute une logique nouvelle de vivre ensemble qu’il faut promouvoir, avec
davantage de respect, de tolérance et moins d'idées préconçues. Les sagesses grecques
peuvent être riches d’enseignement pour toute réflexion et recherche concernant l’éthique et
les idéaux du futur.
Les adolescents se posent souvent des questions qui risquent de rester des pensées secrètes
dont ils n’osent parler à personne.
Souvent, ils ne disposent d’aucun lieu pour structurer leurs pensées et se trouvent ainsi dans
un état de malaise, défavorable à leur épanouissement. Les ateliers d’enseignement de la
morale laïque doivent être ces lieux ou les élèves osent poser librement leurs questions.
Dès l'école primaire, il est possible de donner les moyens à l'enfant de savoir douter, évaluer
et d'apprendre à construire progressivement son point de vue. Ensuite à l'adolescence, il sera
plus facile de se construire, s'autonomiser et de trouver un sens à la vie.
Bernard :
Introduction au débat sur les valeurs contemporaines : Doit-on enseigner la morale laïque à
l’école ?
Quelles valeurs enseigner ?
Ainsi nous avons vu que l’enseignement de la morale laïque ne doit pas s’arrêter à
l’instruction civique, ni non plus à l’acquisition des règles de sociabilité élémentaires pour
répondre aux incivilités. Cet enseignement, par l’enseignement de valeurs éthiques, doit aller
au-delà pour répondre aux conséquences de l’individualisme contemporain, à la crise des
valeurs, et au vide existentiel qui touche particulièrement les jeunes.
Mais nous devons éviter deux écueils opposés.
Le premier écueil serait précisément de n’enseigner que les règles de sociabilité élémentaires,
c'est-à-dire les valeurs universelles qui régissent nos rapports avec les autres et qui sont de
deux ordres :
- Celles qui prescrivent de « ne pas nuire aux autres » (ne pas tuer, ne pas voler, le refus de la
violence, le respect des autres, l’équité, la tolérance, …)
- Celles qui prescrivent de « venir en aide aux autres » (la solidarité, la coopération, la
générosité, le dévouement, l’engagement) …).
Ce premier écueil relève de ce qu’on peut appeler la dérive libérale car les libéraux prétendent
que seules ces valeurs peuvent être enseignées par l’école, et qu’à l’inverse, les valeurs et les
vertus éthiques purement individuelles (gout de l’effort, du travail, la curiosité, la patience, la

persévérance ….) n’est pas du ressort de l’Etat donc de l’école, mais relève de la sphère
privée.
Le deuxième écueil serait à l’inverse de vouloir inculquer aux enfants toutes les valeurs
individuelles, c'est-à-dire leur enseigner et leur transmettre une éthique particulière, sans leur
laisser le choix de leur éthique personnelle. Ce serait ici une dérive conservatrice, qui prétend
vouloir régler le comportement de chacun y compris dans sa vie privée. C’est d’ailleurs ce
que l’on reprochait à la morale laïque enseignée dans les écoles publiques jusqu’en 1969 ou
l’on enseignait plus le respect inconditionnel de l’autorité (les devoirs) que la réflexion sur les
valeurs. On y enseignait: le devoir de fonder une famille, d’avoir beaucoup d’enfants, le
devoir envers les maitres, la conscience professionnelle qui sont considérés aujourd’hui
comme relevant de choix individuels.
La question qui se pose alors est donc de savoir ou se situer entre ces deux extrêmes car on
voit que :
Il est difficile d’enseigner la confiance envers les autres sans considérer la confiance en soi ?
Il est difficile d’enseigner le refus de répondre à la violence par la violence ou simplement le
respect des autres, sans considérer les valeurs personnelles de patience, de prudence,
d’humilité, de tempérance, et surtout de réflexion avant l’action ?
Il est difficile d’enseigner la solidarité et la bienveillance envers les autres sans enseigner
l’effort, la persévérance, la volonté ?
La question que l’on doit se poser et alors de savoir quelles valeurs individuelles l’école doit
enseigner, au nom d’un bien commun ? Et surtout quelles valeurs qui relèvent de l’éthique
personnelle l’école donc l’Etat doivent se garder d’imposer, au risque de heurter les
consciences des enfants et de leurs parents.
Juste à titre d’exemple « l’amour du travail » ou « la curiosité intellectuelle » doivent -il est
promus par l’école ? Que l’on soit travailleur ou que l’on soit curieux est-il du domaine privé
ou regarde-t-il l’Etat ?
La question se pose car on voit q’une société ou l’amour du travail ou la curiosité
intellectuelle serait promut risque fort d’être très différente d’une société ou ils ne le sont pas.
Comment enseigner ?
L’idée que nous défendons ici c’est que, dans une société démocratique, c’est par la
discussion, par le débat argumenté, que l’on peut déterminer les normes de la vie en commun,
les règles du vivre-ensemble, c'est-à-dire ce qui est considéré comme juste pour tous.
C’est sur ce schéma de la discussion, que nous devons fonder l’enseignement de la morale
laïque. Comme on l’a vu, les règles de sociabilité et les valeurs communes ne sont pas
indépendantes des conceptions éthiques particulières, ni les unes ni les autres ne sont figées,
car les unes comme les autres doivent en permanence être soumises à la critique, c'est-à-dire
au questionnement rationnel.

Ainsi, enseigner la morale ne consiste pas tant à transmettre des valeurs et des prescriptions
morales, qu’à former les élèves à penser par eux-mêmes, à argumenter, à s’interroger, à
prendre de la distance par rapport à leurs propres valeurs … pour leur faire découvrir par eux-
mêmes les règles de la vie en commun.
On ne peut plus, de toute façon, de nos jours, alors que les enfants sont exposés aux médias, à
internet, enseigner la morale comme le faisaient les instituteurs de la fin du 19ème siècle en
professant chaque jour un précepte moral ou un adage juridique.
Il s’agit donc aujourd’hui d’entrainer les enfants au débat philosophique, où l’on essaie par le
questionnement, d’abord de comprendre les idées et les valeurs des autres, plutôt que de
vouloir exprimer et défendre ses propres idées ou valeurs. Dans la discussion philosophique il
ne s’agit pas d’exprimer ses idées et ses valeurs mais au contraire de s’interroger sur ses idées
et ses valeurs, et c’est ainsi que l’on découvrira leur relativité. C’est cette démarche qui
constitue la capacité critique. C’est la capacité de douter de ce que j’entends, de ce que je lis,
de ce que je vois.
Cette capacité d’interrogation, si elle porte d’abord sur soi, ne peut s’acquérir que par le
dialogue avec les autres, dans le cadre d’une discussion réglée.
C’est par cette pratique de l’atelier de discussion philosophique que nous proposons donc
d’enseigner ce que nous préférerions appeler d’une autre expression que « morale laïque ».
Ethique, vivre ensemble ….
Ce que nous proposons ici n’est pas nouveau. Des ateliers de pratiques philosophiques pour
enfants existent déjà dans certaines classes et peuvent servir d’exemple pour la mise en
œuvre de ce projet. (Film « Ce n’est qu’un début » ) Il s’agirait simplement de les généraliser
et de les orienter vers des sujets d’éthique et de morale.
Par ailleurs ce débat n’est pas une particularité française. La philosophe américaine Martha
Nussbaum, par exemple, dans un livre récent, « les émotions démocratiques », fait l’éloge de
la pédagogie socratique par le débat pour former le citoyen du 21ème siècle.
Egalement, l’enseignement de la morale en Belgique peut aussi être utile à étudier. Les
instructions pédagogiques y reprennent la théorie du psychologue américain Laurence
Kohlberg, en distinguant les différents objectifs pédagogiques de l’enseignement de la morale
en fonction des différentes stades du développement affectif de l’enfant, et par ailleurs
insistent sur le côté « pratique de la discussion argumentée » qu’il s’agit de mettre en œuvre.
1
/
5
100%