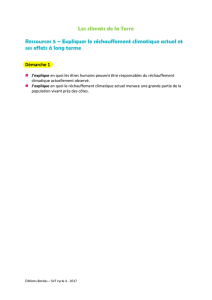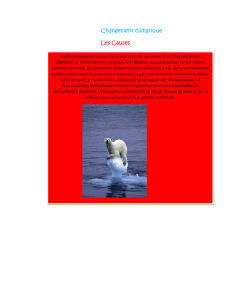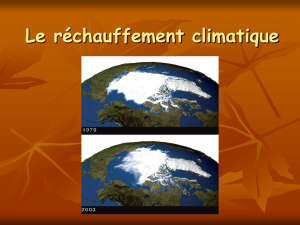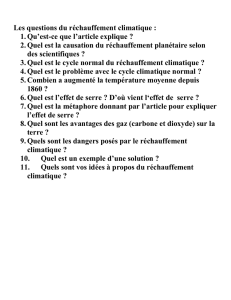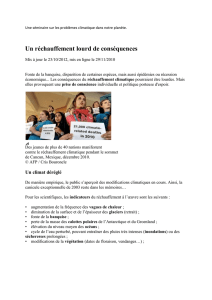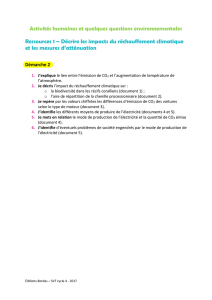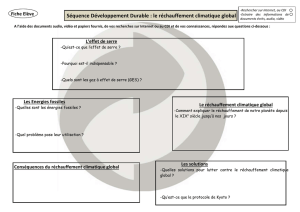Feuille d`Information - hrsbstaff.ednet.ns.ca

Feuille d’Information : Le Changement Climatique
Le climat en 10 questions
Source : France5.Fr vendredi le 2 février 2007
Vidéos à voir
1 - Comment mesure-t-on les phénomènes climatiques ?
Le climat est régi par un ensemble de lois physiques.
Celles-ci concernent notamment les échanges d'énergies
entre la Terre, l'atmosphère et les océans, la circulation
océanique, le rayonnement solaire.... L'océan, en
particulier, joue un rôle important car il stocke la chaleur
et qu'il la transporte par le biais des courants marins.
Ces lois sont décrites par les modèles climatiques sous la
forme d'équations mathématiques. Conçus pour
reproduire le comportement du climat terrestre, ces
modèles, qui sont des programmes informatiques,
servent à reconstituer le climat passé et à étudier son
évolution future. Ils intègrent les principales lois
régissant notre atmosphère, ainsi que les conditions de
départ (température, pression, humidité, salinité de
l'eau de mer, couverture nuageuse, vent...).
Il existe actuellement une quinzaine de modèles
climatiques à travers le monde. En fonction de leur
élaboration, qui varie d'une équipe scientifique à une
autre, les résultats chiffrés auxquels ils aboutissent ne
sont pas strictement identiques. Cependant, tous ces
modèles aboutissent à la même conclusion : nous
assistons à un réchauffement global de la planète,
sans doute dû aux activités humaines. Le problème
n'est pas tant que la température moyenne évolue (cela
n'a cessé d'être le cas par le passé) ; c'est la vitesse du
changement qui est préoccupante : elle est en effet 100
fois plus élevée que le phénomène naturel périodique !
Ce constat étant fait, la question du climat suscite
plusieurs polémiques. Si l'existence du réchauffement
est admise par une très large majorité de scientifiques,
les causes du réchauffement sont encore débattues,
même si l'activité humaine est le plus souvent citée. Par
ailleurs, les effets à terme ainsi que leur amplitude sont
également très débattus. Enfin, la polémique fait rage
quant aux mesures politiques à prendre.
2- Quelles sont les causes des changements climatiques ?
Depuis des millions, voire des milliards d'années, le
climat a évolué, passant par des périodes successives de
glaciation et de surchauffe, autrement dit des phases
très longues de diminution et d'augmentation de la
température.
Sur le très long terme (plusieurs millions d'années), la
première cause des variations de température moyenne
est probablement la variation du rayonnement solaire,
rayonnement qui dépend des orbites solaires et
terrestres. Cependant, la température de la planète est
aussi liée à la teneur en gaz carbonique (CO2) de
l'atmosphère qui, pour des raisons naturelles, a varié au
cours des âges.
La teneur en CO2 et autres gaz à effet de serre
(méthane, protoxyde d'azote...) de l'atmosphère a
beaucoup augmenté au cours des derniers siècles, en
s'accélérant très sensiblement depuis le début de la
révolution industrielle : on peut donc
raisonnablement penser que l'accélération de
l'augmentation de la température du globe est due
à l'augmentation très forte de la teneur en gaz à
effet de serre dans l'atmosphère.
Notons à ce sujet que ce n'est pas l'effet de serre qui
pose problème : produit par l'atmosphère terrestre à la
surface de la terre, celui-ci agit comme un filtre, qui
laisse passer certains rayons lumineux, en bloque
d'autres et contrôle ainsi les échanges entre la Terre, le
soleil et l'espace. Sans l'effet de serre, il ferait -18 °C en
moyenne sur la Terre au lieu de +15°C et la vie humaine
y serait impossible. Ce qui pose aujourd'hui problème,
c'est l'accroissement des émissions de gaz à effet de
serre, qui entraîne un réchauffement moyen de la
planète. D'où l'importance des économies d'énergie et
des énergies renouvelables non polluantes.
Gaz à effet de serre
Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont la vapeur
d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane
(CH4), le protoxyde d'azote (N2O), l'ozone (O3). A ces
gaz s'ajoutent des gaz issus de l'industrie, tels les
chlorofluorocarbones (CFC), le perfluorométhane ou
l'hexafluorure de soufre. Leur présence dans
l'atmosphère terrestre contribue à un effet de serre à la
surface de la Terre. A lui seul, le dioxyde de carbone
(CO2) représente 80% des gaz à effet de serre.

3 - Existe-t-il un consensus scientifique sur l'hypothèse d'un réchauffement climatique global ?
Au vu des nombreuses polémiques (controverses) qui
entourent cette question, il est, a priori, difficile de
parler de "consensus". Certains, peu nombreux certes,
nient en effet la réalité du réchauffement planétaire,
quand d'autres nient son origine humaine, ou mettent en
cause les modèles utilisés. Les avis, bien sûr, divergent
selon la nature des interlocuteurs (politiques, industriels,
écologistes) et les intérêts qu'ils défendent...
Toutefois, un consensus scientifique existe
indéniablement : il s'agit de celui issu des travaux du
Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Évolution du Climat (GIEC), organisme créé en 1988
sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la
Météorologie et du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement. Le GIEC (en anglais IPCC :
Intergouvernemental Panel on Climat Change) n'a pas
vocation à mener des recherches, mais à faire travailler
ensemble des milliers de chercheurs de tous pays afin
d'expertiser l'information scientifique, technique et
socio-économique sur le risque de changement
climatique.
Ses rapports sont approuvés par des assemblées
plénières où sont représentés tous les États membres de
l'ONU. Ils sont approuvés à l'unanimité des pays et le
résultat fait l'objet d'un consensus. Dans son rapport
publié en 2001, le GIEC a estimé que d'ici 2100,
selon différents scénarios liés au développement
de la société, le réchauffement pourrait atteindre
1,4 à 5,8°C. On peut donc parler d'un consensus
scientifique sur cette fourchette.
Quelques étapes vers ce consensus :
Août 1990 : Premier rapport du GIEC
Le réchauffement observé est jugé "comparable à la
variabilité naturelle" mais les projections annoncent une
augmentation de la température.
1992 : Sommet de Rio sur l'Environnement et le
Développement
Élaboration d'une Convention cadre sur les changements
climatiques.
1995 : Deuxième rapport du GIEC
Il relève qu'un "ensemble d'arguments suggère une
influence perceptible de l'homme sur le climat."
1997 : Signature du Protocole de Kyoto
Ce traité visant à diminuer la fabrication de gaz à effet
de serre pour protéger la planète mettra huit ans avant
d'entrer en vigueur.
2001 : Troisième rapport du GIEC
Sa conclusion est sans appel : la température moyenne
terrestre a crû de + 0,6°C depuis le début du siècle, et
"la majeure partie du réchauffement observé au cours
des cinquante dernières années est due aux activités
humaines." Suite à ce rapport, le président Bush
commande à la National Academy of Sciences (NAS) un
contre-rapport sur le changement climatique. Toutefois,
la NAS reprendra l'essentiel des conclusions du GIEC.
2005 : Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto
Après sa ratification par la Russie, le traité de Kyoto
peut entrer en vigueur. Les États-unis, qui avaient quitté
en 2001 les négociations, réaffirment leur refus de le
ratifier.
2007 : Rapport du GIEC qui confirme l’influence de
l’homme.
4 - Quelle est l'influence de l'homme sur le climat ?
Aujourd'hui, il est globalement admis que la plus grande
partie du réchauffement observé depuis le 20e siècle est
la conséquence des activités humaines, et notamment
de la combustion des sources d'énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz naturel) et de la déforestation. Ce
qui fait encore débat (mais moins depuis le rapport
2007), c'est la contribution respective des causes
naturelles et des causes humaines.
On sait que, depuis des millions d'années, le climat de
notre planète passe de périodes de glaciation à des
périodes de réchauffement, périodes qui durent chacune
au moins plusieurs dizaines de milliers d'années. De
plus, on sait que les phénomènes astronomiques, à très
long terme, conduisent à des variations du rayonnement
solaire. Ces constats obligent à nuancer la responsabilité
des activités humaines.
S'il semble donc abusif d'attribuer à l'activité
humaine la totalité de la responsabilité de
l'augmentation de la température planétaire, il
n'est cependant pas possible de nier son rôle dans
le réchauffement en cours. Ainsi, on sait par exemple
que la concentration de certains gaz à effet de serre a
augmenté au fil des années, principalement à la suite
d'activités humaines telles que l'utilisation de
combustibles fossiles (augmentation des concentrations
en dioxyde de carbone), l'utilisation des CFC dans les
systèmes de réfrigération et climatisation, ou encore la
création des élevages de bovins et d'ovins (production
de méthane).
Au-delà de ces certitudes, la question des changements
climatiques dits industriels ou anthropiques (dus à
l'homme) continue à susciter la controverse entre les
spécialistes et il semble que personne ne puisse avoir
une idée définitive sur ce sujet. En revanche, tout le
monde s'accorde sur le fait que jamais le réchauffement
n'a été aussi brutal : depuis un siècle, le climat s'est
réchauffé d'un demi-degré et ce processus se poursuit.
Polémiques
Les personnes qui participent au débat sur la question
du réchauffement climatique global peuvent être
réparties en trois groupes : le groupe des inquiets, qui
réunit la grande majorité des spécialistes ; celui des
eschatologues, qui entrevoient la fin du monde et pour
qui l'apocalypse climatique apparaît imminente ; et celui
des sceptiques, groupe réunissant des gens qui ne
peuvent admettre qu'un réchauffement climatique soit
bel et bien à l'ordre du jour et/ou qui estiment que les
modèles climatiques actuels sont encore trop grossiers
pour être fiables. Beaucoup parmi eux arguent de la
"théorie du complot". Parmi ces personnes, on trouve
André Fourçans, auteur en 2002 d'un ouvrage titré "Effet
de serre, le grand mensonge ?", Bjorn Lomborg
("L'Environnementaliste sceptique", paru en 2001), Yves
Lenoir ("Climat de panique", 2001), ainsi que Guy
Sorman, Jean-Paul Croizé, Michel Kohler, sans oublier
l'auteur de "Jurassic Park", Michael Crichton, qui
dénonce le complot climatique dans un ouvrage titré
"État d'urgence" (Éditions Robert Laffont, 2006).A lire
sur le sujet : "Les contestataires de la science"
(L'internaute)

5 - Quelles sont les prévisions pour l'avenir ?
Les scientifiques s'accordent tous sur le fait que les
phases de réchauffement (périodes interglaciaires) et de
refroidissement climatique (périodes glaciaires) ont
alterné au cours des millénaires ; presque tous
s'accordent également sur le fait que nous sommes
entrés, depuis au moins un siècle, dans une phase de
réchauffement du climat.
En revanche, les "prévisions" divergent pour ce qui
concerne l'avenir : la marge d'incertitude est en effet
importante en fonction de la diversité des scénarios et
des modèles proposés. Le Groupe
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) estime que le réchauffement global moyen
pourrait être compris entre 1,4 et 5,8°C d'ici 2100,
contre un petit degré d'augmentation au cours du 20e
siècle. Cette fourchette de température recouvre à la
fois l'incertitude sur les modèles (typiquement + ou -
1°C pour un scénario donné) et celle liée aux 35
scénarios socio-économiques considérés, dont
l'incertitude est large. Cette estimation correspond donc
à une enveloppe englobant toutes les incertitudes.
Cependant, tous les modèles s'accordent sur trois points
: le réchauffement général de la planète est très
probable, et se traduira par une augmentation de
température plus importante aux hautes latitudes qu'à
l'équateur. D'autre part, les climats secs seront encore
plus secs, et les climats humides s'intensifieront, avec
des précipitations plus violentes. Enfin, le relèvement du
niveau des mers est presque certain, non seulement à
cause de la fonte des glaces, mais également par un
phénomène de dilatation de l'eau plus chaude. Au-delà
de ces quasi-certitudes, les différents modèles
divergent quant aux prévisions régionales.
Dans l'hypothèse de réchauffement la plus élevée, il faut
se préparer à des conséquences importantes, et en
particulier à la généralisation des phénomènes
climatiques extrêmes (tempêtes, inondations,
sécheresses, canicules), à une augmentation des
températures moyennes sous certaines latitudes, et à
une augmentation du niveau de la mer, qui pourrait
submerger les terres les plus basses (Nauru dans le
Pacifique, Bangladesh). Le Gulf-Stream, courant sous-
marin de l'Atlantique Nord, pourrait par ailleurs
disparaître, ce qui provoquerait un refroidissement du
climat en Europe occidentale. Parmi les autres risques
identifiés, citons l'extension des zones endémiques de
maladies à vecteurs (comme le paludisme), la
fragilisation de l'agriculture moderne (très spécialisée et
peu diversifiée), une modification des flux touristiques,
l'apparition de tensions géopolitiques nouvelles (régimes
autoritaires, migrations massives, etc.).
Toutefois, rien ne permet d'affirmer que cette hypothèse
- la plus élevée - se vérifiera. Les conséquences du
réchauffement seront radicalement différentes selon que
l'augmentation de la température moyenne sera de 1,4
ou de 5,8 degrés.
6 - Les récents phénomènes météorologiques extrêmes sont-ils liés au réchauffement de la planète ?
Les ouragans et cyclones des Caraïbes, le tsunami du 26
décembre 2004 en Asie, la canicule de l'été 2003 et les
tempêtes de l'hiver 1999 en France, les fortes
intempéries et inondations en Europe centrale... : si, ces
dernières années, une série d'accidents climatiques
majeurs a eu lieu, rien ne prouve de façon certaine que
ces catastrophes soient liées au réchauffement de la
planète. L'augmentation des récentes catastrophes
observée dans certaines parties du monde pourrait aussi
être entièrement naturelle.
Cependant, certaines études montrent que la sévérité
et la fréquence de nombreux types d'épisodes
météorologiques extrêmes se modifieront à
mesure que le climat se réchauffera. Ces
catastrophes, qui en sont issues, peuvent donc être
considérées comme des exemples de ce qui arrivera plus
fréquemment à l'avenir, si le climat planétaire continue
de se réchauffer.
La modélisation climatique, qui ne date que de quelques
dizaines d'années, propose des outils qui n'ont pas été
conçus pour pouvoir travailler spécifiquement sur les
phénomènes extrêmes. D'où l'impossibilité d'une
réponse définitive sur cette question, même si plusieurs
indices laissent à penser que le nombre de tempêtes,
d'inondations et de sécheresses sera, à l'avenir, de plus
en plus important. Autant d'indices qui demandent à être
confirmés par des recherches approfondies.
Seule certitude : si les pays développés tentent, en
tâtonnant, de s'adapter peu à peu à ces menaces, ce
n'est pas le cas des pays en développement, qui ont
déjà du mal à affronter leurs problèmes habituels. Un
constat dont la communauté internationale doit se sentir
responsable : dans la lutte contre le réchauffement du
climat, l'enjeu, pour tous, est désormais de faire en
sorte que la révolution industrielle des pays émergeants
soit plus propre que celle des pays du Nord. Toutefois,
même si ces pays sont ceux qui connaissent
actuellement le plus de cyclones et autres phénomènes
extrêmes, d'autres risques existent, qui peuvent
concerner également les pays développés.

7 - Quels sont les indices du réchauffement ?
Les premiers indices du réchauffement climatique sont
déjà perceptibles partout dans le monde : nous assistons
à la transformation progressive de nos paysages, de
notre environnement, de nos conditions de vie...
Quelques exemples :
- Augmentation des températures depuis 100 ans
Les scientifiques ne disposent d'observations de
températures directes et fiables que depuis une centaine
d'années. Sur ces cent dernières années, il apparaît que
la température a augmenté de 0,6 °C, mais ces 25
dernières années, ce réchauffement s'est accéléré et les
années récentes ont été parmi les plus chaudes depuis
1860. Le réchauffement empêche la régénération de
nombreux récifs coralliens, d'où la disparition d'une
importante faune marine d'espèces variées.
- Recul des glaciers
On sait de façon certaine que les glaciers de montagne
se sont considérablement réduits depuis 1850, alors
qu'aucune tendance nette n'est repérable au cours des
trois siècles et demi précédents. En fondant, les glaciers
de montagne font monter le niveau de la mer, niveau
qui augmente déjà en raison du réchauffement des
océans (voir ci-dessous).
- Fonte de la banquise
En Antarctique comme en Arctique, la banquise est un
indicateur reconnu des évolutions du climat. Or
l'épaisseur de la banquise arctique a diminué de 40%
ces dix dernières années et sa surface de 5%. De plus
en plus d'icebergs se retrouvent ainsi au large... Ces
changements majeurs ont de très graves conséquences
sur les populations des espèces vivant sur la banquise,
tels les ours polaires, qui ont de plus en plus de mal à
trouver de la nourriture.
- Perturbations du cycle de l'eau
Les régions de la Terre affectées par la sécheresse ont
doublé en trente ans et le réchauffement climatique est
responsable pour moitié du dessèchement de la planète,
en augmentant le taux d'évaporation de l'eau.
- Migration ou disparition d'animaux
L'augmentation des températures d'hiver en Europe
centrale s'accompagne d'une baisse du nombre
d'oiseaux migrateurs. D'ores et déjà, plusieurs
populations d'oiseaux de courte distance ont cessé de
migrer durant les 20 dernières années. La migration
d'autres espèces a également commencé : en une
vingtaine d'années, des poissons d'Atlantique Nord ont
migré vers le nord de 50 à 400 km ou se sont déplacés
vers des eaux plus profondes, tandis que plusieurs
espèces d'insectes ont fortement migré vers le nord ou
en altitude au cours des dernières décennies. Enfin, la
disparition "énigmatique" d'espèces d'amphibiens a été
observée dans plusieurs parties de la planète.
- Augmentation du niveau moyen des mers
Le niveau moyen des mers s'est élevé de 12 cm depuis
1880 (5 cm dus à la dilatation thermique et 7 cm à la
fonte des glaciers). Ceci engendre, par exemple, la
disparition chaque année de 100 km² de marécages
dans le delta du Mississippi.
8 - Le réchauffement pourrait-il avoir des effets positifs ?
Il semble que les conséquences positives du
réchauffement soient très peu nombreuses, et qu'elles
ne concernent que le court terme.
A brève échéance, des effets positifs pourraient être
constatés dans certains pays de haute latitude (Canada,
Russie, pays scandinaves, Alaska...) qui subiraient alors
des hivers moins froids. Les zones agricoles de ces
régions pourraient être étendues et bénéficier de
meilleures productions.
De même, on sait que si le réchauffement climatique
observé en Arctique inquiète beaucoup de gens dans le
monde, les milieux pétroliers auraient plutôt tendance à
s'en réjouir, car il pourrait favoriser la prospection de l'or
noir au Groenland... En outre, de nouvelles voies
navigables pourraient voir le jour, d'où de nouvelles
opportunités pour l'économie des régions alentours.
Certains, par ailleurs, avancent que le réchauffement
climatique constitue un excellent moyen de diminuer la
consommation d'énergie pour le chauffage... Mais c'est
ne pas tenir compte de la climatisation qui, elle, est de
plus en plus répandue.
De fait, il semble très hasardeux d'envisager la question
du réchauffement en isolant uniquement quelques zones
du globe terrestre. Sur cette question, le raisonnement
doit concerner l'échelle de la planète: on ne peut
pas parler d'avantages pour certaines zones en les
isolant, sachant que le changement climatique aura des
répercussions tellement difficiles dans d'autres endroits.
Le réchauffement reste donc un phénomène néfaste,
même si l'on peut constater certains effets bénéfiques ça
et là. C'est pourquoi les scientifiques préfèrent parler de
l'impact global du changement climatique, qui ne se
résume pas seulement au réchauffement.

9 - Est-il possible de ralentir le réchauffement planétaire ?
En 1997, sous l'égide des Nations unies, le Protocole de
Kyoto a vu le jour. Ce traité visant à diminuer la
fabrication de gaz à effet de serre pour protéger la
planète est entré en vigueur en 2005. Avec ce texte, la
communauté internationale a pris un ensemble de
mesures obligeant les pays développés à réduire de 6%
en moyenne leurs émissions de gaz toxiques en 10 ans*.
Plusieurs observateurs estiment cependant que ces
mesures ne sont pas forcément les mieux adaptées,
quand on sait que les États-Unis n'ont pas ratifié le
Protocole, tout comme la Chine, l'un des plus gros
pollueurs de la planète. Les plus sceptiques ajoutent que
ses effets ne produiront qu'une légère différence au
niveau des températures et qu'il est peu probable que
l'approche consistant à réduire les émissions de dioxyde
de carbone réussisse.
De fait, la question de la lutte contre le réchauffement
planétaire suscite de très vives polémiques sur la
politique à suivre pour ralentir le rythme d'augmentation
des gaz à effet de serre. La généralisation de sources
d'énergie alternative figure parmi les solutions les
plus fréquemment avancées: nouvelle génération
d'énergie nucléaire (projet ITER), pile à hydrogène,
voitures électriques, modes moins polluants
d'exploitation du charbon, mise en place de véritables
programmes d'économie d'énergie... Au-delà de ces
solutions, l'affectation de budgets conséquents à la
recherche-développement est également prônée, afin
de généraliser l'usage des énergies alternatives et en
diminuer le coût.
Des méthodes pour ralentir l'émission de CO2 sont
actuellement en cours d'élaboration par les scientifiques,
qui travaillent également sur des techniques de captage
et de séquestration des gaz à effet de serre. Dans le
domaine de l'agriculture, des travaux sont menés pour
découvrir de nouvelles variétés de semences adaptées
aux changements climatiques, continent par continent...
Le rôle des chercheurs et des scientifiques est donc
essentiel, à la fois pour analyser le phénomène et ses
conséquences, et pour préparer la façon dont nos
sociétés devront s'adapter au réchauffement de la
planète.
La société civile elle aussi intervient dans ce débat, par
le biais d'ONG et d'associations qui, à l'image du Réseau
Action Climat France, participent aux négociations
internationales. La bonne nouvelle finalement est que,
partout dans le monde, des personnes se soucient du
réchauffement climatique et réfléchissent à une autre
forme de croissance...
* Voir également la Question 3 de ce dossier ("Liens").
10 - Peut-on agir individuellement contre le dérèglement du climat ?
Dans nos pays industrialisés, le particulier est
responsable directement de près de 50% des émissions
de CO2. Se chauffer, se déplacer, manger, produire... :
de très nombreux actes de la vie courante ont en effet
pour conséquence de créer des gaz à effet de
serre. Ainsi, l'émission moyenne annuelle par Français
est évaluée à 2,2 tonnes équivalent carbone (unité de
mesure des gaz à effet de serre), volume qui devrait
passer en dessous du seuil des 500 kg équivalent
carbone annuel si l'on veut simplement arrêter de
saturer l'atmosphère. Autant dire qu'il s'agit là d'une
remise en cause radicale de notre mode de
consommation.
Pour tenter d'atteindre ce but, il existe énormément
de petits gestes de tous les jours qui permettent de
diminuer les rejets de gaz carbonique : utiliser des
ampoules à basse tension, éteindre les appareils
électriques au lieu de les laisser en veille, acheter des
appareils ménagers économes en énergie, marcher, faire
du vélo, prendre le train, le métro ou le bus plutôt que la
voiture ou l'avion, mettre le linge à sécher au soleil
plutôt qu'au sèche-linge, utiliser des voitures qui
consomment le moins possible d'essence, éviter les
emballages inutiles (cartons, plastiques), manger les
fruits et les légumes de saison, éteindre la lumière
quand on sort d'une pièce, économiser l'eau...
Cette attitude civique passe bien sûr par la conviction de
l'importance des changements climatiques : même si
nous entamons dès maintenant une véritable
politique de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, le réchauffement climatique se produira -
mais avec une ampleur moindre que si nous ne
faisons rien. Elle passe aussi par une prise de
conscience : utiliser l'énergie coûte cher à l'humanité et
apprendre à l'économiser constitue un défi majeur pour
l'avenir.
Mais la sollicitation du particulier ne peut faire oublier
que les gestes individuels doivent s'accompagner de
décisions politiques volontaristes. Réduire de manière
conséquente les émissions de gaz à effet de serre
implique en effet de réels choix de société consistant à
investir dans des technologies propres, qui permettent
notamment de produire l'électricité en favorisant l'usage
d'énergies non fossiles (nucléaire ou renouvelables).
1
/
5
100%