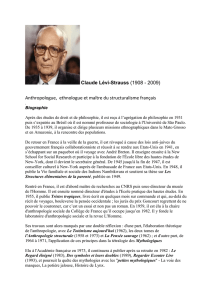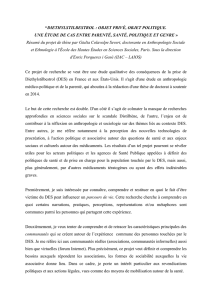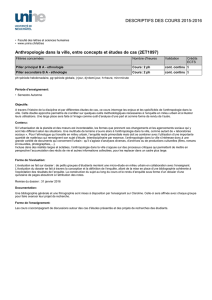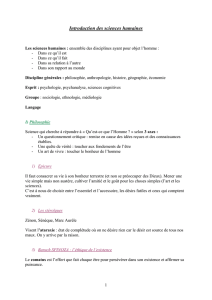Lévi-Strauss

Lévi-Strauss
"Anthropologie structurale"
1958
SOMMAIRE :
I. Présentation de l'auteur et ses principales œuvres
II. Postulats de l'ouvrage
III. Les hypothèses
Iv. La démarche suivie
V. Les principales conclusions
VI. Le résumé de l'ouvrage
VII. L'actualité de la question, perspectives critiques et intérêt pour les sciences de gestion
I. PRÉSENTATION DE L'AUTEUR :
LÉVI-STRAUSS (C.)
Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'œuvre de Claude Lévi-Strauss s'est progressivement
révélée, en France et à l'étranger, comme la contribution majeure à l'anthropologie
contemporaine. Elle le doit, cependant, plus à son prestige et à son éclat qu'à des positions
dogmatiques qui auraient rallié momentanément le plus large consensus. Ce sont d'abord les
questions qu'elle pose et la manière dont elle les pose qui ont bouleversé profondément les
perspectives antérieures, obligeant la plupart des anthropologues soucieux de rigueur
scientifique, qu'ils soient ou non en accord avec elle, à considérer leurs objets très divers d'un
regard neuf et à définir des positions dont la pertinence ou le manque de pertinence
n'apparaissaient guère jusqu'alors.
D'autres anthropologues que Lévi-Strauss ont peut-être joui, dans le passé, d'un succès encore
plus large auprès du grand public, ou se sont mieux imposés, en leur temps, comme les
maîtres d'une école mise inconditionnellement au service de leurs thèses. Aucun n'a exercé,
jusqu'ici, un tel rayonnement intellectuel touchant toutes les disciplines qui s'intéressent à
l'homme et à ses œuvres.
Né en 1908, Claude Lévi-Strauss se dirigea d'abord vers la philosophie, dont, à l'époque, le
caractère de construction gratuite et l'enseignement desséchant eurent vite fait de le décevoir.
Marqué par les démarches formelles de la géologie, du marxisme et de la psychanalyse, qui,
dans leurs domaines respectifs - la terre, les groupes sociaux, l'individu -, lui apparaissaient
comme des efforts pour intégrer, sans rien sacrifier de ses propriétés, le sensible au rationnel,
par quoi se manifeste l'homogénéité secrète du monde et de l'esprit, Lévi-Strauss opte alors
pour l'ethnographie. Nommé professeur de sociologie à l'université de São Paulo, il séjourne

au Brésil de 1934 à 1939, se nourrissant des écrits, méconnus en France, des grands
anthropologues américains: Boas, Kroeber, Löwie. Au cours de cette période, il effectue dans
l'est sauvage du pays plusieurs missions ethnographiques, dont les résultats seront publiés
dans divers articles, dans un premier ouvrage (1948) et dans Tristes Tropiques (1955). À New
York, pendant la guerre, il découvre, notamment au contact de Roman Jakobson, la
linguistique structurale, où il voit le modèle d'une démarche proprement scientifique
appliquée aux faits humains. Il s'en inspirera désormais pour élaborer de nouveaux modèles
anthropologiques qui visent moins à schématiser la réalité sociale et culturelle qu'à découvrir
les ressorts mentaux qui lui donnent forme. Rentré en France en 1948, il enseigne à l'École
pratique des hautes études et soutient sa thèse de doctorat ès lettres consacrée aux problèmes
théoriques de la parenté (1949). En 1958, il est élu professeur au Collège de France, à la
chaire d'anthropologie sociale qu'avait occupée Marcel Mauss, dont la pensée annonçait la
sienne sur plus d'un point. L'œuvre et l'enseignement de Lévi-Strauss, outre leur influence à
l'étranger, ont, en France, grandement contribué à susciter un nouvel essor de la recherche
anthropologique et de l'ethnologie de terrain. Claude Lévi-Strauss est membre de l'Académie
française depuis 1973.
Principales œuvres :
La vie familiale et sociale des indiens Nambikwara , Paris, Société des
Américanistes,1948.
Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses universitaires de France, 1949.
Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss (in : Marcel Mauss, Sociologie et
Anthropologie), Paris, Presse universitaire de France, 1950.
Race et Histoire, Paris, Unesco, 1952.
Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955.
La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.
Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964.
Du miel aux cendres, Paris, Plon, 1966.
II. POSTULATS DE L'OUVRAGE :
- Les besoins organiques de l'homme (alimentation, protection, reproduction) fournissent les
impératifs fondamentaux qui conduisent au développement de la vie sociale.
- Un système de parenté ne consiste pas dans les liens objectifs de filiation ou de
consanguinité donnés entre les individus ; il n'existe que dans la conscience des hommes, il
est un système arbitraire de représentation, non le développement spontané d'une situation de
fait.
- Une société ne diffère pas de ses voisins les plus évolués sous tous les rapport, mais
seulement sous certains ; tandis qu'on trouve, dans d'autres domaines, de nombreuses
analogies.
- Seul un malade peut sortir guéri, un inadapté ou un instable ne peuvent qu'être persuadés.
- Rien n'existe que des êtres humains, liés les uns aux autres par une série illimitée de
relations sociales.

- Le langage est à la fois le fait culturel par excellence (distinguant l'homme de l'animal) et
celui par l'intermédiaire duquel toutes les formes de la vie sociale s'établissent et se
perpétuent.
- Tous les systèmes humains de communication sont tous le produit de l'esprit humain.
- Comme les phénomènes d'une langue, les termes de parenté sont des éléments de
signification, ils n'acquière cette signification qu'à la condition de s'intégrer en systèmes.
- Une structure se suffit à elle-même et ne requiert pas, pour être saisie, le recours à toutes
sortes d'éléments étrangers à sa nature ; d'autre part, des réalisations, dans la mesure où l'on
est parvenu à atteindre effectivement certaines structures et où leur utilisation met en évidence
quelque caractères généraux et nécessaires qu'elles présentent malgré leurs variétés.
- Chacun de nous est réellement né de l'union d'un homme et d'une femme.
- L'agriculture est source de nourriture donc de vie.
- Pour dissocier l'individu de son personnage, il faut le réduire en lambeaux.
- Quand une loi a été prouvée par une expérience bien faite, cette preuve est valable
universellement.
- Les médecins primitifs, comme les médecins modernes, guérissent au moins une partie des
cas qu'ils soignent, et que, sans cette efficacité relative, les usages magiques n'auraient pu
connaître la vaste diffusion qui est la leur, dans le temps et dans l'espace.
- La langue est un fait social, et non un organisme vivant. Elle est une émanation de la
communauté sociale, de son histoire, et elle contribue à la fonder en retour en tant que
communauté parlante: elle constitue comme "l'infrastructure" de la culture.
- Quelle que soit la culture, l'esprit est fondamentalement identique. Entre mythe et science
élaborée, entre pensée sauvage et pensée identique, il n'y a pas de coupure radicales,
seulement des différences de moyens pour questionner le monde.
III. LES HYPOTHÈSES :
1) Comme les phonèmes, les termes de parenté sont des éléments de signification ; comme
eux, ils n'acquièrent cette signification qu'à la condition de s'intégrer en systèmes ; "les
systèmes de parenté" comme "les systèmes phonologiques", sont élaborés par l'esprit à l'étage
de la pensée inconsciente.
2) L'ensemble des règles de mariage observables dans les sociétés humaines ne doivent pas
être classées comme on le fait généralement en catégories hétérogènes et diversement
intitulées ; prohibition de l'inceste, types de mariages préférentiels ; elles représentent toutes
autant de façons d'assurer la circulation des femmes au sein du groupe social, c'est-à-dire de
remplacer un système de relations consanguins, d'origine biologique, par un système
sociologique d'alliance.

3) Est ce que la langue qui exerce une action sur la culture ? ou la culture sur la langue ? On
n'est pas avisé que langue et culture soient deux modalités parallèles d'une activité plus
fondamentale qui l'esprit humain.
4) La survivance des sociétés archaïque est fondé sur la découverte de discordance externes
entre leur culture et celle de sociétés voisines.
5) Entre les moitiés exogamiques, les associations et les classes d'âge, il n'y a pas de cloison
étanche. Les associations fonctionnent comme si elles étaient des classes matrimoniales,
satisfaisant, mieux que les moitiés, aux exigences des règles du mariage et de la terminologie
de parenté ; sur le plan mythique, elles apparaissent comme des classes d'âge, et dans un
système théorique de moitiés. Seuls les clans paraissent étrangers, et comme indifférents, à cet
ensemble organique.
6) Le triadisme et le dualisme sont indissociables, parce que le second n'est jamais conçu
comme tel, mais seulement sous forme de limite du premier.
7) Le chant constitue une manipulation psychologique de l'organe malade, et que c'est de cette
manipulation que la guérison est attendue.
8) Un individu conscient d'être l'objet d'un maléfice est intimement persuadé, par les plus
solennelles traditions de son groupe, qu'il est condamné ; parents et amis partagent cette
certitude. Dès lors, la communauté se rétracte : on s'éloigne du maudit, on se conduit à son
égard comme s'il était, non seulement déjà mort, mais source de danger pour tout son
entourage ; à chaque occasion et par toutes ses conduites, le corps social suggère la mort à la
malheureuse victime, qui ne prétend plus échapper ce qu'elle considère comme son
inéluctable destin.
9) Quelle que soit notre ignorance de la culture de la population où l'a recueilli, un mythe est
perçu comme mythe pour tout lecteur, dans le monde entier. La substance du mythe ne se
trouve ni dans le style, ni dans le mode de narration, ni dans la syntaxe, mais dans l'histoire
qui est racontée. Le mythe est langage ; mais un langage qui travaille à un niveau très élevé, et
où le sens parvient, si l'on peut dire, à décoller du fondement linguistique sur lequel il a
commencé par rouler.
10) Les véritables unités constitutives du mythe ne sont pas les relations isolées, mais des
paquets de relations, et que c'est seulement sous forme de combinaisons de tels paquets que
les unités constitutives acquièrent une fonction signifiante.
IV. DÉMARCHE SUIVIE :
Ainsi, qu'il s'agisse de mythe, de parenté ou de pensée sauvage, tous les systèmes trouvent
leur fondement commun dans la caractéristique symbolique de l'activité de l'esprit humain, le
propre de l'analyse structurale étant de mettre en évidence la nature de cette activité.
Pour Lévi-Strauss, la structure est première, c'est-à-dire que l'ensemble des relations et des
principes qui règlent les systèmes symboliques sont des données fondamentales et immédiates

de la réalité sociale, et appartiennent à l'inconscient structural. Ces données sont donc
"logiquement antérieures" à l'objet. La forme précède le contenu.
En effet pour, pour Lévi-Strauss, "l'activité inconsciente de l'esprit consiste à imposer des
formes à un contenu, et si ces formes sont fondamentalement les mêmes pour tous les esprits,
anciens et modernes, primitifs et civilisés, il faut et il suffit d'atteindre la structure
inconsciente, sous-jacente à chaque institution ou chaque coutume, pour obtenir un principe
d'interprétation valide pour d'autres institutions et d'autres coutumes".
Le substrat universel, sous jacent à toutes les institution, peut être comparé à un moule dans
lequel toutes les manifestations socio-culturelles viennent se couler. L'analyse structurale vise
à identifier ce moule à partir duquel on peut rendre compte de tous les contenus possibles. La
démarche structuraliste est construite, à partir d'un certain nombre de données, des modèles
hypothético-déductives capables de rendre compte de tous les faits observables dans les
différents systèmes concrets.
Le modèle structural de Lévi-Strauss fait ainsi progressivement glisser l'interprétation
anthropologique de l'ordre de la réalité sociale à l'ordre de la pensée symbolique, de l'ordre du
concret à l'ordre de l'abstrait. Les contraintes de la vie sociale sont remplacées par celles de la
structure de l'esprit humain. En quelque sorte Lévi-Strauss réduit la vie sociale aux conditions
de la pensée symbolique dont le fondement est constitué par "la structure inconsciente de
l'esprit humain".
V. PRINCIPALES CONCLUSIONS :
1) La corrélation entre formes de l'avunculat et types de filiations n'épuise pas le problème du
système de parenté. Des formes différents d'avunculat peuvent coexister avec un même type
de filiation, patrilinéaire ou matrilinéaire. On trouve toujours la même relation fondamentale
entre les quatre couples d'oppositions qui sont nécessaires à l'élaboration du système de
parenté.
2) Pour qu'une structure de parenté existe, il faut que s'y trouvent présents les trois types de
relations familiales toujours données dans la société humaine, c'est-à-dire : une relation de
consanguinité, une relation d 'alliance, une relation de filiation ; autrement dit, une relation de
germain à germaine, une relation d'époux à épouse, une relation de parent à enfant.
3) Les discordances entre des sociétés ne sont jamais assez nombreuses pour éliminer
complètement les coïncidences, externes elles aussi ; et ces coïncidences externes sont
atypiques, c'est-à-dire qu'au lieu de s'établir avec un groupe, ou un ensemble de groupes, bien
défini par la culture et géographiquement localisé, elles pointent dans tous les sens et
évoquent des groupes hétérogènes entre eux. En second lieu, l'analyse de la culture pseudo-
archaïque, considéré comme un système autonome, fait ressortir des discordances internes, et
celles-ci sont, cette fois, typiques, c'est-à-dire touchant à la structure même de la société, et
compromettant irrémédiablement son équilibre spécifique.
4) Dans l'aire indo-européenne, la structure sociale (règle du mariage) est simple, mais les
éléments (organisation sociale) destinés à figurer dans la structure, sont nombreux et
complexes. Dans l'aire sino-tibétaine, la situation se renverse. La structure est complexe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
1
/
56
100%