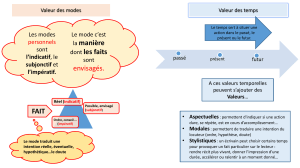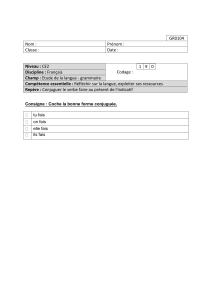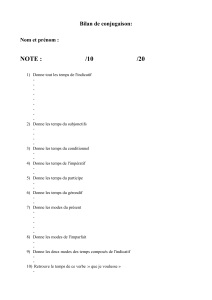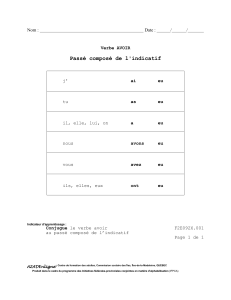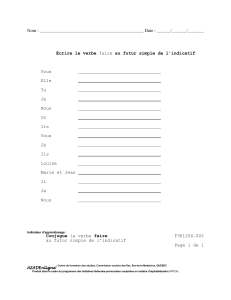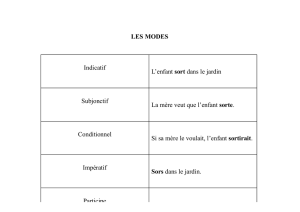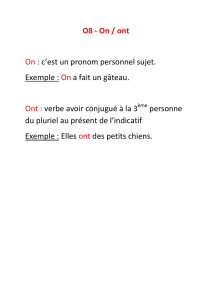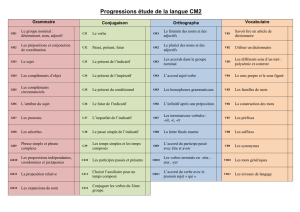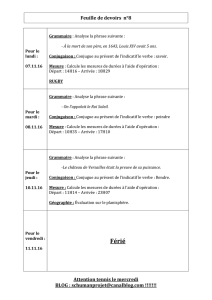Les modes personnels

1
Les modes personnels
Biblio : - Grammaire méthodique du français, pp.287-288.
- La Grammaire d’aujourd’hui, pp.390-391.
- Grammaire du français, pp.524-525.
Le mode fait partie des catégories qui font varier le verbe (avec la personne, le
nombre, le temps, l’aspect et la voix). Cependant, le mode est étroitement lié à la
forme verbale (tout comme le temps et l’aspect) car il s’applique exclusivement au
verbe, contrairement au nombre et à la personne.
Selon la Grammaire méthodique du français, les modes ne constituent que des
« cadres de classement qui regroupent chacun un certain nombre de formes
verbales ». Les modes personnels se distinguent alors par le fait qu’ils comportent la
catégorie de la personne, contrairement aux modes impersonnels. Les modes
personnels sont donc l’indicatif, le subjonctif et l’impératif.
Rmq : autrefois considéré comme un mode à part entière, le conditionnel
(ou « tiroir en –rais ») est aujourd’hui intégré à l’indicatif. En effet,
il est jugé trop proche du futur pour constituer un mode à lui seul ;
d’autre part, son emploi ne dépendrait pas toujours de
l’expression de la condition.
Si l’on reprend la distinction entre le dictum (ce que l’on dit) et le modus
(l’attitude de l’énonciateur face à son énoncé, qu’il le considère comme vrai,
douteux...), le mode peut être rapproché de la notion de modalité, ce que la définition
traditionnelle du mode ne manque pas de faire. Toutefois, il serait faux de
considérer que les deux notions se recouvrent totalement. Il semble donc
important de faire une mise au point sur la notion de mode.

2
1. Modes et modalités
Les modes regroupent les différentes manières d’envisager le procès
exprimé. Ainsi, l’indicatif le présente dans sa réalité (il est venu) alors que le
subjonctif l’apprécie dans sa virtualité (qu’il vienne) et l’impératif sous la forme
d’un ordre ou d’une prière (Venez).
Une fois posé ceci, il semble difficile d’identifier mode et modalité, et ce
principalement parce que les deux notions ne coïncident pas. En effet, selon la
Grammaire méthodique, « Une même modalité peut s’exprimer de différentes façons,
au moyen de modes et de structures de phrases différentes ».
Par exemple, l’expression de l’éventualité soumise à une condition peut passer
par plusieurs constructions et modes grammaticaux : Si vous preniez une aspirine,
vous n’auriez plus mal à la tête / Prenez une aspirine, vous n’aurez plus mal à la tête
/ Vous prenez une aspirine et votre migraine s’en va...
Sur le même principe, un mode peut exprimer différentes modalités (ex : le
subjonctif peut exprimer le souhait, la volonté, le doute et la crainte).
C’est pour cette raison qu’on ne peut pas dire qu’un mode exprime en soi
une modalité, même s’il « renseigne sur l’attitude de l’énonciateur face à son
énoncé » (Grammaire du français). C’est aussi pour cela que le conditionnel ne peut
être considéré comme un mode.
En outre, certains adverbes (peut-être, évidemment...), ou encore des faits de
prosodie (intonation...) ou l’ordre des mots permettent de distinguer les diverses
modalités exprimées par le verbe.
2. Les modes personnels
Les modes personnels distinguent les personnes au moyen de désinences
spécifiques. Ils permettent de marquer les différents degrés d’actualisation du
procès signifié par le verbe en le situant par rapport à une personne, voire à un
temps.

3
a) L’indicatif
L’indicatif possède le système temporel le plus complet car il peut situer le
procès dans trois époques : le passé, le présent et le futur. L’indicatif pose le
procès dans le monde de ce qui est tenu pour vrai par l’énonciateur (et ce dans
les trois époques) si la phrase est de modalité déclarative (ex : Pierre travaille) ou
comme momentanément indécidable (mais en attente de vérification) si la modalité
est interrogative (ex : Pierre travaille-t-il ?).
Rmq : certaines formes de l’indicatif ont, par extension de leur valeur de
base, une valeur modale. L’imparfait est ainsi propre à évoquer
des procès déclarés comme totalement exclus de l’actualité du
locuteur (ex : Si seulement Pierre travaillait !)
b) Le subjonctif
Le subjonctif est plus limité en formes temporelles que l’indicatif. Au
subjonctif, le procès est déclaré comme appartenant à l’ordre des possibles
(que ce monde possible soit ou non effectivement vérifié dans la réalité.
Ex : Que Pierre travaille !
Je regrette que Pierre travaille (= il pourrait ne pas le faire).
c) L’impératif
L’impératif est quant à lui essentiellement tourné vers le futur. À ce mode, le
procès fait l’objet d’une injonction, d’un ordre adressé à l’interlocuteur :
Ex : Pierre, travaille !

4
Cl : Contrairement aux modes impersonnels (infinitif, participe et gérondif, qui ne
varient pas en personne ni en temps et constituent des formes limites du
verbe, proches d’autres catégories grammaticales, respectivement nominale,
adjectivale et adverbiale), les modes personnels appartiennent pleinement à
la morphologie verbale et permettent d’actualiser le procès, en donnant
une information sur la conformité de l’énoncé avec la réalité (d’où leur valeur
modale).
1
/
4
100%