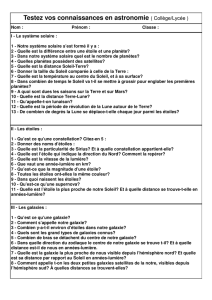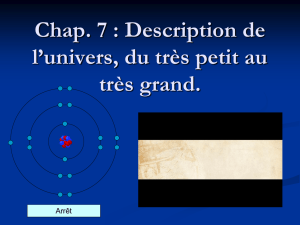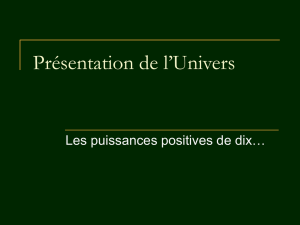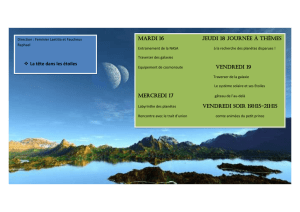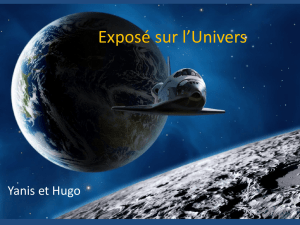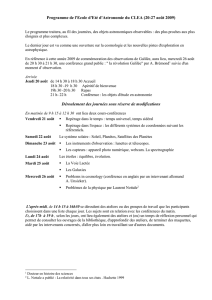Le Système Solaire Aussi loin que je puisse voir dans le Futur

Le Système Solaire
Aussi loin que je puisse voir dans le Futur, aussi loin que l'oeil humain puisse voir; vois la vision du monde et
toutes les merveilles qui s'y trouvent. Alfred Lord Tennyson, 1842
Notre système solaire consiste en une étoile moyenne appelée le Soleil, les
planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et Pluton. Il
inclue: les satellites des planètes; un certain nombre de comètes, d'astéroïdes et le milieu interplanétaire. Le
Soleil est la plus riche source d'énergie électromagnétique du système solaire (surtout dans la forme de sa chaleur
et de sa lumière)
FORMATION DU SYSTEME SOLAIRE
Le Système solaire est né il y a 4,55 milliards d'années dans une nébuleuse solaire. Toutes les particules de cette
nébuleuse, reste d'une supernova, se sont mises tranquilement à tourner et à s'attirer les unes les autres. A force
de tourner, ce nuage s'est échauffé et au centre, la matière s'est contractée sur elle-même, ce qui a donné
naissance à une étoile, notre Soleil.
COMPOSITION
Le Système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, de huit planètes depuis le 24/08/06 (après que l'assemblée
générale de l'Union astronomique internationale (UAI) a décidé à Prague de déchoir Pluton de son statut de
planète), de cent cinquante neuf satellites gravitant autour de ces planètes et de nombreux petits astres appelés
météorites, astéroïdes, comètes.... Le Soleil, coeur du Système solaire, représente 99,90 % de la masse de
l'ensemble
Le Soleil renferme 99,85% de toute la matière du système solaire. Les planètes, qui sont formées à partir du
même disque de matériel qui forme le Soleil, contiennent seulement 0,135% de la masse du système solaire.
Jupiter contient plus que deux fois la matière de toutes les autres planètes misent ensembles. Les satellites des
planètes, les comètes, les astéroïdes, les météorites et le milieu interplanétaire constituent le 0,015% qui reste.
SITUATION
Le Système solaire est situé à l'avant-bras de notre galaxie, la Voie lactée, qui mesure 100_000 années lumière et
compte un nombre inimaginable d'étoiles. Tout comme les autres étoiles, le Soleil toune autour du coeur de la
Voie lactée.
STRUCTURE: généralités
Le principal corps céleste du système solaire est le Soleil, une étoile naine jaune de la séquence principale de
type G2 qui contient 99,86 % de toute la masse connue du système solaire et le domine gravitationnellement3.
Jupiter et Saturne, les deux plus massifs objets orbitant autour du Soleil, regroupent à eux deux plus de 90 % de
la masse restante.
La plupart des grands objets en orbite autour du Soleil le sont dans un plan proche de celui de l’orbite terrestre,
nommé écliptique. Typiquement, le plan d’orbite des planètes est très proche de celui de l’écliptique tandis que
les comètes et les objets de la ceinture de Kuiper ont pour la plupart une orbite qui forme un angle
significativement plus grand par rapport à lui.
Toutes les planètes et la plupart des autres objets orbitent dans le même sens que la rotation du Soleil, c’est-à-
dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre du point de vue d’un observateur situé au-dessus du pôle
nord solaire. Certains objets orbitent dans un sens rétrograde, comme la comète de Halley.
Les orbites des principaux corps du système solaire, à l’échelle.
Les trajectoires des objets gravitant autour du Soleil suivent les lois de Kepler. Ce sont approximativement des
ellipses dont l'un des foyers est le Soleil. Les orbites des planètes sont quasiment circulaires. Celles des corps
plus petits présentent des excentricités diverses et peuvent être fortement elliptiques. C'est notamment le cas des
comètes et de certains autres petits corps, de certaines planètes naines et plus généralement des objets
transneptuniens y compris ceux de la ceinture de Kuiper et du Nuage d'Oort.

La distance d'un corps au Soleil varie au cours de sa rotation autour du Soleil. On appelle le point le plus proche
du Soleil de l'orbite d'un corps sa périhélie, le plus éloigné étant son aphélie.
De façon informelle, le système solaire est souvent divisé en zones distinctes. Le système solaire interne inclut
les quatre planètes telluriques et la ceinture d’astéroïdes. Le reste du système peut être considéré simplement
comme système solaire externe4 ; d’autres séparent la région au-delà de Neptune des quatre géantes gazeuses5.
La majorité des planètes du système solaire possède leur propre système secondaire. Les corps planétaires en
rotation autour d'une planète sont appelés satellites naturels ou lunes. La plupart des plus grands satellites
naturels évoluent sur une orbite synchrone, présentant toujours la même face à la planète autour de laquelle ils
gravitent. Les quatre plus grandes planètes ont également un anneau planétaire.
VOISINAGE
Le voisinage immédiat du système solaire est connu sous le nom de nuage interstellaire local, une zone
relativement dense à l'intérieur d'une région qui l'est moins, la Bulle locale. Cette bulle est une cavité du milieu
interstellaire, en forme de sablier d'environ 300 années-lumière de large. La bulle contient du plasma à haute-
température de façon très diluée, ce qui suggère qu'elle est le produit de plusieurs supernovae récentes82.
On compte relativement peu d'étoiles distantes de moins de 10 années-lumière du Soleil. Le système le plus
proche est celui d'Alpha Centauri, un système triple distant de 4,4 années-lumière. Alpha Centauri A et B sont
deux étoiles proches ressemblant au Soleil, Alpha Centauri C (ou Proxima Centauri) est une naine rouge orbitant
la paire à 0,2 année-lumière d'elle. On trouve ensuite les naines rouges de l'étoile de Barnard (6 années-lumière),
Wolf 359 (7,8 années-lumière) et Lalande 21185 (8,3 années-lumière). La plus grande étoile à moins de 10
années-lumière est Sirius, une étoile brillante deux fois plus massive que le Soleil autour de laquelle orbite une
naine blanche nommée Sirius B ; elle est distante de 8,6 années-lumière. Les autres systèmes dans ces 10 années-
lumière sont le système binaire de naines rouges Luyten 726-8 (8,7 années-lumière) et la naine rouge solitaire
Ross 154 (9,7 années-lumière)83. La plus proche étoile simple analogue au Soleil est Tau Ceti, distante de 11,9
années-lumière ; elle possède 80 % de la masse du Soleil, mais seulement 60 % de sa luminosité84. La plus
proche exoplanète ressemblant à la Terre que l'on connait, Gliese 581 c, est située à 20,4 années-lumière.
FUTUR
La chaleur dégagée par le Soleil augmente au fil du temps. On peut extrapoler qu'à très long terme (plusieurs
centaines de millions d'années) elle atteindra un niveau tel que la vie sera impossible sur Terre.
Dans plus de cinq milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, qui se seront transformées
en hélium, et changera de structure. Son noyau se contractera mais l'étoile entière deviendra beaucoup plus
volumineuse. Il devrait se transformer en géante rouge, 100 fois plus grande qu'à l'heure actuelle. Les planètes
les plus proches, Mercure et Vénus, devraient être détruites.
Il entamera alors un nouveau cycle de fusion avec l'hélium fusionnant en carbone (et oxygène) dans son cœur, et
l'hydrogène fusionnant en hélium dans une couche périphérique du cœur. Dans cette configuration, il aura «
soufflé » son enveloppe externe, devenant une sous-géante, environ 10 fois plus grande qu'actuellement.
Il va ensuite brûler son hélium assez rapidement, à la fin de ce cycle il regonflera de manière encore plus
importante, grillant complètement la Terre au passage.
Une fois ses réserves d'énergie nucléaire complètement consommées, le Soleil va s'effondrer sur lui-même et se
transformer en naine blanche très dense et peu lumineuse. Il refroidira petit à petit et finira par ne plus rayonner
ni lumière ni chaleur, il sera alors parvenu au stade de naine noire.
Le système solaire fait le tour de la Galaxie en 250 millions d'années. En même temps, il oscille de part et d'autre
du plan galactique avec une période de 2 x 33 millions d'années. Il traverse donc ce plan toutes les 33 millions
d'années ce qui constitue également la durée moyenne des étages géologiques. Ces étages sont définis d'après
d'importants changements dans la faune et la flore, parfois dus à des cataclysmes comme au passage Permien-
Trias ou au passage Crétacé-Tertiaire. On peut penser que ces changements sont dus à des glaciations résultant
de la rencontre de la Terre avec des nuages d'électrons du plan galactique. Les dernières glaciations, celles du
Quaternaire, se sont produites alors que le système solaire traversait le plan de la Galaxie en allant du Sud vers le
Nord.[réf. nécessaire] C'est une explication qui peut indiquer pourquoi les glaciations étaient beaucoup plus
prononcées dans l'hémisphère Nord lequel recevait directement les électrons des nuages du plan galactique.
HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE
Autrefois, l'homme croyait que la Terre était plate et au centre de l'univers, que c'était le Soleil, les étoiles et les
autres planètes qui tournaient autour d'elle. Les Grecs ont été les premiers à découvrir qu'elle était une sphère.
Au XVIème siècle, l'astronome polonais Nicolas Copernic affirma que la Terre et les autres planètes tournaient
autour du Soleil et sur elles-mêmes.

En 1609, quand Galilée a réalisé la première lunette astronomique à oculaire divergente, il put constater la
ressemblance de la Lune avec notre Terre. Il a été le premier à découvrir les quatre principaux satellites de
Jupiter d'où le nom de satellites galiléens, les taches du Soleil lui permirent de voir la rotation du Soleil, les
phases de Vénus… Toutes ses découvertes ont pu confirmer le système de Copernic.
Jusqu'en 1609, les astronomes pensaient que les orbites des planètes étaient des cercles mais Keplers Johannes
découvrit trois lois portant son nom : les deux premières en 1609 et la troisième en 1619. La première loi de
Kepler prouve que l'orbite des planètes est une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. La seconde loi de
Kepler dit que le rayon vecteur Planète - Soleil balaie des aires égales en des temps égaux. La troisième loi de
Kepler montre que la distance au Soleil et la vitesse de révolution des planètes sont liées.
Quand Huygens a inventé une combinaison de lentilles qui élimine l'aberration chromatique, il put découvrir
l'anneau de Saturne et le satellite Titan en 1655. En observant Mars, il découvrit sa rotation et sa période.
En 1665, Cassini Jean Dominique décrit la Grande Tache Rouge de Jupiter. En observant Saturne, il trouva
quatre satellites supplémentaires :
- Japet en 1671 ;
- Rhéa en 1672 ;
- Théthys ;
- Dioné en 1684.
De plus, Cassini découvrit dans l'anneau de Saturne une division qui porte depuis son nom. Nous lui devons de
nombreux détails sur Jupiter, Vénus et Mars.
Quelques années plus tard, en 1687, Newton découvrit la loi de la gravitation universelle, ce qui donna la
possibilité, en 1846, à Le Verrier, de calculer l'emplacement de Neptune à cause des perturbations causées par le
mouvement d'Uranus.
En 1705, quand Halley a calculé l'orbite et le temps que mettait pour accomplir un tour d'orbite la comète portant
son nom, il a été le premier astronome à prouver que cette comète qu'il avait observée en 1682, était la même que
celle observée en 1456, 1531 et 1607.
En 1930, Pluton fut découverte par hasard par Clyde Tombaugh. En comparant des photographies d'étoiles, il
constata qu'une étoile se déplaçait très lentement dans le ciel, c'était Pluton.
Distance
(AU)
Rayon
(Terre)
Masse
(Terre)
Rotation
(Terre)
# Lunes
Inclinaison
Orbitale
Excentricité
Orbitale
Densité
(g/cm3)
Soleil
0
109
332,800
25-36*
9
---
---
1,410
Mercure
0,39
0,38
0,05
58,8
0
7
0,2056
5,43
Vénus
0,72
0,95
0,89
244
0
3,394
0,0068
5,25
Terre
1,0
1,00
1,00
1,00
1
0,000
0,0167
5,52
Mars
1,5
0,53
0,11
1,029
2
1,850
0,0934
3,95
Jupiter
5,2
11
318
0,411
16
1,308
0,0483
1,33
Saturne
9,5
9
95
0,428
18
2,488
0,0560
0,69
Uranus
19,2
4
15
0,748
15
0,774
0,0461
1,29
Neptune
30,1
4
17
0,802
8
1,774
0,0097
1,64
Pluton
39,5
0,18
0,002
0,267
1
17,15
0,2482
2,03

Soleil
L'humanité ne restera pas éternellement sur la Terre, mais dans sa quête de lumière et d'espace sera d'abord timidement
pénétrer au-delà des confins de l'atmosphère, et plus tard va conquérir pour lui-même tout l'espace près du Soleil. -
Konstantin E. Tsiolkovsky
Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est une étoile de type naine jaune. C'est l'étoile centrale du
système solaire. Il est composé d'hydrogène (74 % de la masse ou 92,1 % du volume) et d'hélium (24 % de la
masse ou 7,8 % du volume)1. Autour de lui gravitent la Terre, 7 autres planètes, 5 planètes naines, des
astéroïdes, des comètes et de la poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86 % de la masse du système solaire
ainsi constitué (Jupiter représente plus des 2/3 de tout le reste).
L’énergie solaire transmise par rayonnement, rend possible la vie sur Terre par apport de chaleur et de lumière,
permettant la présence d’eau à l’état liquide et la photosynthèse des végétaux. La polarisation naturelle de la
lumière solaire, éventuellement réverbérée par la lune ou par des matériaux tels que l'eau ou les cuticules
végétales est utilisée par de nombreuses espèces pour s'orienter dans l'espace.
Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques
observés sur notre planète.
La densité thermique à la surface de la Terre est en moyenne à 99,97 % ou 99,98 % d’origine solairenote 2.
Comme pour tous les autres corps, ces flux thermiques sont continuellement émis dans l'espace, sous forme de
rayonnement infrarouge ; la Terre restant ainsi en « équilibre dynamique ».
Le Soleil fait partie d’une galaxie constituée de matière interstellaire et d’environ 234 milliards d’étoiles
(estimation 2009) : la Voie lactée. Il se situe à 15 parsecs du plan équatorial du disque, et est distant de 8 600
parsecs (environ 25 000 années-lumière) du centre galactique.
Le demi-grand axe de l’orbite de la Terre autour du Soleil (improprement appelé « distance de la Terre au Soleil
») 149 597 870 km, est la définition originale de l’unité astronomique (ua). Il faut 8 minutes (et une vingtaine de
secondes) pour que la lumière du Soleil parvienne jusqu’à la Terre2.
Le Soleil est la principale caractéristique de notre système solaire. Il est le plus grand objet et contient environ
98% de la masse du système solaire totale. Cent neuf Terres seraient nécessaires pour s'adapter à travers de Sun
le disque, et son intérieur pouvait contenir plus de 1,3 millions de terres. Le soleil est visible couche extérieure
est appelée la photosphère et a une température de 6.000 ° C (11.000 ° F). Cette couche a un aspect marbré dû à
des éruptions turbulentes d'énergie à la surface.
L'énergie solaire est créé profondément dans le noyau du Soleil. C'est ici que la température (15.000.000 ° C;
27.000.000 ° F) et de pression (340 milliards de fois la pression atmosphérique de la Terre au niveau de la mer)
est si intense que des réactions nucléaires ont lieu. Cette réaction provoque quatre protons ou noyaux
d'hydrogène fusionnent pour former une particule alpha ou noyau d'hélium. La particule alpha est d'environ 0,7
pour cent de moins massive que les quatre protons. La différence de masse est expulsé de l'énergie et est réalisée
à la surface du Soleil, par un processus connu sous le nom de convection , où elle est libérée sous forme de
lumière et de chaleur. L'énergie produite à Sun de base de la prend un million d'années pour atteindre sa surface.
Chaque seconde 700 millions de tonnes d'hydrogène sont converties en hélium cendres . Dans le processus de 5
millions de tonnes d'énergie pure est libéré et, par conséquent, que le temps passe sur le Soleil devient plus léger.
Le soleil semble avoir été actif depuis 4,6 milliards d'années et a assez de carburant pour se poursuivre pendant
encore cinq milliards d'années. À la fin de sa vie, le Soleil va commencer à l'hélium en éléments plus lourds
fusible et de commencer à gonfler, deviendra assez grosse pour engloutir la Terre. Après un milliard d'années
comme une géante rouge , elle s'effondrera soudainement en une naine blanche - le produit final d'une étoile
comme le nôtre. Il peut prendre un trillion d'années à se refroidir complètement.
Le Soleil occupe une position périphérique à 28000 années lumière du centre, autour duquel il tourne à une
vitesse de 225 km/s. Il effectue une révolution en 300 millions années.

Le Soleil gravite autour du centre de la Voie lactée dont il est distant d’environ 25 à 28 000 années-lumière. Sa
période de révolution galactique est d’environ 220 millions d’années, et sa vitesse de 217 km⋅s-1, équivalente à
une année-lumière tous les 1400 ans (environ), et uneunité astronomique tous les 8 jours4.
COMPOSITION
Le Soleil est une étoile de 1 392 000 km de diamètre (109 fois le diamètre de la Terre) parmi les milliards de
notre galaxie, la Voie lactée. Il est la principale source d'énergie, de lumière et de chaleur dans le Système
solaire, ce qui a permis la vie sur Terre. C'est aussi la seule étoile dont il est possible d'observer la composition
de près. Le Soleil ne tourne pas aussi rond partout : alors que sa surface effectue une révolution tous les 25,40
jours à l'équateur, il ne lui faut pas moins de 36 jours aux pôles. Cette rotation est responsable de l'activité. En
tournant sur lui-même il crée un champ magnétique 5 000 fois plus intense que celui de la Terre.
L'énergie solaire se crée profondément dans le noyau du Soleil. C'est là où la température (15 000 000 °C) et la
pression (340 milliards de fois la pression terrestre au niveau de la mer) est si intense que des réactions
nucléaires ont lieu. Ces réactions provoquent la fusion de quatre protons (noyaux d'hydrogène) pour former une
particule alpha (noyau d'hélium). La particule alpha est environ 0,70 % moins massive que les quatre protons. La
différence de masse est transformée en énergie et transportée vers la surface du Soleil, par un processus de
convection, où elle est libérée sous forme de lumière et de chaleur. L'énergie générée dans le noyau met un
million d'années pour atteindre la surface. Chaque seconde, 700 millions de tonnes d'hydrogène sont converties
en hélium. Dans le processus, 5 millions de tonnes d'énergie pure sont libérées. La chromosphère est située au-
dessus de la photosphère. L'énergie solaire passe à travers cette région sur son chemin depuis le centre du Soleil.
LA STRUCTURE INTERNE DU SOLE
HISTOIRE NATURELLE
Le Soleil est une étoile âgée de 4,6 milliards
d’années, soit à peu près la moitié de son
chemin sur la séquence principale5. On admet
généralement qu’il s’est formé sous l’effet des
ondes de choc produites par une (ou plusieurs)
supernova(e) sur une nébuleuse dont elle(s)
étai(en)t même peut-être issue(s).
Dans son état actuel, le cœur du Soleil
transforme à chaque seconde plus de 4 millions
de tonnes de matière (de masse) en énergie qui
est transmise aux couches supérieures de l’astre
et émise dans l’espace sous forme de
rayonnement électromagnétique (lumière,
rayonnement solaire) et de flux de particules (vent solaire).
Durant les 7,6 milliards d'années6 à venir, le Soleil épuisera petit à petit ses réserves d’hydrogène ; sa brillance
augmentera d’environ 7 % par milliard d’années, suite à l'augmentation du rythme des réactions de fusion par la
lente contraction du cœur.
Lorsqu’il sera âgé de plus de 12 milliards d’années, l’équilibre hydrostatique sera rompu. Le noyau se
contractera et s'échauffera fortement tandis que les couches superficielles, dilatées par le flux thermique croissant
et ainsi partiellement libérées de l’effet gravitationnel, seront progressivement repoussées : le Soleil se dilatera et
se transformera en géante rouge. Au terme de ce processus, le diamètre du Soleil sera environ 100 fois supérieur
à l’actuel ; il dépassera l’orbite de Mercure et de Vénus. La Terre, si elle subsiste encore, ne sera plus qu’un
désert calciné.
C'est durant cette phase de gonflement que son cœur en contraction arrivera aux environs de 100 millions de
kelvins, initiant les réactions de fusion de l'hélium (voir : réaction triple-alpha). La cendre (d'hélium) deviendra
elle-même carburant, le cœur du Soleil sera lancé dans un second cycle de fusion. Néanmoins cet allumage sera
brutal (voir : flash de l'hélium), le réarrangement des couches du Soleil fera diminuer son diamètre jusqu'à ce
qu'il se stabilise à une taille de plusieurs fois (jusqu'à 10 fois) sa taille actuelle, soit d'environ 10 millions de km
de diamètre. Il sera devenu une sous-géante.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%