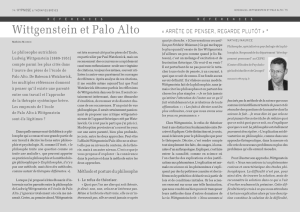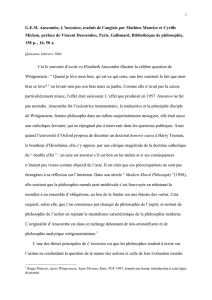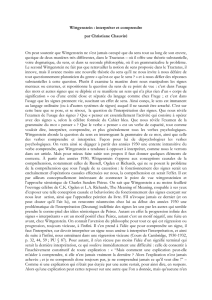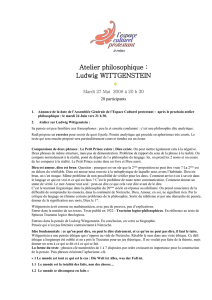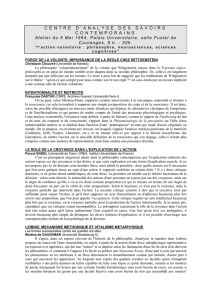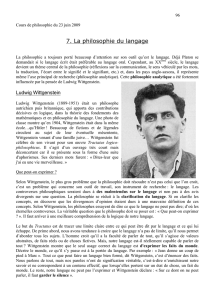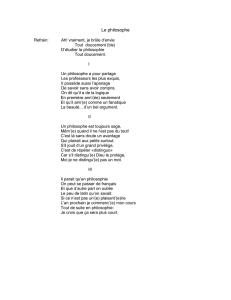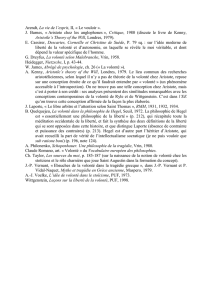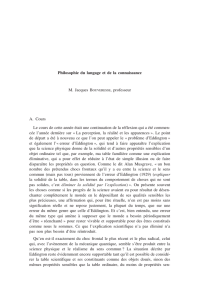Wittgenstein et Palo Alto

Wittgenstein et Palo Alto
Communication à la cinquième journée de Rencontre de Paradoxes, 14 octobre 2006
Mathieu Maurice, consultant
Résumé: Le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951) compte parmi
les plus cités dans l’œuvre des Pères de l’école de Palo Alto. De Bateson à
Watzlawick, les multiples références donnent à penser qu’il existe une parenté entre
son travail et l’approche de la thérapie systémique brève.
Les emprunts de l’Ecole de Palo Alto à Wittgenstein sont-ils légitimes ? Dans quelle
mesure sont-ils fidèles à ce philosophe qui a consacré une grande partie de son travail
à décrire les liens entre philosophie et psychologie. Si, comme il l’écrit « le
philosophe traite une question comme on traite une maladie », que peuvent apporter
au praticien la philosophie et la méthodologie philosophique (« En philosophie, il n’y
a pas une méthode, mais bien des méthodes, comme autant de thérapies différentes »).
————
Lorsque j’ai proposé à Irène Bouaziz d’intervenir sur les parentés entre la philosophie
de Ludwig Wittgenstein et l’Ecole de Palo Alto, j’ignorais totalement où cela me
mènerait. Certes, au premier abord, Wittgenstein est très souvent cité par les Pères de
l’Ecole, en particulier par Paul Watzlawick, mais un recensement des occurrences a
rapidement cassé mon enthousiasme : seule une vingtaine de citations, toujours les
mêmes, souvent utilisées à contre sens parsèment les ouvrages de référence. Après
analyse de ces citations, il me semble même aujourd’hui que Paul Watzlawick
détourne parfois les réflexions de Wittgenstein dans ses livres. Il serait certainement
intéressant, dans une démarche d’érudition, de recenser et de discuter chacune de ces
occurrences. D’un point de vue philosophique, il serait certainement passionnant de
proposer une critique wittgensteinienne de l’apparat théorique créé par Watzlawick.
Ce n’est pas le parti que j’ai pris ici. Ma déception provisoire m’a ouvert les yeux sur
une autre parenté, bien plus profonde, je crois, entre les deux approches. Peut-être
l’affinité Wittgenstein/Palo Alto ne se situe-t-elle pas au niveau du contenu, de la
théorie, mais à un autre niveau. C’est ce que je vous propose d’explorer : la
connivence dans la posture et dans la méthode entre les deux approches.
Méthode et posture du philosophe
1- Le refus de théoriser
« Quoi que l’on me dise qui soit théorie, je dirai : non, non, cela ne m’intéresse pas.
Même si la théorie était vraie, elle ne m’intéresserait pas, elle ne serait jamais ce après
quoi je cherche. » (Conversations recueillies par Frédéric Waisman) Ce qui me frappe
le plus quand j’essaie de lire Wittgenstein (d’ailleurs un peu comme quand je lis
Bateson), c’est un mélange d’excitation et de frustration théorique. Où veut-il en venir
? Il est perturbant de ne pas pouvoir le rattacher à une école de pensée, à un courant, à
quoi que ce soit de connu. Il ne fonde aucun savoir définitif. Il n’élabore aucun
modèle. Wittgenstein fait de la philosophie, sans jamais citer les philosophes et en
partant des choses les plus simples : « Je ne fais jamais qu’attirer l’attention de l’autre
sur ce qu’il fait véritablement et je m’abstient de toute affirmation ». « Les faits à
décrire sont les plus ordinaires, ceux que nous avons sous les yeux en permanence. »

Chez Wittgenstein, le refus de théoriser tient à une distinction fondamentale entre
Décrire et Expliquer. Cette distinction, est, je crois, aussi éclairante pour le
philosophe que pour le thérapeute. Décrire, c’est rendre compte tout simplement des
faits, des usages, à la manière d’un anthropologue. Expliquer, c’est faire entrer la
causalité, comme en science où l’on cherche des explications et des justifications aux
phénomènes. L’explication est normale en science où les phénomènes s’expliquent
par des hypothèses causales et des inférences hypothético-déductives à partir de lois
et de conditions initiales. Or les sciences exercent sur nous une telle fascination que
nous voudrions bien pouvoir transposer leurs méthodes dans d’autres domaines de la
vie. Wittgenstein écrit « Nous sommes si fascinés par la méthode de la science que
nous sommes irrésistiblement tentés de poser et de résoudre des questions de la
manière dont la science le fait… Je veux dire ici que cela ne peut jamais être notre
tâche de réduire quoi que ce soit à quoi que ce soit, ou d’expliquer quoi que ce soit.
La philosophie est réellement purement descriptive. » L’explication est dévastatrice
en philosophie, comme dans une approche thérapeutique, dans la mesure où elle crée
de nouveaux problèmes en plus des problèmes qu’elle entend résoudre.
Pour illustrer son approche, Wittgenstein écrit « Nous rencontrons ici un phénomène
curieux et caractéristique des études philosophiques. La difficulté n’est pas, pour ainsi
dire, de trouver la solution, mais de reconnaître la solution dans ce qui a l’air d’en être
seulement la prémisse. Cette difficulté tient je crois à ce que nous attendons à tort une
explication alors qu’une description constitue la solution de la difficulté, pour peu que
nous lui donnions sa juste place, que nous nous arrêtions à elle, sans chercher à la
dépasser. C’est cela qui est difficile, s’arrêter ! » Zettel
2- Poser les problèmes au bon niveau
À aucun moment de sa vie, Wittgenstein n’a pris parti dans les débats philosophiques.
Prendre parti n’avait pour lui, à strictement parler, aucun sens : tant que nous
demeurons prisonniers de tiraillements, de tensions, de propos contradictoires, c’est,
selon lui, que nous n’avons pas encore posé le problème à un niveau satisfaisant. Un
problème bien posé est un problème résolu… La philosophie de Wittgenstein a cela
d’exigent qu’elle force à poser le problème toujours plus profondément. Mais ce qu’il
y a de plus profond est souvent aussi ce que nous avons sous les yeux.
Prenons un exemple : pour notre philosophe, il est totalement insensé de prendre parti
pour ou contre l’existence de l’inconscient, ou bien de choisir son camp entre des
approches psychologiques mentalistes, cognitivistes ou béhavioristes. Prendre parti
n’a pas plus de sens que de tomber dans un relativisme de bon aloi selon lequel toutes
ces approches comporteraient « une part de vrai ». Le problème pour Wittgenstein
n’est pas de se prononcer pour leur fausseté ou leur véracité totale ou partielle. Le
problème est déjà, bien en amont, de s’interroger sur l’intelligibilité de ces approches
et sur leurs présupposés communs. Les approches contradictoires reposent souvent sur
des paradigmes communs.
Lorsque Wittgenstein étudie le thème de la liberté, son approche est à rebours de la
plupart des théories. Pour certains philosophes, la question de la liberté est la question
de la cause de nos actions : si elles sont causées par l’extérieur ou par des
conditionnements, nous ne sommes pas libres ; si elles sont causées par la volonté,
nous sommes libres. Wittgenstein refuse de choisir et s’interroge : quel sens cela a-t-il
de parler de causes pour nos actions ? Sa réflexion part des situations les plus simples
: comment un enfant apprend-il qu’il fait quelque chose volontairement ? Comment

apprenons-nous à manier le champ lexical de la liberté ? Dans quels contextes
l’utilisons-nous ?
Pour lui, le philosophe n’a pas pour mission de trancher les questions mais d’élucider
les concepts et de poser les problèmes à un niveau tel qu’ils ne se posent plus. Pour
reprendre notre exemple, il ne s’agit pas de savoir ce qui cause nos actions mais si le
concept de causalité est adapté pour décrire ce qui se passe quand nous agissons.
Il me semble que cette exigence wittgensteinienne de poser les problèmes à un niveau
satisfaisant se transpose facilement à la thérapie : entre la plainte exprimée par le
patient et le problème construit dans l’échange thérapeutique, les reformulations et les
recadrages permettent de se frayer un chemin entre les contradictions exprimées. Cela
signifie aussi qu’il y a des façon de poser un problème qui risquent fort de le
renforcer, voire de le rendre totalement insoluble.
3- Elucider les concepts, se faire une représentation synoptique
Face à un problème philosophique, l’approche de Wittgenstein ressemble à l’approche
du thérapeute par un autre trait : Wittgenstein cherche à décrire, élucider les concepts
en construisant une sorte de carte du problème, de représentation synoptique. Pour
cela, il suit une règle de conduite simple dans l’intention, mais exigeante dans la
réalisation : s’en tenir à la surface, questionner l’utilisation des concepts sans chercher
à expliquer. La représentation synoptique sert de référence pour repérer facilement ce
qui fait sens et ce qui est inintelligible dans un raisonnement ou un discours.
Il écrit : «Pourquoi la philosophie est-elle aussi compliquée? Elle devrait pourtant être
tout à fait simple. La philosophie défait dans notre pensée les noeuds que nous y
avons introduits de façon insensée; mais c’est pour cela qu’il lui faut accomplir des
mouvements aussi compliqués que le sont ces noeuds. La complexité de la
philosophie n’est pas celle de sa matière mais celle des méandres de notre pensée.»
Elaborer une carte du problème, construire une représentation synoptique n’est pas
difficile en soi, mais du fait de la confusion introduite par le langage dans notre façon
de concevoir le monde et d’interpréter les événements. La métaphore du nœud a un
intérêt principal : elle met l’accent sur le fait qu’il n’y a rien à chercher derrière le
nœud qui nous est présenté. Les faits sont là et demandent simplement à être ré
agencés, remaniés, réorganisés. Ils prennent alors un sens nouveau dans un contexte
plus large.
Pour construire une représentation synoptique, en philosophie, Wittgenstein propose
de revenir au langage : les mots, les usages et les jeux de langage, les formes de vie
dans lesquelles ces jeux de langage prennent leur sens. En clarifiant ces mots, ces
usages, ces jeux de langage, il en arrive à dissoudre les problèmes, souvent dus au fait
que nous isolons une situation ou une problématique de son contexte global, de la vie
dans laquelle il prend sa place. Le concept de représentation synoptique peut dès lors
se comprendre à plusieurs niveaux et de différentes façons : au sens strict, il s’agit de
la matrice grammaticale et logique à partir de laquelle nos énoncés prennent sens ou
non. Dans un sens plus souple, il s’agit de ce à partir de quoi nos façons de penser
trouvent leur sens.
Visée de la philosophie
1- Lutter contre l’ensorcellement du monde par le langage
Dans sa philosophie, Wittgenstein accorde une importance primordiale au langage.
Pour lui, l’usage que nous faisons des mots, de la grammaire et des jeux de langage

nous ensorcelle et nous piège. Nos manières de penser habituelles nous amènent à
donner un semblant d’intelligibilité à de simples non sens qui s’évanouissent d’eux-
mêmes dès lors que nous les confrontons aux faits et aux descriptions les plus
simples. Les problèmes philosophiques viennent des nœuds que fait notre langage.
Pourquoi accorder une telle importance au langage ? C’est que, pour Wittgenstein
comme pour toute une partie de la tradition philosophique, nous sommes des êtres de
langage. La façon dont nous nous posons les problèmes a une influence décisive sur
leur résolution : « Les problèmes qui surviennent lorsque nous mésinterprétons les
formes de notre langage ont le caractère de la profondeur. Ce sont des inquiétudes
profondes ; leurs racines sont aussi profondes que les formes de notre langage et leur
signification a autant d’importance que notre langage ».
En philosophie, nous sommes en permanence trompés par des équivoques
grammaticales qui masquent des différences de logique profondes. Nous finissons par
poser des questions qui se mettent à ne plus avoir de sens. Le langage nous entraîne
dans sa folie. Wittgenstein nous propose une thérapie à cette folie. C’est pourquoi sa
philosophie consiste à décrire l’usage des mots : il décrit les jeux de langage, c’est-à-
dire les pratiques, les activités, les actions et les réactions propres aux contextes
caractéristiques dont fait partie l’usage canonique d’un mot. Cela lui permet de
relever les formes de langage qui prennent sens et celles qui s’avèrent disparaître
d’elles-mêmes comme de simples non-sens. Cela implique un champ d’exploration
large : un mot prend sens dans un jeu de langage qui s’inscrit lui-même dans une
forme de vie. Les mots ne trouvent leur sens que dans le contexte de leur usage et
dans leur lien les uns avec les autres.
Prenons par exemple le mot « impossible ». Un seul mot désigne des réalités
totalement différentes. Dans l’énoncé « il est impossible de traverser l’atlantique à la
nage en apnée », il désigne une impossibilité physique. Dans l’énoncé « il est
impossible de roquer aux dames », il désigne une impossibilité liée au sens et à
l’intelligibilité des concepts ; on ne peut pas plus roquer aux dames qu’on ne peut
faire un service gagnant au rugby (on ne peut roquer qu’aux échecs et on ne peut faire
un service gagnant qu’au tennis). Ces concepts sont liés à un contexte plus large de
conventions liées à des jeux. Dans l’énoncé « tu ne peux pas traverser quand le feu est
au vert », l’impossibilité est encore d’un autre type. Les confusions liées à l’usage des
mots et à leurs contextes ont des répercussions importantes : ce sont elles qui créent
les problèmes philosophiques, les entretiennent, voire en font des nœuds inextricables.
Nous croyons comprendre des non-sens… Or un non-sens a beau être au fond
inintelligible, il n’en demeure pas moins qu’il crée un problème et que ce problème
est réellement problématique pour celui qui se le pose.
La tâche du philosophe est donc de dissiper les confusions conceptuelles, de clarifier
la structure des énoncés. Dès lors, il n’y a aucune innovation possible en philosophie
(comme peut-être dans les thérapies non chimiques) : tout a déjà été dit. Le
philosophe, artisan méticuleux a pour mission de dénouer, clarifier, élucider des
concepts emmêlés.
2- Faire disparaître les problèmes philosophiques
Enfin, dernière visée du travail philosophique : le philosophe a pour finalité de faire
disparaître l’objet de son étude. Résoudre équivaut à dissoudre. Cela rend la
philosophie plus proche de la thérapie que des sciences humaines telles qu’on les
conçoit habituellement. Pour le philosophe, la tâche est achevée lorsque le problème
philosophique a disparu. Cette finalité a plus les traits d’une quête que d’un objectif
concret atteignable : en effet, le langage joue des tours et en ce domaine, rien n’est

jamais acquis. La tentation en la matière est de remplacer les concepts usagés et de les
remplacer sans rien élucider : c’est ainsi que les structures conceptuelles qui
interviennent lorsque l’on parle de l’esprit ou du cerveau sont souvent les mêmes,
signes que remplacer le matériel par l’immatériel ou inversement ne change rien à la
compréhension du problème.
Vous l’aurez compris, les questions philosophiques ne sont pas tant en quête de
réponses que de sens pour Wittgenstein. Face à une question, le philosophe
s’interroge sur le sens de la question et de ses termes : ce que nous disons a-t-il un
sens ? Ou bien sommes-nous piégés par le langage qui nous ensorcelle et nous
emmène dans ses jeux ? La philosophie de Wittgenstein est donc une cure, une
thérapie contre les maladies de l’intellect. Les problèmes philosophiques sont des
symptômes de nœuds conceptuels liés au langage. Il faut donc les dénouer pour faire
disparaître le problème, tout comme guérir une maladie consiste à la faire disparaître
et à ramener le patient à la santé. « La philosophie revient à révéler de purs et simples
non sens et à faire apparaître les bosses que l’entendement s’est faites en se tapant la
tête contre les limites du langage. Ces bosses nous font voir la valeur de cette
découverte ». Il ne s’agit pas d’être innovant pour le philosophe mais de creuser en
deçà des oppositions et des paradoxes pour clarifier la structure conceptuelle qui nous
égare. Les problèmes se résolvent alors non pas en donnant de nouvelles
informations, mais « en arrangeant différemment ce que nous avons toujours su ».
En conclusion, il me semble que Ludwig Wittgenstein nous enseigne une posture et
une méthode. Son exigence m’apparaît aussi salutaire en philosophie que dans le
cadre de la thérapie systémique. Elle s’exprime dans l’une de ses maximes : « Arrête
de penser, regarde plutôt ». Notre erreur est trop souvent de chercher des explications
là où nous devrions voir des faits en tant que phénomènes premiers. L’essentiel n’est
pas caché dans des explications ou des théories très sophistiquées mais il se donne à
nous dans les choses les plus simples. Il suffit pour cela de poser les problèmes à un
niveau adapté (le niveau auquel ils ne se posent plus) et de procéder face à eux
comme face à des nœuds : non pas en s’interrogeant sur le pourquoi du nœud, mais
plutôt sur les mouvements, les simples gestes qui vont lui rendre sa souplesse. « Quel
est ton but en philosophie ? » questionne Wittgenstein ; et il répond lui-même «
Montrer à la mouche comment se sortir du piège à mouche. »
Dans son dernier ouvrage, Savoir attendre pour que la vie change, François Roustang
cite les Carnets secrets de Wittgenstein. Je lui laisse le mot de la fin : « Lorsqu’on se
heurte à un problème, il faut cesser d’y réfléchir davantage sans quoi on ne peut s’en
dépêtrer ; il faut plutôt commencer à penser là où on parvient à s’asseoir
confortablement. Il ne faut surtout pas insister ! Les problèmes difficiles doivent tous
se résoudre d’eux-mêmes devant nos yeux. »
© M. Maurice/Paradoxes
1
/
5
100%