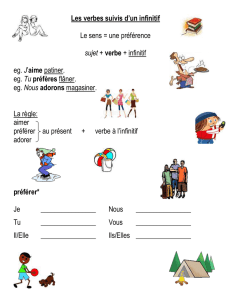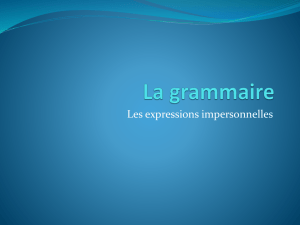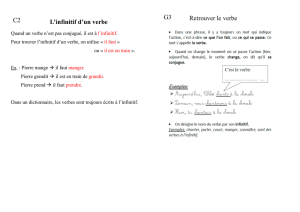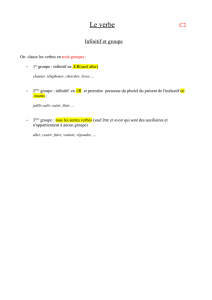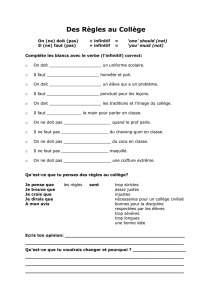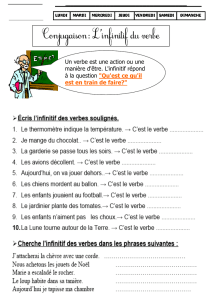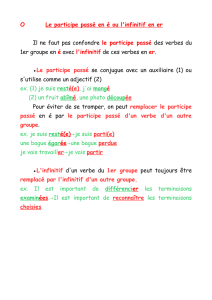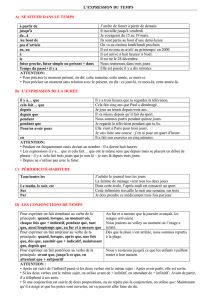L`INFINITIF

L’INFINITIF
L’infinitif est un mode dont la forme ne marque ni le temps, ni la personne, ni le nombre. On
distingue :
Une forme simple : l’infinitif présent (chanter / être chassé)
Qui s’opposent sur le plan aspectuel.
Une forme composée : l’infinitif passé (avoir chanté / avoir été chassé)
Etant invariable il est utilisée comme entrée dans le dictionnaire et comme base au classement
traditionnel des conjugaisons des verbes. Il ne présente que l’idée du procès et indétermination
temporelle et personnelle doit être levée par le contexte ou par la situation.
I. L’infinitif présent et l’infinitif passé
L’infinitif présent exprime l’inaccompli, l’infinitif passé marque l’accompli.
A. L’infinitif présent
L’infinitif présent envisage l’action en cours de réalisation. Celle-ci est située dans le temps
suivant la relation existant entre l’infinitif et le verbe principal ou le contexte. Quand l’infinitif
est en construction dépendante, il peut entretenir deux sortes de relations chronologiques avec le
verbe principal :
L’action dénotée par l’infinitif est simultanée à l’action principal qui se situe :
Dans le présent qui peut avoir une valeur générale : « Toutes les belles ont
droit de nous charmer et l’avantage d’être rencontrée la première ne doit point
dérober aux autres les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs.»
Molière
Dans le passé (passé simple et imparfait) : « Quoiqu’elle fût plus âgée que moi
elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. » Abbé Prévost
L’action dénotée par l’infinitif peut être postérieure à l’action principale
Notamment quand le verbe l’oriente vers l’avenir : « il espérait pouvoir
s’orienter.» M.Tournier
Le verbe principal peut être à un temps du passé : « Vous avez été créé pour
me tourmenter. » Balzac

B. L’infinitif passé
L’infinitif passé qui exprime l’accompli peut indiquer une relation temporelle d’antériorité à
n’importe quelle époque : « Que vous servira d’avoir tant écrit dans ce livre, d’en avoir rempli
toutes les pages de beaux caractères puisque enfin une seule rature doit tout effacer ? » Bossuet
II. Les emplois de l’infinitif
L’infinitif est considéré comme la forme nominale du verbe. Il assume des fonctions nominales et
verbales.
A. L’infinitif est le centre verbal d’une phrase
Quand l’infinitif a un rôle verbal il constitue le nœud verbal d’une phrase indépendante, principale ou
subordonnée. Il détermine la structure des compléments et il peut prendre une forme active ou
passive ou pronominale ; c’est lui qui est en relation de sélection avec le sujet et les compléments.
L’infinitif est au centre d’une indépendante. Quatre types de phrases peuvent comporter un
groupe verbal constitué autour d’un verbe à l’infinitif présent :
Dans une phrase déclarative : l’infinitif de narration : « Et la grenouille de se plaindre. » La
Fontaine
Cet emploi est familier jusqu’au XVIIe siècle. Obligatoirement introduit par de et possède un sujet
propre. La phrase ne se suffit pas à elle-même mais s’insère dans un séquence d’actions en se
rattachant à la phrase précédente par et. Sa locution temporelle lui est donnée par le contexte
narratif !; L’infinitif équivaut souvent au passé simple puisque ces récits sont souvent au passé. La
phrase marque une suite qui est souvent une conséquence.
Dans une phrase interrogative sans sujet exprimé on peut utiliser l’infinitif délibératif : « A
quoi bon travailler ? » Victor Hugo
L’infinitif exclamatif sert à exprimer un sentiment vif :
« Fuir ! Là-bas fuir ! » Mallarmé
L’infinitif peut s’employer sans sujet. Quand le sujet est exprimé, il est séparé de l’infinitif
par une pause et forme avec lui une construction segmentée ; le pronom personnel prend la
forme tonique de moi. L’absence de forme conjugué et de sujet permettent de présenter l’idée
du procès à l’état brut ; sa seule évocation dans la situation suffit à indiquer le sentiment
éprouvé.
L’infinitif est employé à la place de l’impératif pour exprimer un ordre ou un conseil. Le
sujet est celui qui lit l’énoncé : « Battre les œufs en neige. »
Le verbe d’une proposition subordonnée peut se mettre à l’infinitif : Trois types de
subordonnées peuvent comporter un verbe à l’infinitif dans des conditions bien précises :
La proposition subordonnée infinitive est privilégiée par la tradition grammaticale, sur le
modèle du latin, où elle est d’un emploi plus étendu qu’en français. Du point de vue traditionnel,
deux conditions doivent être remplies pour parler de « subordonnée infinitive » :

La proposition doit être complément d’un verbe appartenant à une série limitée : faire,
laisser, des verbes de perception comme entendre, voir, sentir et des verbes causatifs de
mouvement comme emmener, envoyer, conduire : il a emmené voir Blanche-Neige.
Elle doit avoir un sujet propre, différent de celui du verbe principal, ce qui lui donne la
structure d’une phrase complète dont le GN et le GV sont permutables. La notion même
de proposition infinitive est critiqué quand le sujet est un pronom, il prend la forme de
l’objet et se place avant le verbe principal « je me sentis défaillir » Maupassant
L’interrogative indirecte : elle ne sais plus quoi inventer
La subordonnée relative : Elle cherche une salle où fêter son anniversaire
Dans les deux derniers cas, le sujet de l’infinitif non exprimé est coréférent au sujet du verbe
principal ou générique. L’infinitif est affecté d’une nuance d’éventualité dans la relative.
B. Emploi en corrélation avec un semi-auxiliaire
Quand l’infinitif suit un auxiliaire aspectuel (aller, commencer à etc…) ou modal (devoir, pouvoir), il
entretient avec lui le même type de relation que le participe passé avec son auxiliaire. Ils forment le
centre du groupe verbal. « Et le chien se mit à tourner autour de la pièce » Maupassant
L’infinitif est le centre d’un groupe ayant une fonction nominale. L’infinitif constitue un
groupe qui peut exercer toutes les fonctions du GN :
sujet : « Gémir n’est pas de mise » Jacques Brel
Attribut du sujet : vouloir c’est pouvoir
Quand le sujet n’est pas un infinitif il doit être introduit par de « mon idéal ce serait de
travailler tranquille » Zola
Complément du verbe :
construction directe : les verbes désirer, espérer, préférer, souhaiter et
vouloir sont directement suivis de l’infinitif. (la langue classique insérait de
devant l’infinitif). L’infinitif complément de verbe de mouvement comme
partir, sortir est aussi construit directement : elle sort acheter le journal. Il
peut être introduit plus rarement par pour.
Construction indirecte : L’infinitif complément de verbe comme apprendre,
songer, s’attendre est précédé de la préposition à : il apprend à conduire un
camion. Il est relié à de avec des verbes comme douter, craindre, proposer,
ordonner, refuser : « Eléonore me proposa de sortir » B. Constant

Avec certains verbes, deux constructions de l’infinitif sont possibles.
L’infinitif complément du verbe aimer se construit avec ou sans préposition :
« Elle haïssait la lecture, n’aimait que coudre, jacasser et rire » Mauriac.
Demander est relié à l’infinitif par à quand ils ont le même sujet et par de dans
le cas contraire. Pour décider cela change le sens.
Complément de verbe impersonnel : introduit par de « il s’agit seulement d’administrer un
antidote » Flaubert
Complément du nom : « je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses ! » Baudelaire
Complément de l’adjectif : incapable de bouger
Apposition : « Aimer, boire et chanter » Flaubert
Complément circonstanciel : Il n’a pas desserré le frein à main avant de démarrer
Quelle que soit la fonction nominale, l’infinitif garde à l’intérieur de celui-ci les propriétés d’un
verbe : il peut prendre la forme active, passive d’un verbe, être modifié par une négation et il a
interprétativement un sujet.
L’infinitif précédé d’un déterminant fonctionne comme un nom véritable : « il avait un rire
de poulie mal graissée » Zola. Par conversion l’infinitif passe dans la catégorie du nom.
Beaucoup d’infinitifs constituent une entrée nominale autonome : rire, souvenir, repentir, devoir,
avoir , être, pouvoir, savoir, parler …
1
/
4
100%