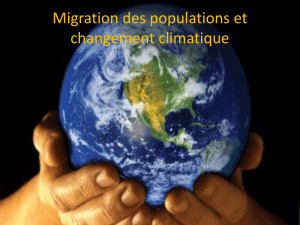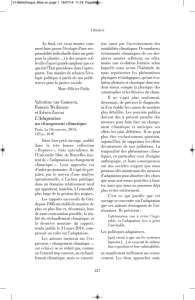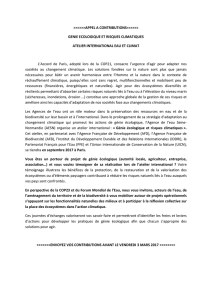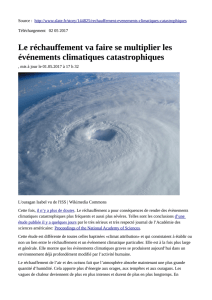WG3_Report_FR - Modem Europe

III – Working Group : Global warming/Sustainable Growth.
III – Groupe de travail : Réchauffement climatique/Croissance durable.
III – Gruppo di lavoro : Riscaldamento climatico/Crescita sostenibile.
Réchauffement de la planète et croissance durable
Vittorio Prodi – rapporteur – (PD) Italy
Bruxelles, 11-12/11/2010
4ème Congrès
4° Congresso
4th Congress

Réchauffement de la planète et croissance durable
Texte présenté en vue d’une discussion
Après les récentes crises financières mondiales, l’Europe se trouve en situation
précaire. Nous sommes aujourd’hui confrontés à une triple crise, fiscale, financière et
climatique, une démonstration du fait que les échecs connus par les anciennes
approches à la gouvernance internationale sont de moins en moins actuels en un
moment et à une époque de mondialisation croissante. Le monde dans lequel nous
vivons maintenant est étroitement interconnecté, plein d’externalités et évoluant
toujours plus rapidement. Pourtant cette situation peut aussi offrir une opportunité
d’aborder les problèmes sous-jacents d’une idéologie qui a échoué et qui est
responsable de cet état, notamment en faisant en sorte que l’idée d’adaptation au
changement climatique soit présente dans toutes les décisions politiques subséquentes.
Nous pourrons ainsi stimuler la transition vers une économie à faible intensité de
carbone et accélérer la mise en œuvre d’autres priorités stratégiques déjà identifiées
afin que la mondialisation soit bénéfique pour tous. Par le développement et l’offre de
l’accès à la connaissance grâce aux nouvelles formes données aux instruments
commerciaux, technologiques, financiers et fiscaux nous réussirons également à
redresser le déséquilibre de pouvoir existant entre les différents volets de notre
société.
En présence de mesures d’austérité et de la nécessité d’une action décisive il faudra
une politique efficace et, plus important encore, équitable. Par conséquent, élaborer
un plan d’action qui réponde à ces objectifs nous obligera à avoir une solide base de
connaissances concernant les différents éléments entrant en jeu au plan mondial,
régional et local. Nos décisions devront s’appuyer sur des piliers solides, mais au vu
de l’ambigüité inhérente associée au changement climatique, ils devront aussi être
assez souples pour réagir à des circonstances imprévues.
1. Développer la base de connaissances
Des informations de bonne qualité sont indispensables pour évaluer les incidences des
et la vulnérabilité aux changements climatiques et ensuite concevoir les besoins en
termes d’adaptation. Parmi ces informations, citons les données sur le climat, comme
les températures, les précipitations et la fréquence d’évènements extrêmes et d’autres
encore, comme la situation actuelle au niveau du sol pour différents secteurs, y
compris les ressources en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé des
personnes, les écosystèmes terrestres et la diversité biologique et les zones du littoral.
Le contexte européen fournit un cadre opportun à partir duquel nous pouvons créer
l’infrastructure d’information nécessaire. Toutefois, s’agissant d’un cadre, certains
secteurs réclament des améliorations pour atteindre un niveau d’informations tel
qu’elles résultent en une politique cohérente. En quelques mots, l’infrastructure
globale requise devra contenir des réseaux d’observation opérationnels nationaux
systématiques appropriés et offrir l’accès aux données disponibles auprès d’autres

réseaux mondiaux et régionaux. Les récentes initiatives de la Commission de l’UE
pour créer un centre d’échange d’informations servant de base de données à partir de
laquelle réaliser un ‘Système de partage d’informations sur l’environnement’
montrent toute l’importance qu’a la gouvernance dans l’orientation de tels objectifs.
En disposant de plus d’informations qui circulent mieux concernant les différentes
méthodes, modèles, ensembles de données et instruments de prédiction on peut
obtenir des plans d’adaptation plus efficaces. C’est par ces éléments que nous
pourrons disposer d’un plus vaste éventail de variables et adopter les politiques
d’adaptation cohérentes, mais souples qui sont nécessaires.
Une importance particulière revient dans ce contexte à certaines des initiatives et
programmes européens tels qu’INSPIRE, EGNOS, GMES ou Galileo qui ont recours
aux satellites et aux dispositifs de surveillance pour collecter des données géo-
référentielles à mettre à la disposition des gouvernements et agences locaux. Il va de
soi que cette activité de surveillance contribuera à la production de mesures de
prévention efficaces contre les catastrophes naturelles et fournira de précieux outils
d’intervention en cas d’urgence. A dire vrai, l’ensemble de la politique spatiale sera
dans la décennie à venir le terrain de jeu des parties prenantes politiques aussi bien
qu’industrielles, et elle devrait donc en tant que tel faire l’objet d’une analyse
approfondie et d’une planification stratégique.
Cependant le partage des données exige que nous soyons capables d’observer
l’ensemble des informations nécessaires non seulement au plan européen mais, vu
l’incertitude concernant les différentes vulnérabilités, également au plan national et
local. Les Etats devront collaborer entre eux pour arriver à la modélisation appropriée
à ces niveaux afin de définir une capacité d’adaptation à travers l’Europe. Toutes les
parties prenantes en Europe sont capables d’identifier les besoins, les contraintes, les
cadres temporels et les opportunités permettant d’aider les parties prenantes
régionales et locales à mettre au point des politiques d’adaptation musclées. Une
consolidation ultérieure de ces actions pourra venir d’un réseau d’initiatives
d’adaptation au changement climatique locales et régionales permettant de déterminer
les meilleures pratiques.
2. Intégrer l’’adaptation’ dans les politiques
Non seulement faudra-t-il collaborer pour minimiser les risques menaçant les régions
d’Europe les plus vulnérables, mais les parties prenantes devront aussi orienter
l’adaptation vers un environnement politique plus vaste. Construire sur le partage des
réseaux d’information, intégrer l’adaptation dans tous les domaines de la politique,
tout ceci devra se faire sur la base d’analyses scientifiques et économiques qui ont fait
leurs preuves. Il conviendrait d’autre part de revoir les possibilités de recentrer ou
amender les politiques pour faciliter l’adaptation secteur par secteur. Nous trouvons
un point de départ utile dans les questions formulées dans le Livre blanc de la
Commission de l’UE sur l’adaptation au changement climatique (COM(2009) 147
final):
1. Quelles sont les incidences réelles et potentielles du changement climatique
dans le secteur considéré ?
2. Quel coût a l’action/l’absence d’action ?

3. De quelle manière les mesures proposées influencent-elles les politiques
menées dans les autres secteurs ou interagissent-elles avec celles-ci ?
Au vu de la gravité des problèmes devant nous, il n’est pas étonnant que plus vite on
agit, meilleure sera notre adaptation aux effets potentiels qui nous attendent. Au
niveau du social aussi il apparaît de plus en plus clairement que ceux qui ont le moins
de ressources sont aussi les plus vulnérables au changement climatique. Pour mener
des politiques d’adaptation réussies il faut absolument répartir équitablement les
fardeaux et tenir compte de l’incidence sur l’emploi et la qualité de la vie des groupes
à bas revenu.
a. L’eau
Les résultats d’observations et les projections climatiques semblent prouver que les
ressources en eau douce sont menacées et risquent d’être fortement influencées par le
changement climatique, entraînant d’amples conséquences pour les sociétés humaines
et les écosystèmes. Le réchauffement constaté sur plusieurs décennies a été mis en
relation aux changements du cycle hydrologique à grande échelle comme : une teneur
croissante de vapeur d’eau dans l’atmosphère ; le changement du régime des
précipitations, de leur intensité et leurs valeurs extrêmes, un enneigement réduit et la
fonte des glaces, et des modifications du degré d’humidité du sol et de l’écoulement.
Pour les précipitations qui changent, on constate une forte variabilité dans l’espace et
inter-décennies.
Plusieurs lacunes subsistent encore dans nos connaissances sur les besoins en termes
d’observations et de recherche sur le changement climatique et l’eau. Les données
scientifiques et l’accès aux données sont indispensables aux fins de la gestion de
l’adaptation, et pourtant beaucoup de réseaux d’observation diminuent. Une meilleure
compréhension et modélisation des changements climatiques dans le cadre des cycles
hydrologiques à des échelles utiles pour la prise de décision s’impose. Les données
sur l’incidence du changement climatique en termes d’eau sont insuffisantes – surtout
eu égard à la qualité de l’eau, aux écosystèmes aquatiques et aux eaux souterraines –
cette insuffisance concernant aussi les dimensions socio-économiques. Et enfin, les
outils actuels pour faciliter des évaluations intégrées des options d’adaptation et
d’atténuation sur les multiples secteurs dépendant de l’eau sont inappropriés. C’est
pour cela qu’une infrastructure d’observation satellitaire européenne est
indispensable.
Les différentes possibilités d’adaptation conçues pour assurer l’approvisionnement en
eau dans des conditions normales et de sécheresse exigent des stratégies adéquates
tant du côté de la demande que de celui de l’offre. Les premières améliorent
l’efficience de l’utilisation de l’eau en la recyclant, par exemple. Le recours à des
aides économiques sur une vaste échelle, y compris au niveau du réglage du compteur
et du prix pour encourager la conservation et le développement des marchés de l’eau
et la mise en place d’échanges virtuels d’eau peut promettre des économies d’eau et la
réallocation de l’eau à des utilisations jugées précieuses. Les stratégies côté offre
comportent généralement une augmentation de la capacité de stockage, le captage
dans des cours d’eau, la réalimentation des nappes souterraines et les transferts d’eau.
Une gestion intégrée des ressources en eau fournit un cadre important dans lequel
réaliser des mesures d’adaptation sur l’ensemble des systèmes socio-économiques,

environnementaux et administratifs. Pour être efficaces, ces approches intégrées
devront se faire à l’échelle appropriée.
b. L’agriculture et les forêts
La communauté agricole jouera un rôle déterminant dans l’adaptation, la plupart des
terres en Europe étant gérées par elle. Dans cet effort, la PAC est bien placée pour
devenir un élément décisif de la législation destinée à réaliser ce bien commun, tout
en aidant le monde rural à adapter sa production aux changements climatiques. On
peut d’ailleurs aussi aider des services écosystémiques plus vastes qui exigent un
mode spécifique de gestion des terres. La PAC représente aujourd’hui 40% des
dépenses de l’UE, primant les ressources et les pratiques agricoles à haute intensité de
carbone, et la distribution des aides est fort inéquitable. Puisque la fin de cette
politique est prévue pour 2013, un système plus efficace d’aides à l’agriculture
pourrait être mis en place qui stimulerait la croissance dans le secteur en déclin. Pour
ceci, on pourrait avoir recours à quatre types de mesures :
Des mesures ciblant des objectifs tels que la stabilité des marchés ou l’aide
aux revenus ayant des effets secondaires positifs sur l’environnement ou
contribuant au maintien d’effets positifs pour l’environnement.
Des mesures visant des objectifs tels que la subvention des revenus dans le but
de contribuer à l’imposition de conditions environnementales contraignantes et
du principe du pollueur payant (p.ex. paiements découplés combinés à la
conditionnalité environnementale).
Des mesures destinées à encourager la mise à disposition de services
environnementaux sur base volontaire (mesures agro-environnementales).
Des mesures visant à faciliter le respect des exigences environnementales
contraignantes (p.ex. mesure "pour le respect des normes" ou compenser les
désavantages économiques relatifs dus à un modèle régional d’exigences
environnementales (p.ex. Natura 2000 et directive cadre Eau).
Le secteur des forêts comporte d’autres défis, comme l’augmentation des risques
d’incendies de forêt. Ces évènements ont de graves conséquences écologiques et des
effets économiques et sociaux sérieux, et la probabilité qu’ils augmentent est réelle au
fur et à mesure que les températures et les moments de sécheresse augmentent. Il faut
aussi attribuer une grosse responsabilité à une mauvaise gestion et maintenance des
forêts, qui ont fait que de vastes surfaces boisées sont constituées par une seule espèce
d’arbres et qu’on a planté des variétés qui ne conviennent pas. En matière de
gouvernance, aucune politique de prévention adéquate n’existe, et dans l’optique
législative les sanctions pour avoir causé intentionnellement des départs de feu ne sont
pas assez sévères, et on n’applique pas assez bien les lois interdisant des constructions
illégales. A cause de la fréquence actuelle des feux de forêt (surtout dans le Sud de
l’Europe), les forêts n’ont pas le temps de se régénérer, provoquant de graves
conséquences et des risques de désertification. Une adaptation de la politique dans ce
domaine est fort à conseiller, puisque le réchauffement de la planète augmentera au
moins sur les 30 prochaines années et que ceci pourrait principalement affecter
certaines régions particulièrement vulnérables aux changements climatiques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%