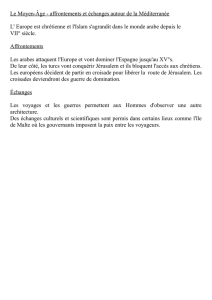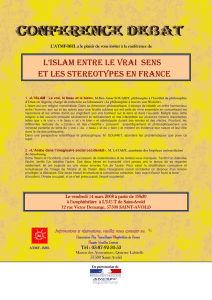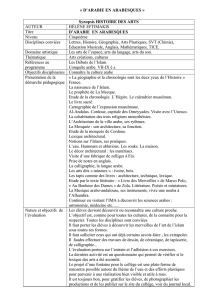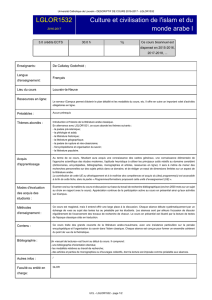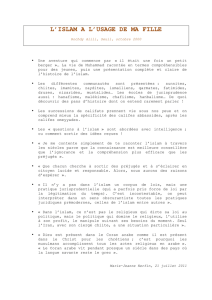Ghernaout Souad Année 1999/2000

pointer les préjugés ou idées reçues véhiculés sur la femme par le biais des
médias (émissions d’information, de fiction ; publicités ; magazines…) qui jouent un rôle
déterminant dans la socialisation en ce qu’ils peuvent être perçus comme les
chaînons d’une industrie de la conscience qui a le pouvoir de refuser ou de
conformer une image donnée.
Faire porter une charge trop lourde à. Accabler un âne de victuailles. •
Faire subir un grand nombre de choses difficiles, désagréables à. Accabler les étudiants de devoirs. Accabler la
foule d’insultes.
Entre compassion et ironie.
Paroles jalonnées par les blagues
L'utopie a du plomb dans l'aile, la relève somnole bercée par la pub, ... Mais sa lucidité l'a
doté d'un mélange de tendresse et d'ironie auquel on ne ...
« On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments », disait André Gide.
MAPPAS EMMANUELLE
Maîtrise de Français Langue Etrangère
Unité d’Enseignement IV a dirigée par M CHEVREL
SUJET DISCUTE :
L’IMAGE DE LA FEMME BLONDE DANS LA
SOCIETE FRANCAISE,
REGARD JALONNE PAR LES BLAGUES SUR LES
BLONDES
INTRODUCTION
Page 3.
PARTIE I : L’image de la femme telle qu’elle est véhiculée par les média propose
une lecture nomenclaturée ; la femme blonde voit ces traits lui être retourné de
plein fouet.
Page 4 à 7.

PARTIE II : Les blagues sur les blondes nous semblent être un bon appui pour
valider cette perspective ; mais elles fonctionnent elles aussi selon des codes
qu’il faut démêler.
Page 8 à 11.
PARTIE III : Nous avons établi un questionnaire pour vérifier si nos hypothèses
se trouvent cautionnées par la grande majorité des anonymes.
Page 12 à 19
PARTIE IV : Fiche didactique.
Page 20 à 25.
CONCLUSION
Page 26.
Il y a des moments, dans la vie, où l’on se pose plein de questions existentielles :
…
Si la belle de Cadix avait été blonde, ses yeux de velours eussent-ils été chanté ?
Dans Tristan et Iseut, Iseut ne serait-elle pas la première blonde débile ?
Au fait, est-ce que la Bible dit de quelle couleur étaient les cheveux d’Eve ?
Pourquoi diable Lio chante-t-elle « les brunes comptent pas pour des prunes » ?
Quelqu’un sait-il pourquoi les hommes se teignent les cheveux en blond(e) ?
Non parce que, comme la société actuelle fige les formes, les matières, les odeurs… et leur
donne sens,
alors on se demande selon quel angle elle juge le, ou plutôt, les, physiques.
C’est à dire : si sexe, taille, poids, teint, etc, sont ancrés dans les nomenclatures de beauté
et de laideur,
Alors qu’en est-il de la couleur des cheveux ?
Quel sens a-t-on donné au fait d’être blonde, brune, rousse, violette ( ! ), chauve ( ! ) ?
Zoom sur la blondeur féminine et sur les éventuels présupposés que cela implique :
« L’image de la femme blonde dans la société française,
regard jalonné par les blagues sur les blondes. »
Avant de nous immerger dans le monde des blondes, il convient de faire un
détour dans celui des femmes car comme disait Simone de Beauvoir « on ne naît
pas femme, on le devient » (Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949). De fait,
cette formule provocatrice illustre notre intention de montrer en quoi l’identité
féminine est une construction sociale ancrée dans les consciences. Puis,
dépassant cela, notre but sera de montrer comment « on ne naît pas blonde, on le
devient » !
Dans la société actuelle, les femmes, porteuses d’innovation, sont exposées à des
formes de ségrégation et tout se passe comme si les discriminations de sexe séculaires
Qui se produit tous les cent ans. Année séculaire.
[Soutenu] Centenaire, qui dure depuis cent ans. Orme séculaire. Maison séculaire. • Qui existe
depuis plusieurs siècles. Traditions séculaires. Forêt séculaire. Rivalité séculaire entre deux peuples.

Perturbations séculaires : [ASTRONOMIE] dont la période est calculée par siècles.
–
- Ne pas confondre avec séculier.
avaient revêtues des formes plus complexes, moins apparentes, mais néanmoins
toujours présentes et opérantes. Dès lors, le fil conducteur qui guidera notre propos se
résume dans une expression du langage courant, qui peut valoir de principe et de méthode
: pointer les préjugés ou idées reçues véhiculés sur la femme par le biais des
médias (émissions d’information, de fiction ; publicités ; magazines…) qui jouent un rôle
déterminant dans la socialisation en ce qu’ils peuvent être perçus comme les
chaînons d’une industrie de la conscience qui a le pouvoir de refuser ou de
conformer une image donnée.
Et le mot est lâché : celui d’ « image ».
Si l’on regarde tout d’abord les faits historiques, on se rend compte que malgré quelques
rapprochements constatés, les modèles de comportements masculins et féminins restent
encore fortement tranchés. Ainsi les discriminations de sexes dans la société désignent-
elles concrètement des différences de fonctions, de statuts, de droits et de devoirs.
Et les inégalités d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui et ne seront pas celles de demain,
car l’acteur social n’est pas un être androgyne ! Aussi l’émancipation féminine semble-t-elle
réglementée dans la limite autorisée de la reproduction des identités de sexes, c’est à dire
dans l’ordre de leurs inégalités.
Par conséquent, une spécificité féminine présumée semble s’exprimer dans nos
représentations quotidiennes.
Arrêtons-nous alors un moment sur l’image sociale de la femme telle qu’elle est
présentée ou représentée dans les médias. Il semble que journaux télévisés,
feuilletons, publicités (…) ne soient pas neutres et qu’ils constituent de ce point de vue un
miroir révélateur de nos mentalités et de nos stéréotypes de sexes.
les médias se font informatifs ou persuasifs par le biais d’une récupération lucide de
phénomènes soigneusement étudiés et établis car ils doivent se vendre et vendre.
Et l’image se veut efficace, sans détours :dans le milieu publicitaire on établi un scénario en
vu de produire des effets hiérarchisés (attirer l’Attention, susciter l’Intérêt, provoquer le
Désir, déclencher l’Achat ou l’Action) ; c’est la méthode AIDA où l’illustration ne se borne
pas seulement à « représenter » mais aussi à signifier par le biais d’un réseau de symboles
conscients ou inconscients.
Mais comme le problème n’est pas ici de connaître le fonctionnement de l’identification ou
le système de symbolisation mais bien plutôt de déceler leur existence et ainsi d’essayer de
mettre en lumière le type de femme auquel le consommateur est renvoyé, le type
d’existence auquel les médias les assignent ; alors, nous dirons qu’il est proposé du
symbole « interprétatif » qu’est devenue la femme, deux types d’images
distinctes auxquelles sont noyautées une série de mythes propres à certaines
valeurs fondamentales du groupe et propres à ériger une définition immuable de
la nature féminine.

L’une de ces images est celle du personnage traditionnel de la mère de famille. En
publicité, elle vente les mérites des produits d’entretien, des aliments, des appareils
ménagers… Il est cependant vrai que les publicitaires s’évertuent depuis peu à euphémiser
les relations domestiques, en mettant en scène des maris modèles, les mains dans la
vaisselle, ou inquiets de la qualité des couches culottes.
Et quand la femme est représentée en situation professionnelle, elle est soit en relation de
subordination hiérarchique, soit un simple prétexte esthétique. Alibi qui atteint son
paroxysme dans l’irréel de situations où une jeune femme « sexy » préside un conseil
d’administration du haut de ses vingt ans.
Tout concourt, de façon manifeste ou subreptice, à présenter, dans le message verbal
publicitaire ou fictionnel, ou dans le non-dit qui l’accompagne, la femme comme le
personnage incarnant « naturellement » les qualités de beauté, séduction, charme,
élégance… C’est l’image de la femme érotisée : mieux que quiconque, elle est attendue
exprimer ces vertus en toutes occasions.
Et l’éventuelle nudité de son corps à une fonction symbolique précise. Elle est le gage de sa
féminité, de sa finesse, de sa douceur : elle fait coïncider l’image de la femme à celle de la
nature et de la pureté et constitue à ce titre un argument efficace de vente ou
d’attachement affectif ou esthétique. Dans d’autres cas, la nudité féminine est
sexuellement exploitée (dans les fictions, par exemple) : l’érotisme poussé propose une
nudité faite pour attacher le regard.
Ainsi, en règle générale, l’image médiatisée de la femme corrobore les principaux
rôles observés dans cette forme de réalité que l’on semble lui destiner en propre.
Plus encore, elle les accentue, comme pour renforcer le préjugé devenu vérité qu’il existe
des univers bien spécifiques aux hommes et aux femmes, et qu’en conséquence chacun
doit rester à sa place, pour le bien de tous.
« Le social se superpose au naturel », mieux il s’y confond en l’intériorisant ! Les
différences sociales les plus voyantes entre les sexes puisent en partie leur fondement dans
les caractéristiques biologiques de chacun d’eux. La fécondité des femmes, leur moindre
force physique…, constituent autant d’ « alibis de la nature » pour légitimer les
représentations et les attitudes qui leur sont généralement assignées. Les images et les
fonctions sociales dévolues aux femmes s’enracinent si profondément dans leurs propriétés
innées ou supposées telles, qu’elles s’imposent au bout du compte dans les esprits comme
allant de soi, avec l’évidence du naturel. La division sociale entre les hommes et les
femmes est d’autant plus efficace que la définition sociale des sexes s’appuie sur l’héritage
d’une éducation, voire d’une inculcation dès la naissance de leur assignation respective à
des places différentes dans la société.
C’est cette socialisation, c’est à dire cette façon qu’on les individus d’intérioriser dans leurs
conduites et leurs opinions les modèles d’attribution des rôles masculins et féminins, qui
rend en somme le social plus vrai que nature, l’identité sociale des hommes et des femmes
plus prégnante que leur identité biologique.
En apportant au regard cette situation contrastée de la femme, nous avons voulu
mettre en évidence l’efficience culturelle des médias qui se font mode spécifique de
communication et non d’expression, véhiculant les lieux conventionnels de la reproduction
des différences de sexes.
« Et les blondes dans tout ça ? », me direz-vous…eh bien je vous
répondrai que les mythes, les fantasmes, les images, les stéréotypes… qui les

accompagnent se dégagent tous de cette même source que nous venons de
pointer selon laquelle la femme est corporéité avant que d’être spiritualité. Et de
cela découle tout un implicite autour du mode d’existence : voir, être, ressentir,
comprendre les faits sont axés autour d’une extériorité, d’une apparence symbolisant «
un désir rendu visible ».
Et le corps se fait parure lorsqu’on l’associe à des figures légendaires comme celles de
Marylin Monroe, de Brigitte Bardot…comme le disait Simone de Beauvoir dans son livre
intitulé Le deuxième sexe : l’art de la parure « offre au regard un objet imaginaire », la
femme blonde devient un objet de culte. A sa beauté est associé non seulement le
bonheur, mais également la réussite sociale, la performance. La belle femme blonde est
métamorphosée en idole : autour d’elle se crée un forme d’identité visuelle. Alors la
blondeur organise-t-elle l’ensemble de la silhouette féminine qui se donne à saisir comme
un tout de signification voluptueuses et exaltées.
Dans ce cas de figure, la chevelure induit une dimension figurative.
Cependant, lorsque le Sujet (la femme) s’inscrira dans une quête (la liberté moderne) et
brisera la simple corporalité qui lui est assignée, la dimension figurative se transformera en
sémiotique figurative : l’image de la femme blonde est en crise ou disons, pour
atténuer les choses car le point de vu de chacun est à respecter, qu’elle est démythifiée.
Ainsi adieu à la « représentation fermée » selon Wölfin (Réflexion sur l’histoire de l’art,
Paris, Klincksieck, 1989, page 139) : « une représentation sera dite fermée lorsque, avec
des moyens plus ou moins tectoniques, l’image y apparaîtra limitée en elle-même, réduite
à une signification complète ».
Mais bonjour à quoi ?…à la « représentation ouverte » ! « Inversement, il y aura une forme
ouverte quand l’œuvre s’extravasera pour ainsi dire en tous sens, impatiente de toute
limitation, quoiqu’une unité intime subsiste en elle et assure son caractère fermé
esthétiquement parlant ». ainsi selon Wölfin, le mythe échappe à l’image.
Alors, dans ce nouveau cadrage, la vogue des blagues sur les blondes nous semble un
angle d’observation et d’analyse relativement pertinent.
Tout d’abord parce qu’il prend le contre-pied du mythe initial valorisant de sensualité
pour le ballotter dans les remous de la facilité, de la passivité sexuelle. Prenons quelques
unes de ces blagues :
¨Que dit la jambe gauche d’une blonde à la jambe droite ?
Rien ! Elles ne se rencontrent jamais.
¨Quand sait-on qu’une blonde a atteint l’orgasme ?
Parce qu’elle a laissé tomber sa lime à ongles.
Parce qu’elle dit « au suivant ».
Parce que la personne qui vous suit vous tape sur l’épaule.
Parce que la voiture n’a plus de batterie.
As-t-on besoin de le savoir ?
¨Quelle est la différence entre une prostituée, une nymphomane et une
blonde ?
Au bout d’une heure, la prostituée dit : « T’as pas encore fini ! ».
la nympho dit : « T’as déjà fini ! ».
la blonde dit : « Beige…je crois qu’on va repeindre le plafond en beige ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%