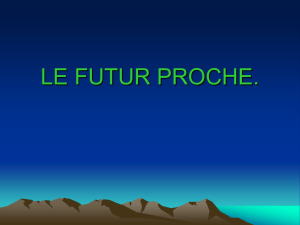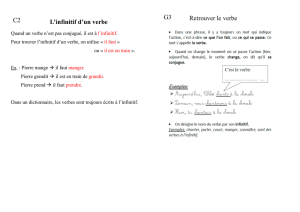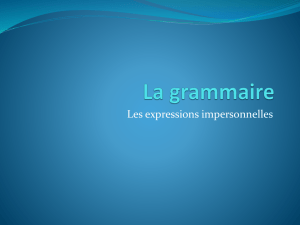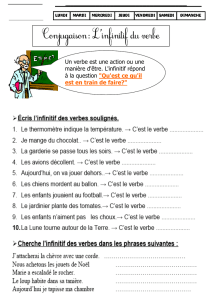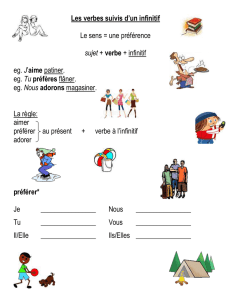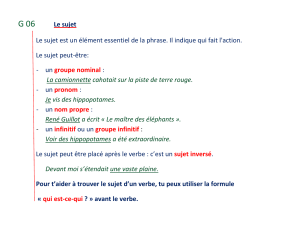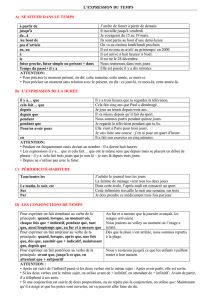L1 : grammaire et linguistique

L1 : grammaire et linguistique
2ème semestre
D. Luzzati
Manuels :
M. Riegel & al, Grammaire méthodique du français (GMF), PUF.
H. Bonnard, Code du français courant (CFC), Magnard.
Livre d’exercices :
H. Bonnard & R. Arveiller : Exercices de langue française (ELF), Magnard.
Les chiffres renvoient aux paragraphes, dans le CFC comme dans les ELF
ils renvoient aux pages dans le GMF
cours
thème
GMF
ELF
1
Introduction
2
Les relatives
479-490
883-913
3
Les queP
491-498
914-931
4
Les interrogatives
499-501
932-957
5
Les circonstancielles
503-517
958-1010
6
Exercice sur table
7
La conjugaison
242-252
556-573
8
Le temps & l’aspect
287-296
574-580
9
Valeur des temps de l’indicatif
297-319
581-615
10
Valeurs des autres modes
320-345
616-650
11
Voix et « tournures »
254286
651-672
12
Exercice sur table

vocabulaire classé
Introduction
- phrase/énoncé
- ellipse
- phrase sans verbe
- proposition
- proposition infinitive/ paticipiale
- adjectif verbal
- proposition principale/subordonnée
- proposition dépendante / non dépendante
- proposition régissante
- syntaxe/parataxe / hypotaxe
- asyndète
- corrélation
- relative/complétive/queP
- conjonctive/circonstancielle/int indirecte
- conjonctive apposée
- interrogation indirecte
- adv relatif/relative nominale
Les relatives
- relatif synthétiques/analytiques
- relative explicative/restrictive
- relative par décumul
- relative de liaison
- relative prédicatives
- relative attributives/distributive
- adjectif relatif
- adverbe relatif
- double relative
Les conjonctives par que
- complétive
- conjonctive sujet/attribut/apposée
- verbes thétiques
Les interrogatives
- interrogation directe/indirecte
- interrogation totale/partielle
- versation
- discours direct /indirect (indirect libre)
- interrogation simple/renforcée
- proposition percontative
- interrogation oratoire (rhétorique)
- modalité
Les circonstancielles
- subordonnées temporelles :
antériorité/simultanéïté/postériorité
- subordonnées logiques :
cause/conséquence/but/concession
- concession/opposition / adversation
- subordination inverse
- système comparatif (infériorité / égalité /
supériorité)
- système hypothétique
- potentiel / irréel du présent / irréel du passé
- protase / apodose
- relative indéfinie
La conjugaison
- verbes défectifs
- radical / base
- désinence / flexion
- temps/ tiroirs verbaux
- personne
- mode
- voix
- aspect
- auxiliaires / semi-auxiliaires
- semi-auxiliaires aspectuels
- semi-auxiliaires modaux
- modes personnels / non personnels
- paradigme
Le temps & l’aspect
- universaux
- temps chronologique / temps aspectuel
- temps de l’énonciation /temps de l’énoncé
- temps absolu / temps relatif
- perfectif/imperfectif
- accompli/inaccompli
- limitatif/duratif
- semelfactif/itératif
- progressif/linéaire
- inchoatif/terminatif
Valeur des temps de l’indicatif
- prétérit
- présent ponctuel :sens continu / sens
performatif / sens constatif
- présent itératif
- présent étendu
- présent décalé
- présent permanent / présent proverbial
- présent historique / présent de narration
- aoriste
- imparfait descriptif / narratif / de rupture /
itératif / hypocoristique
- futur injonctif / d’anticipation / hypothétique
- futur périphrastique
- conditionnel temporel
- conditionnel modal
Valeurs des autres modes
- infinitif verbal / nominal
- sujet /agent
- infinitif de narration
- infinitif délibératif
- infinitif en locution verbale
- proposition infinitive
- infinitif de coréférence
- infinitif verbal
- infinitif nominal
- infinitif de consigne
- infinitif exclamatif
Voix et « tournures »
- agent / complément d’agent
- verbes symétriques
- passif opératif
- passif résultatif
- le pronom réfléchi
- pronominaux de sens réfléchi
- pronominaux de sens réciproque
- pronominaux de sens passif
- essentiellement pronominaux
- pronominaux successifs

Semestre 2 exercice 2
1. Donner un exemple de :
1. proposition infinitive
J’entends les oiseaux chanter
2. adverbe relatif
Je vais où je veux
3. conjonctive sujet
Que tu viennes me fait plaisir
4. Discours indirect libre
Il était affirmatif. Il viendrait le lendemeain…
5. Subordonnée d’opposition
Alors qu’il pleut, je sors
6. auxiliaire aspectuel
Je vais/commence/termine de/à manger
2. Compléter :
J’eusse été riche
Verbe être, subjonctif plus-que-parfait, personne 1
Il avait été vu
Verbe voir, indicatif plus-que-parfait passif, personne 3
J'interpelle
Verbe interpeller, présent de l'indicatif actif, personne 3
Qu'il soit né
Verbe naître, subjonctif passé, personne 3
Elle serait aperçue
Verbe apercevoir, conditionnel présent passif, personne 3
Il résout
Verbe résoudre, indicatif présent actif, personne 3
Nous criions
Verbe crier, indicatif imparfait, personne 4
Que tu fisses
Verbe faire, subjonctif imparfait actif, personne 2
Qu'il vînt
Verbe venir, subjonctif imparfait actif, personne 3
Vous paraîtriez
Verbe paraître, conditionnel présent actif, personne 5
J’avais eu un juste pressentiment quand, deux jours après le départ d’Albertine, j’avais été épouvanté
d’avoir pu vivre quarante-huit heures sans elle. C’était comme quand j’écrivais1 auparavant à Gilberte
et que je me disais2 : si cela continue3 deux ans ,je ne l’aimerai plus. Et si, quand Swann m’avait
demandé4 de revoir Gilberte, cela m’avait paru5 l’incommodité d’accueillir une morte, pour Albertine la
mort – ou ce que j’avais cru la mort – avait fait la même œuvre que pour Gilberte la rupture prolongée.
La mort n’agit que comme l’absence. Le monstre à l’apparition duquel mon amour avait frissonné,
l’oubli, avait bien, comme je l’avais cru6, fini par le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu’elle était7
vivante ne réveilla pas mon amour, non seulement elle me permit de constater combien était déjà
avancé8 mon retour vers l’indifférence, mais elle lui fit instantanément subir une accélération si
brusque que je me demandai9 rétrospectivement si jadis la nouvelle contraire, celle de la mort
d’Albertine, n’avait pas inversement, en parachevant l’œuvre de son départ, exalté10 mon amour et
retardé son déclin.
3. Relever et analyser les propositions dépendantes régies par les verbes soulignés :
1. (comme) quand j’écrivais1 aup à G
Temporelle hypothétique
2. que je me disais2
Idem, que reprenant quand, précédé de comme
3. si cela continue3 deux ans
Hypothétique (protase à valeur potentielle)
4. quand S m’avait demandé4 de revoir G
Temporelle
5. si_cela m’avait paru5 … morte
Hypothétique (protase à valeur d’irréel du passé)
6. comme je l’avais cru6
Comparative (qui énonce un jugement de conformité)
7. qu’elle était7 vivante
Conjonctive apposée à cette nouvelle
8. combien était déjà avancé8 … l’indiff
(Interrogation indirecte partielle) complétive de constater
9. si_que je me demandai9 rétrospectivt
Consécutive liée à l’utilisation de l’intensif si
10. si jadis … son déclin
Interrogation indirecte totale complétive de demander
4. Quel intérêt peut-il y avoir à parler de « tiroirs verbaux » plutôt que de « temps » ?
- De façon négative, cela permet d’éviter le terme ambigu de « temps » qui peut signifier
Le temps qu’il fait (weather), le temps qui passe (time) ou les temps verbaux (tense).
En matière de temps verbaux, il peut s’agir, d’une part, du temps chronologique
(présent/passé/futur), et d’autre part du temps aspectuel (oppositions formes
simples/composées, passé simple/imparfait…).
- De façon positive, cela renvoie métaphoriquement à un meuble, une « commode » par exemple,
où la méthode de rangement des objets ne se confond pas avec leur mode d’emploi. Ainsi les
« tiroirs verbaux » sont un moyen de classer les formes verbales, sans que cela préjuge de leurs
conditions d’utilisation.
1
/
3
100%