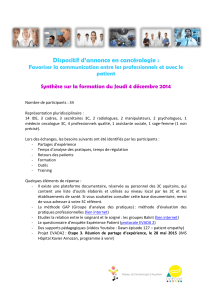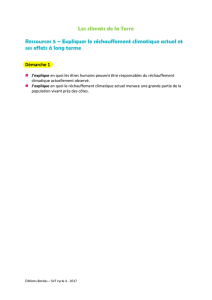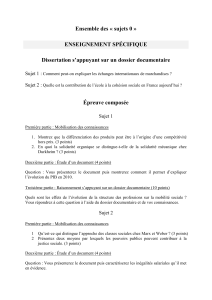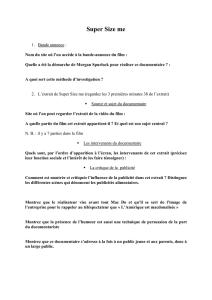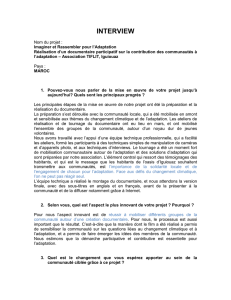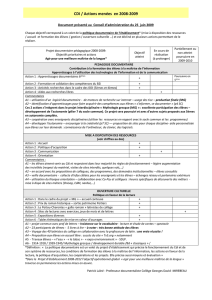ECJS - le site de l`Agenda 21 scolaire du lycée Arthur Varoquaux

1
Analyse critique d’un documentaire alarmiste sur le réchauffement
climatique : « Une Vérité qui dérange », de Davis Guggenheim (2006).
[Mis à jour en octobre 2007]
Public ciblé : tous les niveaux, notamment seconde, dans le cadre des cours
d’Education Civique, Juridique et Sociale et / ou des cours de Géographie.
Durée du projet : 1 projection + 4 séquences de 2 heures pour l’élève.
Matières, thèmes et notions des programmes concernés :
Seconde – ECJS
Thème 1 – Citoyenneté et civilité (vie de quartier et participation locale)
Thème 2 – Citoyenneté et intégration (intégration du citoyen – élève dans la
communauté)
Notions : civilité, intégration, droits (à tous les niveaux : politiques, sociaux,
économiques, etc.)
Démarche : cf. la « fiche ressource n°4 » intitulée « Utiliser l’actualité – Les
citoyens face aux risques naturels », pages 22 et 23 de l’accompagnement
des programmes d’ECJS (CNDP, Octobre 2000).
Seconde – Géographie
Thème 4 – Les sociétés face aux risques
Notions : société, risque majeur, aléas, catastrophes, vulnérabilité.
Démarche : le film documentaire constitue le sujet d’une étude de cas sur le
réchauffement climatique, un risque majeur à l’échelle de toute la planète.
Objectif : Amener les élèves à réfléchir sur un débat ancien, remis sur le devant de la
scène à l’occasion de la projection d’un documentaire alarmiste devant les députés de
l’Assemblée Nationale (et du public français), à un moment ou les médias et le monde
politiques sont de plus en plus polarisés par l’échéance présidentielle de 2007. Ce
travail peut être mis en parallèle avec le thème de Géographie de la classe de Seconde
sur « les sociétés face aux risques ».
Problématique : Le documentaire de Davis Guggenheim est alarmiste parce qu’il
met surtout en évidence les conséquences probables du réchauffement climatique (un
risque majeur) dans le but de réveiller les consciences.
Alors que la médiatisation (à commencer par les bandes-annonces du
documentaire, les affiches et tout le matériel promotionnel de celui-ci) amplifie la
tendance à s’appesantir sur les phénomènes naturels spectaculaires (= aléas) qui
résultent du réchauffement climatiques, sources de catastrophes lorsqu’ils touchent
une ou plusieurs sociétés, une analyse plus rigoureuse du message du documentaire
ainsi que de la démarche de son acteur principal doivent permettre de recentrer le
débat sur la variable de « l’équation du risque » qui est négligée : la
vulnérabilité.
Aléa + Vulnérabilité = Risque
La vulnérabilité des sociétés, qui sont à la fois victimes et responsables de
ces phénomènes, doit être au centre de la réflexion des élèves. Le bilan final de cette
réflexion vise à initier – si cela s’avère pertinent – une réflexion sur ce qui
permettrait de réduire cette vulnérabilité, notamment à l’échelle du
lycée.

2
Démarche : La démarche de cette action peut se décomposer en quatre temps.
1. Un travail d’analyse critique du documentaire relativement classique ;
2. Une réflexion sur la réception du film en France à travers un
corpus d’articles tirés de la presse écrite et / ou de reportages,
notamment à l’occasion de sa diffusion à plusieurs dizaines de députés de
l’Assemblée Nationale le mercredi 11 octobre 2006, qui permettrait de mettre
en perspective le message du film – essentiellement adressé aux américains,
mais généralisé au reste du monde par la suite – avec la situation française.
L’évolution des préoccupations nationales (Grenelle de
l’environnement entre juillet et novembre 2007) et internationales (Al Gore
et le GIEC – Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
– recevant le prix Nobel le 12 octobre 2007) relatives au réchauffement
climatique méritent une attention particulière (le GIEC rend son 4e
rapport de synthèse lors de la conférence de Bali en Indonésie du 3 au 14
décembre prochain, qui vise notamment à préparer l’après-Kyoto, qui s’achève
en 2012) ;
3. Une réflexion sur les prolongements proposés par le film à travers les
propositions concrètes faites à l’occasion du générique de fin du documentaire,
les affichettes promotionnelles distribuées dans les cinémas les reprenant,
ainsi que le site web du documentaire (qui met à disposition du public des
informations scientifiques, des propositions concrètes, des liens vers d’autres
sites institutionnels, etc.), centré sur la même thématique : comment
transformer les réflexions du documentaire en faits à l’échelle du lycée (ce qui
serait notamment l’occasion d’un débat argumenté) ?;
4. Enfin, en se basant sur les idées les plus fortes ayant émergé à
l’occasion du débat argumenté, les élèves seraient invités dans une
nouvelle séquence – si cela se révèle pertinent – à s’emparer d’un problème
précis à l’échelle du lycée : le problème de l’eau, du recyclage du papier, de la
gestion des déchets, etc. L’étude du documentaire étant une activité EDD (=
Education au Développement Durable) deviendrait alors une
introduction à une action E3D (= Etablissement en Démarche de
Développement Durable).

3
Associer plusieurs classes autour du projet (exemple en seconde) :
Remarques préliminaires : Ce projet part du constat que les élèves sont
déjà sensibilisés avec les problèmes du réchauffement climatique et de
l’environnement ainsi que du développement durable par le biais de
nombreuses séquences allant dans ce sens, dans la majeure partie des
disciplines, depuis l’école primaire jusqu’au lycée. Les nombreuses
sollicitations sur ces sujets qu’ils reçoivent de la part d’acteurs institutionnels
ou associatifs (publicités, intervenants extérieurs dans les établissements
scolaires ou périscolaire, etc.) complètent ce dispositif. Mais il existe une
dichotomie entre l’importance et la fréquence du message et la portée de celui-
ci, puisque pour le moment, l’essentiel de l’action proposée pour protéger
l’environnement repose sur l’action individuelle. C’est d’ailleurs l’un des
messages clés du film de Davis Guggenheim et d’Al Gore. L’objectif est donc de
dépasser le stade de la simple sensibilisation (= EDD) afin d’initier une
démarche concrète au sein de l’établissement (= E3D).
Une démarche associant plusieurs classes : Il est tout à fait
envisageable d’associer deux ou plusieurs classes à ce projet :
Visionnage collectif du film documentaire (attention : ne
pas négliger l’impératif financier + penser à la réduction de
l’impact écologique du transport… qui devrait être collectif !) ;
Travaux d’analyse critique et de réflexion sur les
prolongements du film par classes (fiche d’analyse en annexe) ;
Débat argumenté (par demi-classes) pour reformuler et
affiner les idées des élèves permettant de transformer le discours
à vocation globale du film documentaire en action concrète à
l’échelle locale, celle du lycée (fiches complémentaires en
annexe) ;
Débat argumenté ou forum réunissant tous les
participants (modalités à préciser), avec un sérieux qu’il est
possible d’induire par le fait que le résultat de ce débat serait
évalué (sujet d’évaluation en annexe) ;
Bilan final par classes, avec une synthèse de toutes les idées
fortes retenues et échangées à l’occasion du débat argumenté
avec les autres classes (possibilité alternative d’évaluation) ;
Partage entre ces classes des différentes actions à mener dans
une nouvelle séquence centrée sur un problème à l’échelle du
lycée (l’eau, les déchets, les énergies renouvelables, etc.)

4
« Une Vérité qui dérange », de Davis Guggenheim, 2006
Etude et prolongement sur un film documentaire concernant le
réchauffement climatique (exemple en classe de seconde)
Séquences
1. – Visionnage du
film documentaire
et fiche d’analyse
distribuée aux
élèves
Travail personnel
demandé aux
élèves : compléter
la fiche d’analyse
entre le visionnage
et la première
séquence d’ECJS
en groupe au lycée
Fiche pour les
élèves avec les
consignes
détaillées
en
annexe à ce fichier
Fiche à compléter donnée aux élèves :
1. – Présentation du documentaire :
- auteur, titre, date, langue, lieu de production ;
- le thème principal : quel est le sujet central de ce documentaire ?
2. – L’acteur principal :
- qui est-ce ?
- comment se met-t-il en scène durant tout le déroulement du film et
pourquoi ?
- comment justifie-t-il son action (pourquoi ce documentaire) ?
3. – Narration :
3.1. – montage du documentaire : comment est-il construit ?
- quelles sont les scènes importantes du documentaire et comment sont-elles
mis en évidence ?
- la conclusion : comment s’achève le film ? Que dire des dernières images ?
Que penser du générique ?
3.2. – La façon de filmer : comment le documentaire est-il mis en scène ?
- le réalisateur utilise-t-il des images symboliques se répétant ? Lesquelles ?
Quand ? Pourquoi ?
4. – Le message :
Le ou les messages du documentaire peuvent être regroupés entre différents
thèmes et prendre différentes formes. Complétez le tableau ci-dessous en
reprenant les arguments essentiels que vous avez retenus :
Forme de
l’argumentation :
Forme raisonnée
(preuves
scientifiques)
Forme
émotionnelle
(sous forme
d’opinions)
Contenu de
l’argumentation :
Scientifique
Politique
Economique
Philosophique et moral
5. – Votre avis sur le film documentaire :
- quels sont selon vous les points forts du film ?
- quels sont selon vous les points faibles du film ?
6. – La réception du film en France (travail de recherche
complémentaire)
- cherchez dans la documentation disponible au CDI, chez vous ou sur
Internet un article de la presse nationale ou régionale relatant les réactions
des parlementaires français invités à assister à une projection
spéciale du film documentaire en présence d’Al Gore, son acteur
principal, le mercredi 11 octobre 2006. Attention à effectuer une
recherche correspondant scrupuleusement au thème énoncé ;
- dans cet article, relevez (et notez sous une forme résumée) les diverses
réactions des députés sur le film, notamment les points forts ou les points
faibles qu’ils ont pu relever à l’issue de la séance, leurs avis et critiques ;
Consignes : à l’issue de la prochaine séance, vous devez être capable :
- de présenter cette fiche scrupuleusement complétée, ce qui est un travail
personnel (ne recopiez pas sur un camarade pour les raisons qui suivent) ;
- d’argumenter sur le film, c’est-à-dire de donner votre opinion et de
l’expliquer en vous appuyant sur des exemples précis ;
- de parler et expliquer les diverses réactions des parlementaires français
ayant assistés à la séance qui leur était spécialement dédiée ;
- de participer à l’oral sans votre feuille, ce qui signifie qu’il faut bien
maîtriser votre sujet !

5
2. – Analyse du
film documentaire
(centrée sur le
message) et
réflexion sur la
réception de celui-
ci en France
Quelques exemples
d’articles que les
élèves peuvent
trouver durant
leur recherche
préparatoire
en
annexe à ce fichier
Documents
supplémentaires
utilisé à la fin de
cette séance
en
annexe à ce fichier
A. – Reprise en groupe de l’analyse du documentaire et
notamment du message (à partir de la fiche complétée par les
élèves entre le visionnage et cette séquence) = reprise des quatre
premiers points de la fiche.
B. – Avis personnel des élèves (question 5 de la fiche) et
prolongement visant à recentrer le débat à l’échelle européenne et
nationale (question 6) :
- Le questionnement suivant vise à permettre aux élèves de réinvestir leurs
recherches et de les guider pour changer l’échelle étudiée :
* A qui s’adresse initialement Al Gore et pourquoi ? [Au départ, ces
conférences sont destinées aux américains, non-signataires du protocole de
Kyoto, dans lequel Al Gore s’est impliqué en tant que vice-président avant de
se voir opposé un refus par le Congrès américain lorsqu’il fallut signer le
protocole. Le film montre le parcours des conférences : toutes les Etats-Unis
puis le reste du monde. La France est visitée seulement à l’occasion de la
sortie du film… Autre information démontrant que la cible initiale est
américaine : le site officiel du film (en V.O.) www.climatecrisis.com propose
des activités en ligne visant uniquement le public des Etats-Unis. Le site (en
V.F.) www.criseclimatique.fr, propose des données et activités en français,
mais la base de réflexion reste la situation américaine].
[A noter qu’Al Gore a bénéficié d’informations inédites fournies
par le GIEC lors de la réalisation de son documentaire, qui se
retrouvent dans les divers rapports publiés par cet organisme
durant l’année 2007. Pour le GIEC, c’était une façon
complémentaire à la publication de ses études destinées aux
décideurs de sensibiliser la population mondiale à la question du
réchauffement climatique].
* Comment est reçu le film en France, notamment par les députés
ayant assisté à la projection organisée en présence d’Al Gore ?
[Excellente réception sur la démarche, la forme, le fond étant critiqué sur un
point : le manque de solutions proposées.]
* Comment expliquer cette réception dans un pays comme la
France, qui se présente comme à la pointe des questions
d’environnement ? [Les députés ayant assisté à la projection ont souligné
l’importance de la démarche pédagogique de la démonstration du
documentaire. Ils ont insisté dans leurs commentaires sur l’importance du
message. Aucun n’a souligné ce qui semble être un paradoxe : l’ex vice-
président du pays le plus pollueur au monde vient faire une leçon de morale à
l’un des Etats signataire du protocole de Kyoto… Mais la question suivante
permet de démontrer aux élèves que ce n’est pas forcément paradoxal.]
* Quel message contenu dans le film a été relayé par les députés
français dans leurs déclarations à l’issue de la projection ? [Le
devoir de lutter contre le réchauffement climatique est un impératif moral qui
doit dépasser les clivages politiques. Sur un plan plus philosophique,
personne ne peut rester sans réagir devant la catastrophe qui se dessine,
puisque tous les terriens en seront à la fois les acteurs et les victimes. C’est
dans cette logique que Gore s’inscrit, ce qui explique qu’il n’y a pas ici de
paradoxe à ce qu’un américain fasse la morale au reste du monde.]
La question suivante nécessite d’apporter un document
complémentaire (en annexe) pour mettre en perspective l’action
politique de l’Union Européenne et/ou de la France :
* D’après les députés français, le documentaire est un modèle de
sensibilisation. Est-ce à dire que, comme les politiques
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%