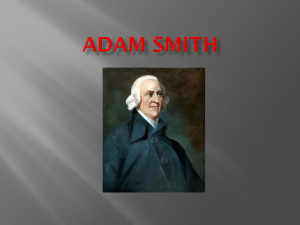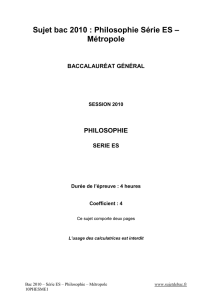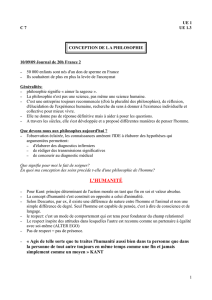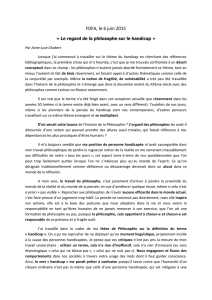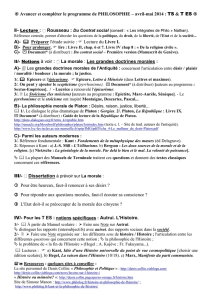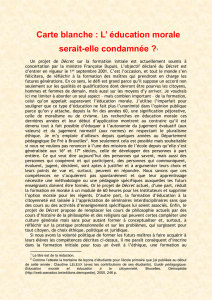en format Word

1/8
SUR LES CONFINS DE LA VIE
L'apothéose du déracinement
Par Léon Chestov
PRÉFACE
- I -
Il faut se justifier ! Il ne peut y avoir de doutes à cet égard. La seule question est de savoir par
quoi commencer : par la justification de la forme ou du contenu de cet ouvrage ? En Europe
occidentale, la forme aphoristique est d'un emploi assez courant; chez nous il en est tout
autrement. Chez nous, l'on croit qu'un livre doit contenir un ensemble de pensées se développant
logiquement et régies par une idée générale, car autrement, un livre n'a pas de raison d'être ... Si
c'est vraiment ainsi, les aphorismes doivent être condamnés. Des pensées dispersées, non réduites
en système, pourraient être tout au plus considérées comme une sorte de matière brute, qu'il faut
encore soumettre à un certain travail de façonnement et d'unification pour lui donner quelque
valeur. Mais à mesure que grandit notre méfiance à l'égard des développements logiques et que
nous nous mettons à douter de l'efficacité des idées générales de tout genre, ne devons-nous pas
ressentir une certaine répulsion pour cette forme littéraire, qui répond précisément aux préjugés
en cours? J'en parle d'après ma propre expérience.
Je ne songeais nullement à donner à cet ouvrage la forme que finalement il a prise. L'habitude
d'exposer mes pensées d'une façon systématique et bien coordonnée, s'est profondément ancrée
en moi comme en tout le monde; j'ai donc commencé à écrire, j'ai même mené mon travail assez
avant, en suivant un plan à peu près identique à celui de mes livres précédents. Mais à mesure
que
l'ouvrage avançait, il me devenait de plus en plus pénible, de plus en plus
insupportable d'y travailler. Pendant quelque temps, je ne parvenais pas à me rendre
compte de la raison de ce sentiment. Les matériaux sont rassemblés ; il ne reste plus
qu'à les disposer en ordre et à leur donner une certaine forme. Mais ce que je ne
considérais que comme un travail de façonnement tout extérieur, se trouva être en
réalité une chose essentielle et bien plus importante que je ne me l'imaginais. Je
constatai avec étonnement et perplexité qu'en fin de compte on sacrifiait à l' « idée »
et au développement logique, ce qui justement avait le plus de valeur, c'est-à-dire la
pensée libre. Une circonstance, à première vue insignifiante, - par exemple la place
qui lui avait été assignée dans l'exposé, le voisinage de telle expression, - suffisait
parfois pour prêter à la pensée une nuance de netteté et de certitude,
à
laquelle je
n'avais aucun droit et que je ne recherchais pas d'ailleurs. Et tous ces « car », ces «
ainsi donc », par lesquels on conclut, et même les simples « et » et autres
conjonctions innocentes, au moyen desquelles des jugement disparates, provenant de
sources différentes, sont fondus en un système achevé de raisonnements, - quels
tyrans impitoyables, mon Dieu! Je vis qu'en ce qui me concernait personnellement,
en tout cas, il m'était impossible d'écrire ainsi. Mes propres souvenirs à moi, en tant
que lecteur, me disaient clairement que ce qu'il y a de plus pénible dans un livre, c'est
l'idée générale. Il faut s'efforcer de l'extirper par tous les moyens si l'on ne veut pas
devenir son esclave ; or, tant qu'on s'en tient
à
la forme traditionnelle, non seulement
l'idée continuera à dominer, mais elle écrasera sous son poids tout le contenu
du
livre.
Mais de quel autre moyen disposons-nous pour atteindre la cohésion et à l'unité?
Je finis par me convaincre que je n'avais pas le choix, qu'il fallait démolir l'édifice
à moitié déjà construit et présenter mon travail sous l'aspect d'une série de pensées
privées de tout lien extérieur, au risque de provoquer la colère des lecteurs et surtout
des critiques, qui ne voudront voir dans cette infraction
à
la forme consacrée qu'un
caprice absurde.
Absence d'idées, ainsi que de suite logique; les contradictions fourmillent ; mais
c'est précisément ce que je voulais, ainsi que le lecteur l'aura deviné d'après le titre
du livre. Le déracinement, l'apothéose même du déracinement
1
!
Pouvait-il s'agir
1
Le terme russe employé par l'auteur, - « bezpotchviennost» (en allemand :
«
Bodenlosigkeit») n'a pas d'équivalent en
français; il désigne l'absence de
sol,
de soutien, l'état de ce qui est sans fondement, sans base. Nous avons traduit ce
terme
, aussi bien dans le titre que dans le corps même de l'ouvrage, par celui de
«
déracinement ».
(N.
du T.)

2/8
d'une forme achevée et systématique, lorsque mon objet était justement de me
débarrasser une fois pour toutes des fins et des commencements de tout genre, que
nous imposent avec une obstination incompréhensible les inventeurs de systèmes
philosophiques, grands et petits ? Les législateurs modernes de la pensée établissent
un principe immuable : il faut savoir achever. Mais essayez de les questionner :
qu'est-ce qui donc leur donne le droit d'établir ce principe avec une telle assurance ?
Vous verrez qu'ils ne disposent que de preuves par analogie. Une maison ne peut
rester sans toiture, ergo les raisonnements doivent avoir un commencement et
aboutir
à
une conclusion. Mais une maison ne peut non plus rester sans poêle. Qu'en
faudrait-il donc conclure ? D'ailleurs, les preuves par analogie sont en général
pauvres et peu convaincantes ; à vrai dire, ce ne sont même pas des preuves. Or,
quelque effort de mémoire que je fasse, je ne puis me souvenir d'aucun argument
sérieux en faveur de la forme achevée et complète. On en revient toujours
à
la
maison et
à
sa toiture. On ne peut cependant pas invoquer les aspirations de notre
raison ? A quoi notre pauvre raison n'a-t-elle pas aspiré, et que n'a-t-on pas justifié
par ses aspirations ! Jadis au moins, on fondait sur elle de grands espoirs, et il était
naturel alors de flatter ses besoins, ses mauvaises habitudes mêmes, ses goûts et ses
caprices. Mais maintenant que tout le monde connaît son impuissance, maintenant
que les métaphysiciens eux-mêmes s'occupent de sciences naturelles et n'osent pas
quitter des yeux, ne fût-ce que pour un instant, la théorie de la connaissance,
pourquoi faut-il tenir compte des besoins de la raison ? Une des principales tâches
de notre époque ne consisterait elle pas, au contraire, à tourner (ou même à détruire,
le cas échéant) les nombreuses barrières édifiées jadis sous différents prétextes par
les puissants seigneurs féodaux de l'esprit, barrières que seul le conservatisme
myope et lâche de la nature humaine persiste à considérer comme insurmontables et
même parfaitement «
naturelles » Pourquoi achever ? Pourquoi chercher
à
conclure
? Qu'a-t-on besoin d'une conception générale du monde ? ...
Je parle évidemment de la philosophie et des philosophes, de
ceux
qui s'efforcent
de voir, de connaître, d'éprouver le plus possible de choses au cours de leur
existence. Dans la vie pratique, le dogme de l’achèvement conserve toute sa
signification. Une maison sans toit ne peut en effet servir
à
rien. Mais des pensées
inachevées,
non ordonnées, chaotiques, contradictoires, comme est contradictoire la
vie elle-même, et qui ne nous conduisent vers aucun but posé d'avance par la raison, de
telles pensées ne nous sont-elles pas plus précieuses que les systèmes et même les
grands systèmes, dont les créateurs étaient moins préoccupés de connaître le monde
que de le
«
comprendre »?
«
Si ma théorie ne s'accorde pas avec les faits, tant pis pour les faits », disait, paraît-
il, Hegel. Il me semble que bien d'autres après lui auraient pu prononcer ces paroles
orgueilleuses ; rares sont ceux qui parviennent de leur vivant
à
la gloire de Hegel qui
seule permet au philosophe de se payer un tel luxe. Les philosophes ont une très haute
opinion de leurs systèmes ; et c'est fort naturel : ils ont assez peiné pour les édifier ;
toute leur vie y a passé parfois. Et puis, les conceptions générales de l'univers sont très
demandées. L'homme veut vraiment
«
comprendre» l'univers et il arrive que ce désir
soit si fort, qu'il rend l'homme incapable de toute critique à l'égard des raisonnements
et des preuves qu'on lui propose, si bien qu'il finit par accueillir avec enthousiasme les
arguments les plus misérables. Personne, il est vrai, ne dira aujourd'hui:
«
credo quia
absurdum », mais cela ne veut pas dire que nous nous soyons complètement
débarrassés des superstitions du Moyen Age, que nous n'ayons plus de
«
credo », ni d'
«
absurdum
»,
conformes certes à l'esprit rationaliste du siècle des chemins de fer et de
l'électricité. Il ne faut d'ailleurs pas se laisser tromper par la nouveauté : si nous
cherchons bien dans notre mémoire, nous finirons toujours par y découvrir, parmi les
résidus du passé, quelque formule toute faite pour nos nouvelles croyances. Si bien
disciplinée que soit l'intelligence humaine, elle parvient toujours, en invoquant tel ou
tel prétexte,
à
se réfugier sous quelque ombrage pour s'y livrer à loisir à ses mauvais

3/8
penchants et tout spécialement au
«
dolce farniente
».
Prenons la méthodologie moderne; ses exigences ne sont-elles pas impitoyables ?
Défense sévère est faite à la foi de s'approcher des régions où règne l'investigation
scientifique. Toutes les mesures avaient été prises afin que la perfide séductrice ne pût
par quelque moyen secret s'installer non seulement dans le cerveau, mais même dans le
cœur de l'homme.
«
La foi n'est pas scientifique
», -
1es enfants eux-mêmes savent cela,
et dès l'école on nous enseigne éviter tout rapprochement avec une personne qui s'est
irrémédiablement compromise par des inventions telles que l'astrologie, l'alchimie, etc.
Et si vous examinez les doctrines méthodologiques modernes, vous vous sentirez
complètement rassurés : il est impossible qu'à travers leur réseau d'ouvrages défensifs,
la foi parvienne à pénétrer jusqu'au cœur de l'homme. Même parmi les esprits les plus
soupçonneux et les plus expérimentés, personne ne met en doute
le caractère positif de
la science contemporaine. Lorsque Tolstoï ou Dostoïevsky attaquaient la science, ils
s'efforçaient de faire dévier le débat sur le terrain moral. La science a raison, il ne peut
y avoir de doutes
à
cet égard ; mais elle est au service des riches et non des pauvres,
elle développe les mauvais instincts des hommes, etc. Nietzsche lui-même ne faisait
pas toujours montre d'une audace suffisante en face de la science contemporaine dont
la position inexpugnable le troublait.
Mais par bonheur, toutes les œuvres humaines s'avèrent, à y regarder de près,
imparfaites. Le travail scientifique de ces derniers siècles a donné de brillants résultats
pratiques, mais dans le domaine de la pensée théorique l'époque moderne n'a pas
produit grand-chose, bien qu'elle compte une série de grands noms, de Descartes
à
Hegel. Si la science a réussi
à
subjuguer l'âme humaine, ce n'est pas parce qu'elle a
résolu tous les doutes de celle-ci ou bien parce qu'elle lui a prouvé une fois pour toutes
qu'ils sont insolubles, ainsi que le pensent la plupart des gens cultivés. Ce n'est pas
grâce à son savoir que la science parvint à séduire les esprits, mais grâce aux biens
matériels, à la poursuite desquels l'humanité,
trop
longtemps malheureuse, s'est lancée
avec l'ardeur d'un mendiant affamé qui se jette sur un morceau de pain. La dernière des
scicnces positives, celle qui couronne tout l'édifice, la sociologie, promet d'élaborer des
conditions sociales qui banniront pour toujours
de la surface de la terre, - la misère, les
souffrances, les malheurs. La tentation n'est-elle pas forte ? Ne vaut-il pas la peine
pour atteindre ce but, de renoncer aux chimériques espoirs dont se nourrissait jadis
l'humanité? Et voici qu'au lieu et place du vieux
«
credo quia absurdum
»
naquit une
formule nouvelle ou, plutôt, rénovée et rendue méconnaissable :
«
credo, ut intelligam
».
Il s'agit seulement de
comprendre
le monde qui nous entoure, et l'idéal le plus élevé
qui se présente aux regards de la fantaisie
hu
maine, sera aussitôt réalisé. Tout à la joie
de cette découverte, on ne remarqua même pas que la pauvre raison humaine, guidée
cette fois par la science elle-même, incarnation de la prudence et de la méfiance,
tombait de nouveau dans le piège qu'elle s'efforçait d'éviter, car la foi en la
compréhension ne présente nul avantage par rapport aux autres croyances qui ont
régné sur les esprits. Et puis, il y a encore ce mot,
«
l'idéal
»,
devant lequel les hommes
ont
été
de tout temps habitués
à
ployer les genoux. Il s'agit bien de
questionner, de
vérifier, de douter! Tous ceux qui ont reçu une instruction philosophique,
connaissent la formule scolastique :
«
credo, ut intelligam
» ;
mais tout le monde est
convaincu qu'elle ne nous concerne pas, et que nous sommes très éloignés de ce
stade primitif où la foi déterminait le caractère et l'orientation de nos intérêts
intellectuels. Nous sommes à tel point convaincus que l'éducation scientifique nous
protège contre tout entraînement absurde, qu'en ces derniers temps nous avons
même permis
à
la pauvre bannie de se rapprocher quelque peu de nous:
«
C'est pour
nos ancêtres qu'il y avait danger
à
entretenir des rapports étroits avec la foi. Esprits
insuffisamment disciplinés et peu cultivés, ils ne savaient pas se servir du feu et
finissaient toujours par se brûler. Mais nous autres, nous allons pouvoir profiter de
sa chaleur et de sa lumière, car nous connaissons bien la nature de cette .force
dangereuse et ne craignons pas son action.
»
Ces raisonnements et d'autres du même
genre, endormirent la méfiance de la pensée humaine et aboutirent au triomphe
inouï de la science. A qui viendra-t-il maintenant à l'esprit de répéter l'antique ques-
tion : qu'est-ce que la vérité? Qui donc ne sait que cette question n'a aucun sens du

4/8
point de vue scientifique, car quelle que soit la réponse, elle n'influera en rien sur la
marche et le caractère des recherches scientifiques? La science sait d'avance ce
qu'elle veut, et elle présente ses désirs sous la forme d'affirmations qu'elle dénomme
axiomes ou postulats et qui n'exigent pas de démonstrations.
- II -
En ces derniers temps, depuis que les continuelles discussions théoriques nous
ont amenés à poser d'une façon particulièrement précise le problème de l'origine
des axiomes, on observe dans la littérature philosophique un fait extrêmement
significatif. Toute une série de savants philosophes essayent en Allemagne de
développer ce que l'on a appelé la théorie normative de la loi de causalité. Cette
théorie n'a rien d'essentiellement nouveau ; ce n'est en somme qu'une forme
particulière du kantisme. Mais ce qui m'apparaît significatif, c'est que les penseurs
modernes croient nécessaire de souligner tout spécialement certains aspects de la
doctrine kantienne que l'illustre fondateur de l'idéalisme transcendantal ne jugeait
nullement indispensable de placer au premier plan.
Le lien qui relie chez Kant la science à l'éthique, est parfaitement apparent, et
point n'est besoin pour le constater des travaux de ses derniers disciples. Mais
bien que Kant ait proclamé la primauté de la raison pratique, jamais il ne présenta
le développement naturel des phénomènes comme déterminé directement par nos
besoins éthiques. Chez lui, la loi règne en despote aussi bien sur les phénomènes
du monde extérieur que sur l'âme humaine. C'est le seul lien qu'il y ait entre les
deux. La nature et l'homme obéissent. Cela suffisait amplement
à
Kant. Quant aux
philosophes modernes, était-ce parce qu'ils avaient plus de prétentions ou bien
voyaient-ils qu'il était impossible de se maintenir dans la position de Kant, en tout
cas, ils allèrent plus loin encore. Ils n'admettent pas l'existence d'une loi
indépendante pour la raison théorique ; ils placent celle-ci sous le contrôle, sous la
direction de la raison pratique et s'efforcent de trouver une base éthique
à
la
catégorie de la causalité, demeurée indépendante chez Kant. Avec Kant ils
admettent que l'ordre n'est pas inhérent aux phénomènes du monde extérieur, et
que c'est la raison humaine qui l'y introduit ; mais elle l'y introduit non pas parce
qu'elle est obligée en vertu d'on ne sait quel décret mystérieux de prendre sur soi
ce rôle législatif, peut-être fort bas et équivoque, mais parce que c'est un rôle
supérieur que la morale elle-même justifie et sanctifie. Or, une fois que la morale
est parue en scène, il faut mettre chapeau bas : les discussions sont interdites.
Le lecteur comprendra mieux maintenant, peut-être, la signification et
l'importance primordiale de la guerre que Nietzsche déclara
à
la morale. Les
philosophes allemands qui avaient établi les bases morales de la loi de causalité,
suivaient leur route en toute tranquillité et ne se doutaient probablement même pas
de l'existence de Nietzsche. De son côté, celui-ci, qui dès les années soixante-dix,
s'était détaché de la vie universitaire et s'intéressait en général fort peu aux
doctrines philosophiques modernes, n'était pas au courant des tendances nouvelles
de la philosophie allemande et ne pensait certainement pas qu'il travaillait
à
la
même tâche que les représentants officiels de cette science. Il est vrai qu'il y
travaillait à sa manière. Tandis que les Allemands faisaient tous leurs efforts pour
soutenir le prestige branlant de l'ordre naturel et jetaient sur le tapis le dernier et le
plus gros de leurs atouts, - la morale (après quoi on n'avait plus rien), - Nietzsche,
soudain, déclara que le paiement s'effectuait en fausse monnaie, que la morale
elle-même devait être justifiée et qu'elle ne pouvait par conséquent se porter
garante pour la science. Nietzsche n'a jamais formulé cette pensée avec toute la
netteté désirable ; je ne suis même pas sûr qu'il en eût pleinement conscience. Il
semble qu'il ait senti plutôt instinctivement qu'il était impossible de lutter avec
succès contre la Science, tant que sa puissante et fidèle alliée, - la Morale, était
encore debout. L'instinct, nous le voyons, ne se trompa pas. Aujourd'hui, les
esprits les plus prudents doivent se convaincre que les axiomes, les postulats

5/8
fondamentaux ne se maintiennent que grâce à la morale. Cet aveu n'était-il pas de
leur part un peu précipité? Ils ne pouvaient certainement pas s'imaginer que leur
morale millénaire perdrait un jour ou l'autre son action sur les esprits. C'est fort
possible. En tout cas, les mots révélateurs ont été prononcés, et il est peu probable
qu'ils soient oubliés jamais. Tolstoï, Dostoïevsky, d'autres encore essayèrent
d'opposer la morale à la science, mais leurs efforts restèrent sans résultats. La
morale et la science sont des sœurs, filles toutes deux de cette mère qu'on nomme
la loi ou la norme. Il leur arrive de se disputer entre elles et même de se haïr, ainsi
que cela se produit entre les membres d'une même famille, mais tôt ou tard les
liens du sang se manifestent et les deux sœurs se réconcilient. Les Allemands le
savent bien. Partout,
à
l'école,
à
l'armée, dans la police, en philosophie, en morale,
ils ont pour premier principe l'ordre. Et ce principe est indiscutablement fort utile.
Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler les nombreux succès qu'ont atteint
nos voisins disciplinés, Il y a peu de temps encore, ils marchaient en queue des
peuples européens, et maintenant, ils prétendent à l'hégémonie dans le domaine de
la culture.
Si la science et la morale ne se posaient que des buts utilitaires, on devrait
admettre qu'elles ont brillamment réussi. Mais on voit que leurs prétentions sont
plus hautes ; elles visent
à
obtenir de souverains droits sur l'âme humaine. Et alors
surgit de nouveau l'ancienne question que l'humanité malgré tous les efforts de la
théorie de la connaissance n'oublia jamais et qui demeurera toujours : qu'est-ce
que la vérité? La science se tait. La morale obéissant à sa vieille habitude continue
à clamer à tue-tête ses vétustes formules qui n'ont plus de sens et n'inspirent plus
confiance.
- III -
La Morale est scientifique. La Science est morale. Il est clair que la théorie de la
connaissance a laissé échapper un élément très important de la question. La
philosophie critique admet comme postulat : la raison que cette philosophie prend
à
tâche d'analyser, est immuable et toujours égale à elle-même ; mais cette
affirmation est arbitraire et ne repose sur rien. La certitude de Kant n'était
déterminée que par le besoin qu'il éprouvait de réunir les mathématiques et les
sciences naturelles sous le nom générique de Science. Mais d'où provenait ce
besoin ? Tout homme impartial, tout homme forcé d'être impartial (car qui donc
consentira à renoncer de son propre gré
à
ses passions et à ses désirs ?) pourra ici
constater un fait extrêmement important. Tôt ou tard le philosophe jette à terre la
charge des idées pures qui l'écrase, et s'arrête un instant pour puiser un peu d'eau
fraîche à la source empirique, quand bien même il ait promis solennellement au
début de son voyage de renoncer à la réalité empirique. Kant devait lui aussi
s'arrêter. Il avait besoin par-dessus tout de repos, et aspirait
à
terminer le voyage
entrepris sous l'action du scepticisme de Hume. Mais depuis que la philosophie
existe, l'un des grands fondateurs de système s'est-il jamais permis d'avouer
franchement sa faiblesse humaine et de dire, comme le dit tout voyageur
à
bout de
forces :
«
Je suis fatigué et veux me reposer, même sur une erreur, même en me
laissant aller
à
la croyance illusoire que j'ai enfin atteint mon but
»
? Mais
d'ailleurs, il faut bien le dire, celui qui aspire à la gloire d'Alexandre le Grand et
rêve de dominer le monde, tranche les nœuds gordiens et ne les dénoue pas.
Lorsque l'homme n'a plus la force d'aller de l'avant, il déclare qu'il est arrivé, qu'il
ne faut plus avancer et qu'il n'y a plus rien devant lui ; il affirme qu'il est temps de
s'arrêter et de se mettre
à
construire un système général du monde. C'est là peut-
être l'explication de ce fait à première vue étrange, que chaque nouvelle
génération invente ses propres vérités qui n'ont rien de commun avec celles des
générations précédentes et même les contredisent, bien que les historiens
s'acharnent
à
vouloir établir leur filiation. Quel rapport, quelle compréhension
mutuelle peut-il y avoir entre l'adolescent plein de forces qui débute dans la vie et
le vieillard fatigué qui essaye d'établir le bilan du passé. Et puis, il y a différents
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%