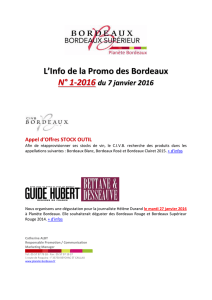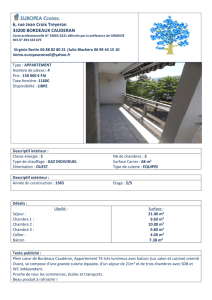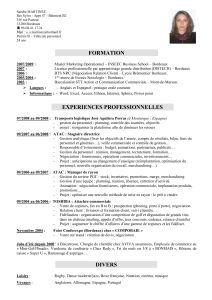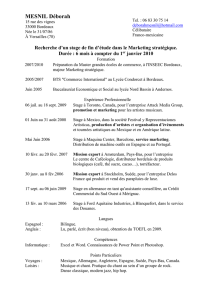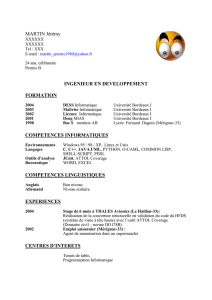Chaban-Delmas et l`économie girondine : spectateur ou acteur du

Chaban-Delmas spectateur ou acteur du déclin et du renouveau de l’économie
girondine ?
Hubert Bonin, professeur d’histoire économique à l’Institut d’études politiques de Bordeaux et à l’UMR
GRETHA-Université Montesquieu Bordeaux 4 [www.hubertbonin.com]
Au pouvoir local pendant une quarantaine d’années, Jacques Chaban-Delmas s’est
identifié à une cité rajeunie, réinsérée dans le jeu de l’expansion économique, transformée
en « métropole »
1
apte à jouer un rôle significatif au sein de la stratégie de rééquilibrage
des forces économiques entre la capitale parisienne et la province, ou aussi à l’échelle de la
région aquitaine
2
. Notre propos vise à soupeser les marges de manœuvre et d’impulsion
dont a pu disposer l’acteur local du développement économique et à préciser les
réalisations dont il a pu être partie prenante, de la Reconstruction
3
à la modernisation puis
à la reconversion.
1. Éviter les anachronismes : une capacité d’action modeste
Depuis les lois sur la décentralisation dans les années 1980-2000, les pouvoirs d’ingénierie
et de décision de l’élu d’agglomération se sont considérablement accrus. Or, au temps de
Chaban-Delmas, le responsable d’une grande cité est placé sous la tutelle de l’appareil
d’État et notamment du préfet et des directeurs d’administrations départementales. Quelle
que soit l’image de marque qu’a voulu se construire le maire de Bordeaux, autour d’un
corpus de dynamisme et de modernité, son pouvoir de décision et d’action réel est fort
limité pour impulser l’évolution économique de son aire d’influence. Toute décision doit
être ratifiée ex ante ; la « découpe » des budgets territoriaux dépend de structures
étatiques laissant peu de marge de manœuvre. Même si Chaban-Delmas devient président
de la Région pendant quelques années, celle-ci, contrairement à aujourd’hui, n’est guère
équipée pour jouer déjà un rôle de stimulant de l’innovation.
Pourtant, Chaban-Delmas il dispose d’un capital d’expérience substantiel, puisqu’il est
ministre à quelques reprises dans des domaines touchant à l’économie
4
; comme
parlementaire, il peut accéder en direct aux processus de mise au point des Budgets et de
certaines lois prévoyant la répartition de fonds publics ; grâce à ses liens avec quelques
bons compagnons gaullistes (comme son voisin libournais Robert Boulin
5
, secrétaire d’État
aux Finances ou au Budget), il a certainement consolidé cette aptitude à accéder à des
informations idoines ; comme Premier Ministre
6
, il a pu d’en haut intégrer peu ou prou
l’agglomération bordelaise dans les schémas de développement et d’aménagement
1
Maurice Goze, « Mutations et structuration d’une métropole : Bordeaux », in Claude Lacour (dir.),
Dynamique d’un espace urbain. Bordeaux, Bordeaux, Bière-IERSO, 1980, pp. 19-82.
2
Claude Lacour, « Vingt-cinq ans d’évolution économique et sociale en Aquitaine. 1950-1975. La
structuration de l’espace régional. Urbanisation et urbanisme en Aquitaine : d’une métropole dominante à un
système urbain d’équilibre ? », Revue économique du Sud-Ouest, 1977, n°1, 29.
3
Hubert Bonin & Bernard Lachaise, « Les ambitions et les enjeux de la Reconstruction » in H. Bonin, Sylvie
Guillaume et Bernard Lachaise (dir.), Bordeaux et la Gironde pendant la Reconstruction 1945-1954, Pessac,
Publications de la Msha, 1997, pp. 11-15. INSEE, Annuaire statistique régional rétrospectif, tome 2 :
« Questions économiques », Direction régionale de Bordeaux, 1951.
4
Frédéric Turpin, « La stratégie participationniste : Jacques Chaban-Delmas ministre de Pierre Mendès
France et de Guy Mollet », in Bernard Lachaise & Jean-François Sirinelli (dir.), Jacques Chaban Delmas,
Presses universitaires de France, 2007, pp. 85-98.
5
Cf. Hubert Bonin, Bernard Lachaise & Christophe-Luc Robin (dir.), Robert Boulin, Bruxelles, Peter Lang,
2010.
6
Hubert Bonin & Bertrand Blancheton, « Les objectifs et les résultats de la politique économique de Chaban-
Delmas, Premier Ministre (juin 1969-juillet 1972) », in Bernard Lachaise & Jean-François Sirinelli (dir.),
op.cit., pp. 201-222.

2
nationaux, pour lui faire tirer parti des opportunités dessinées par la mise en œuvre de
programmes économiques substantiels à l’apogée des Trente Glorieuses.
Cela dit, le maire puis aussi président de la Communauté urbaine de Bordeaux, aussi avisé
soit-il, ne peut se substituer aux « forces du marché », se poser à lui seul en « sauveur »
d’une économie girondine qui doit se confronter aux défis de l’adaptation aux nouvelles
structures de compétition interrégionale, puis européenne. Or elle est secouée par la
reprise du processus de modernisation et de guerre de la productivité – suspendu grosso
modo depuis les années 1930 – au sommet de la deuxième révolution industrielle ; puis
elle est meurtrie comme le reste du pays par l’éclatement de la grande crise de
restructuration qui se déploie entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1990
et qui ne manque pas de frapper les entreprises bordelaises
7
– donc quand Chaban-Delmas
a quitté le pouvoir national et est encore maire pour une vingtaine d’années.
2. Se créer des leviers de réflexion et d’impulsion
Quelles que soient les limites à sa capacité d’action économique, Chaban-Delmas a pu se
construire un capital d’action et d’influence dont il convient de préciser les contours.
Comme il a été un temps compagnon de route des « mendésistes » au milieu des années
1950 et d’un centre-gauche rénovateur (Edgar Faure, Félix Gaillard, Eugène Claudius-
Petit), il a pu s’imprégner à leur naissance des idées des promoteurs de « l’aménagement
du territoire »
8
. L’idée est de contrer les menaces de « déclin » qui pèsent sur des régions
confrontées à la guerre de compétitivité interrégionale au fur et à mesure que les
entreprises moyennes provinciales doivent s’aligner sur des critères de productivité et
d’innovation élevés ; l’abaissement des barrières protectionnistes, puis l’insertion dans le
Marché commun, le repli des chasses gardées de l’empire colonial (si importantes pour le
négoce
9
et le port girondins) imposent d’accélérer le processus de mise à niveau. Les Plans
des années 1950-1960 cristallisent ce sentiment d’urgence en insistant sur les exigences de
« l’expansion » et d’une intense modernisation. Une partie du tissu économique
« classique » de l’agglomération bordelaise est ainsi sur le front direct de ces batailles –
comme le relate la thèse de Jean Dumas
10
.
Or les élites économiques girondines sont trop enracinées dans les traditions et les mythes
d’une grandeur pérenne et en cours de reconstitution au lendemain de la guerre. Les
entreprises de biens de consommation aux débouchés régionaux ou ultramarins, la
métallurgie de transformation ancrée autour des chantiers navals ou des chemins de fer, le
7
Hubert Bonin & Olivier Pétré-Grenouilleau, « Deindustrialisation and reindustrialisation: the case of
Bordeaux and Nantes », in Franco Amatori, Andrea Colli & Nicola Crepas (dir.), Deindustrialization &
Reindustrialization in 20th Century Europe, Milan, FrancoAngeli, 1999, pp. 233-262. Paul Terrasson,
L'industrie huilière en France et en Aquitaine de 1945 à 1993. Rappel des origines, Bordeaux, La Mémoire
de Bordeaux, 1996. Joseph Lajugie, « La lutte pour le renouveau économique. I. Une reconversion difficile,
1945-1954 », in Bordeaux au XXe siècle, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1972, pp. 385-419.
8
Hubert Bonin, & Bertrand Blancheton, « Un aménageur : Chaban-Delmas, Premier Ministre (1969-1972) »,
Revue d’économie régionale & urbaine (RERU), 2007, n°5, pp. 963-973.
9
Hubert Bonin, « La construction d’un système socio-mental impérial par le monde des affaires ultramarin
girondin (des années 1890 aux années 1950) », in Hubert Bonin, Catherine Hodeir & Jean-François Klein,
L’esprit économique impérial (1830-1970). Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France &
dans l’empire, Paris, Publications de la SFHOM, 2007, pp. 243-286. Jean Touton, Gérard Delalande, Philippe
Doutreloux, Alain Huetz de Lemps & Jean-Roger Domecq, Le négoce bordelais des denrées tropicales,
Bordeaux, Les Cahiers de La Mémoire de Bordeaux-William Blake & Co, n°6, 1996.
10
Jean Dumas, Les activités industrielles dans La Communauté urbaine de Bordeaux. Études de géographie
économique et sociologique, Bordeaux, Bière, 1980. Jean Dumas, « La Gironde industrielle : un département
et une métropole face à la crise », Revue économique du Sud-Ouest, 1987, 1, pp. 75-96. Jean Dumas, « Vraie
continuité ou fausse modernisation : l’industrie bordelaise au moment de la Reconstruction », in Bordeaux et
la Gironde pendant la Reconstruction, op.cit., pp. 111-120.

3
négoce des vins habitué à ses modes de vie et ses marchés historiques, le négoce maritime
stimulé par la reprise des relations avec l’Afrique et les Antilles, voire avec l’Indochine, ne
s’imaginent pas de l’ampleur des « chocs » qui les guettent. La Chambre de commerce et
d’industrie
11
reflète cette communauté des affaires qui s’estime « éternelle » autour d’un
port dont l’avenir paraît lui aussi incontestable
12
.
Sans céder à la construction du « mythe chabaniste », il convient de mettre en valeur les
initiatives prises pour contourner ce qui devient un bloc de résistance au « progrès », dès
lors que ces acteurs de la puissance économique girondine croient à la reproduction des
« dynasties bordelaises »
13
et à la pertinence de leur « modèle économique ». Cependant,
Chaban-Delmas ne se pose pas en « adversaire » de ces bourgeoisies. D’une part, il s’est
appuyé sur une partie d’entre elles pour percer politiquement et s’enraciner dans des
réseaux d’influence (le courtier en vins Lawton, le négociant en vins Lemaire, le négociant
en cacao Touton, etc.). D’autre part, son art politique consiste dans la recherche d’un
consensus dans le mouvement plus qu’une logique de crise, et son ambition est donc de se
doter des instruments d’expertise lui permettant de mobiliser à la fois les forces
bourgeoisies locales et les leviers de l’appareil économique d’État.
Le premier pan de ce capital d’expertise est bâti à l’aide des blocs conceptuels transportés
depuis Paris : toute la logique de l’aménagement du territoire (celle de la IVe République à
partir de 1950, puis celle de la DATAR, à partir de 1963, longtemps animée par son ami
Olivier Guichard), de la modernisation des structures productives (plan Defferre de
restructurations de la construction navale
14
, qui prévoit le repli de Bordeaux au profit de
Nantes-Saint-Nazaire et de Dunkerque ; résultats des réflexions des commissions du Plan,
schémas d’aménagement des transports
15
, etc.) est ainsi susceptible d’être mobilisée au
profit de sa duplication girondine.
Le deuxième pan est construit sur Bordeaux même. En effet, Chaban-Delmas crée en 1955
le Comité d’expansion Bordeaux-Sud-Ouest (devenu en 1961 le Comité d’expansion
Bordeaux-Aquitaine)
16
. Il entend contourner une Chambre du commerce jugée alors trop
11
Paul Butel (dir.), Jean-Claude Drouin, Georges Dupeux & Christian Huetz de Lemps, Histoire de la
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, 1705-1985, Bordeaux, CCIB, 1988. Stéphane Boudjema,
« La Chambre de commerce de Bordeaux de 1945 à 1954 : dix années de Reconstruction », Annales du Midi,
n°223, juillet-septembre 1998, pp. 361-380.
12
Élie Desplat & Jacques Quenivet, Les compagnies maritimes à Bordeaux, collection des Bordeaux, Cahiers
de La Mémoire de Bordeaux, n°4, 1993. Robert Chevet, Le port de Bordeaux au XXe siècle, Bordeaux,
L’Horizon chimérique, 1995. Alexandre Fernandez, « Économie et nostalgie : les Bordelais et le port », in
Pierre Guillaume (dir.), Histoire des Bordelais, tome deux, Bordeaux, Mollat, 2002. Roger & Christian
Bernadat, Quand Bordeaux construisait des navires. Histoire de la construction navale à Bordeaux,
Camiac-et-Saint-Denis, Éditions de l’Entre-deux-mers, 2006. Alexandre Fernandez, « Sur la disparition des
activités de construction navale à Bordeaux », Revue d’histoire maritime, n°7, PUPS, 2e semestre, pp. 263-
275.
13
Paul Butel, Les dynasties bordelaises, de Colbert à Chaban, Paris, Perrin, 1991. Hubert Bonin, « Les
Bordelais de l’économie des services. L’esprit d’entreprise dans le négoce, l’argent et le conseil ». « Les
Bordelais patrons face à l’histoire économique », in Pierre Guillaume (dir.), Histoire des Bordelais. Tome 2.
Une modernité attachée au passé 1815-2002, Bordeaux, Mollat & Fédération historique du Sud-Ouest, 2002,
pp. 59-86.
14
Bernard Cassagnou, La direction du Budget et la marine marchande pendant les années 1950, Paris,
Publications du Comité pour l’histoire économique et sociale de la France, 1997.
15
Christophe Bouneau, « La contribution des grands réseaux à la construction de l’identité économique de
l’Aquitaine et du Sud-Ouest », in Josette Pontet, Jean-Paul Jourdan & Marie Boisson (dir.), À la recherche de
l’Aquitaine, Pessac, Centre Aquitain d’histoire moderne et contemporaine, 2003, pp. 137-154.
16
Régine Robin, Le Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest CEBSO-Comité expansion Aquitaine, 1954-1974,
maîtrise d’histoire, Université de Bordeaux 3, 1991 (dir. S. Guillaume et H. Bonin). Denis Montané, Le
Comité d’expansion aquitain de 1974 à 1986, maîtrise d’histoire, 1993, Université de Bordeaux 3 (dir. H

4
inerte et classique. Ce Comité monte des commissions qui réunissent des experts de
l’université, de l’entreprise et de l’administration ; elles méditent sur les remèdes à
apporter à la crise vécue par telle ou telle branche de l’économie locale ; sur la capacité
d’anticipation face aux menaces qui pèsent sur des secteurs dont on sait bien qu’ils ne sont
plus compétitifs – même s’il est « tabou » de l’exprimer trop publiquement. Des signes
surgissent toutefois, par le biais de crises localisées (écroulement de la maison Touton en
1953, de maisons de vin dans la première moitié des années 1970, longue crise de
fermeture des chantiers navals Forges & chantiers de la Gironde tout au long des années
1960, multiples crises de sociétés dans l’agro-alimentaire (huilerie, biscuiterie, sucrerie)
17
ou dans la chaussure ou l’habillement. Le Comité publie de nombreux rapports
18
, plus ou
moins valides a posteriori, mais cohérents avec les modes de pensée de l’époque, qui
privilégient une politique de « réindustrialisation ». Il sert d’incubateur à la maturation de
nouvelles mentalités au sein des élites bordelaises, d’autant plus que des universitaires
relaient ses travaux, notamment Joseph Lajugie à la faculté de sciences économiques ; il y
monte en 1951 l’IERSO (Institut d’études et de recherches du Sud-Ouest), dont les
abondantes publications (revue, livres)
19
démultiplient les acquis des débats du Comité,
tandis que des mémoires et thèses en approfondissent les hypothèses sur les perspectives
de développement en fonction des points forts et des points faibles de l’économie
régionale.
En parallèle, au sein d’un organisme essentiellement chargé de donner plus de
transparence au marché des vins, le CIVB (Comité interprofessionnel des vins de
Bordeaux, créé en 1943/1948), des négociants et producteurs (de crus renommés ou de
terroirs modestes) entreprennent de discuter de la crise stratégique de l’économie viticole.
En leur sein, les réseaux chabanistes disposent de quelques « antennes » aptes à relayer le
fruit de ces discussions parfois farouches mais aussi de plus en plus « constructives »,
notamment pour peser sur le processus législatif et réglementaire national, sur lequel les
élus girondins peuvent jouer ponctuellement. Dans l’autre partie du monde patronal,
Chaban-Delmas obtient également des relais, car il réussit à créer un lien quasiment intime
avec quelques leaders du renouveau entrepreneurial girondin. C’est le cas avec les frères
Desse (construction métallique) et surtout avec Yves Glotin (patron de Marie-Brizard
20
).
Avec eux, il poursuit des discussions qui éclairent sa perception de la crise des structures et
des mentalités et des solutions envisageables, d’autant plus que, au sein de la CCI, ces
« modernistes » voient leur influence progresser. Les Desse figurent au Bureau ; Glotin en
devient le président en 1958-1964.
Cela dit, Chaban-Delmas a pu s’appuyer aussi sur les entités girondines de l’appareil
économique d’État pour nourrir sa politique de « modernisme éclairé ». La montée en
puissance de la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, grâce au dynamisme
Bonin). Gabriel Poulalion, « La pensée économique à Bordeaux pendant la Reconstruction », in Bordeaux et
la Gironde pendant la Reconstruction, 1945-1954, op.cit., pp. 189-196.
17
Hubert Bonin, « L’industrie agroalimentaire du grand Sud-Ouest aux XIXe-XXe siècles. Un renversement
historique du positionnement dans les flux économiques », in Jacques Marseille (dir.), Les industries
agroalimentaires en France. Histoire & performances, Paris, Le Monde Éditions, 1997, pp. 121-160.
18
Comité d’expansion Aquitaine, L’économie de l’Aquitaine, Bordeaux, 1964. Comité d’expansion Aquitaine,
« Schéma d’aménagement de la métropole de Bordeaux », Revue économique et juridique du Sud-Ouest,
1973, n°3, 559. Comité d’expansion Aquitaine, Programme de développement et d’aménagement 1976-1980,
Bordeaux, Delmas, 1977.
19
Pierre Barrère, « Conditions géographiques de l’expansion économique de la région Bordeaux-Sud-
Ouest », Revue juridique et économique du Sud-Ouest, 1956, 1, 3. Hervé de Carmoy, « Rapports préliminaire
sur l’orientation économique de la région Bordeaux Sud-Ouest », Revue juridique et économique du Sud-
Ouest, 1955, 2, 111. Jean-Guy Mérigot, « Économie du Sud-Ouest et économie française », Revue juridique et
économique du Sud-Ouest, 1957, 3, 413.
20
Hubert Bonin, Marie Brizard, 1755-1995, Bordeaux, L’Horizon chimérique, 1995.

5
entrepreneurial de son directeur François Bloch-Lainé (1953-1967)
21
, un grand commis de
l’État qui a lui aussi fréquenté le monde de la Résistance active, a en effet nourri toute une
stratégie de déploiement d’outils consacrés à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme
dans les métropoles régionales ; elle a notamment participé à la société d’économie mixte
d’aménagement et d’urbanisme de Bordeaux, et ainsi fourni à la Ville des outils
d’ingénierie et de conseil. Les services extérieurs des ministères (Industrie, Transports,
Finances, en particulier) ne pouvaient manquer de travailler la main dans la main avec les
grands élus locaux, dans le cadre d’une « politique partagée », en mêlant action centralisée
des pouvoirs publics et politiques locales. C’est bien là que se situe d’ailleurs le nœud de
notre débat : à quel degré Chaban-Delmas a-t-il été « partie prenante » dans la
cristallisation des axes de la politique économique concernant Bordeaux et la Gironde ? le
port de Bordeaux ? les grands axes de transport routier puis aussi ferroviaire ? Où se
situait le point d’inflexion entre l’application locale des politiques d’État et l’insertion
nationale des choix locaux ? En fait, plus Chaban-Delmas disposait d’un capital d’expertise
local (Comité d’expansion, CCI, cercles patronaux modernistes, etc.), plus il disposait
d’une marge de manœuvre pour participer activement aux débats en amont de la définition
des choix de politiques publiques appliquées à la capitale aquitaine.
Une ultime question se pose, celle de la « différenciation » : en quoi Chaban-Delmas a-t-il
été un plus « grand maire » que d’autres fortes personnalités de la vie territoriale de cette
époque ? L’on pensera ainsi à Louis Pradel (Lyon), Gaston Defferre (Marseille), Henri
Fréville (Rennes) ou Pierre Pflimlin (Strasbourg), entre autres. Lui aussi a pu rester au
pouvoir pendant plusieurs lustres et ainsi contribuer à une réelle stratégie dans la durée.
Mais c’est bel et bien au niveau du pays dans son ensemble qu’a été conçue la politique
d’aménagement du territoire concernant « les grandes métropoles d’équilibre » et qu’ont
été définis des concepts et des formules déclinés ensuite dans l’ensemble de ces dernières
(zones industrielles, pôles de reconversion, restructuration des centres urbains pour créer
des pôles de tertiaire supérieur, etc.). Il faut donc rester prudent sur la force de levier du
« chabanisme économique » ; a contrario, d’autres maires de grandes cités ont pu sembler
moins prompts à se saisir des leviers mis à leur disposition par l’État (Augustin Laurent, à
Lille, par exemple, avant que Pierre Mauroy insuffle son dynamisme à partir de 1971). À
coup sûr, tant le maire que le président de la Communauté urbaine de Bordeaux
22
n’ont
pas hésité à accompagner pro-activement la politique de l’État sur les espaces girondins
concernés – mais notre analyse sans statistiques restera donc empirique.
3. Rendre Bordeaux attractive et efficace
L’on ne peut séparer la politique urbaine de la politique économique municipale. En effet,
la politique de « grands travaux » du maire Adrien Marquet
23
aura été quasiment
suspendue à partir du milieu des années 1930, faute d’argent, puis à cause de la guerre. La
ville paraît à tous les observateurs de l’époque plutôt « sombre », « sale » ; et, surtout, mis
à part quelques équipements phares (Régie du gaz et de l’électricité, stade, abattoirs, etc.),
nombre de ses quartiers ne sont qu’un enchevêtrement de bâtisses modestes, de pâtés
insalubres, de rues étroites et peu équipées en voirie correcte. « Assainir » constitue une
politique urbaine et sociale ; mais c’est aussi pour l’équipe chabaniste l’occasion de créer
quelques pôles d’attraction pour des entreprises locales ou pour des antennes d’entreprises
21
Michel Margairaz (dir.), François Bloch-Lainé, fonctionnaire, financier, citoyen, Paris, Comité pour
l’histoire économique et sociale de la France, 2005.
22
Robert Manciet, « La Communauté urbaine de Bordeaux dans l’espace régional aquitain », in Région et
aménagement du territoire. Mélanges offerts au doyen Joseph Lajugie, Bordeaux, Bière, 1985, pp. 577-587.
23
Hubert Bonin, « Marquet et le "socialisme municipal" : l’action économique et sociale », in H. Bonin,
Bernard Lachaise & Françoise Taliano-des Garets, Adrien Marquet, les dérives d’une ambition (1924-1955).
Bordeaux, Paris, Vichy, Bordeaux, Confluences, 2007, pp. 140-231.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%