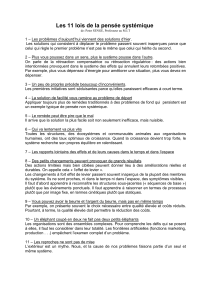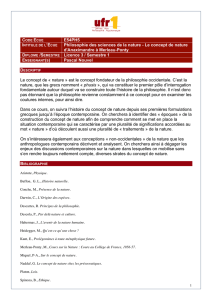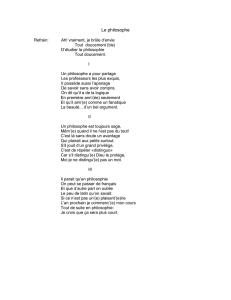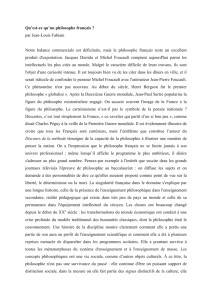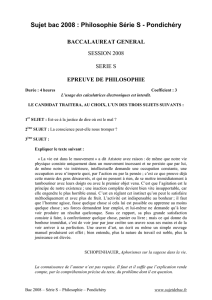article à la base du séminaire PhiloMa de Laurent Ledoux sur Senge

Complexité du « réel » et orientation philosophique
Quelques réflexions à partir de deux approches radicalement différentes :
la pensée systémique de Peter Senge &
la philosophie anti-systémique de Marcel Conche
Philosophie & Management – 28/05/05
Laurent Ledoux
1. Introduction
Le but premier de cette présentation est d’ouvrir quelques pistes de réflexion sur la façon
d’envisager la complexité du réel et ses conséquences sur la façon dont nous envisageons,
d’une part, la pensée et l’action et d’autre part la poursuite de la vérité et du bonheur.
Pour ce faire, je partirai de deux auteurs très différents :
Peter Senge est un guru du management connu pour ses ouvrages sur l’organisation
apprenante (learning organizations) et la pensée systémique (system thinking). Son
ouvrage le plus connu est la 5ème discipline (The Fifth discipline).
Marcel Conche est un philosophe qui est resté longtemps secret ou méconnu mais qui est
aujourd’hui apprécié par un public de plus en plus vaste. Proche de Montaigne et des
Antésocratiques (Héraclite, Parménide, Pyrrhon, Lucrèce, Epicure,…) dont il est un des
plus éminents connaisseurs, on peut qualifier ses positions philosophiques, au risque
d’être réducteur, de « mysticisme naturaliste » en métaphysique et de « rationalisme
universaliste » en philosophie morale. Il pense à la façon radicale et directe des Grecs, des
Antésocratiques (« en pensant, dit-il, plutôt qu’en se regardant penser »). Il a trop lu
Montaigne pour croire aux systèmes. La seule avancée qui importe selon lui est celle qui
nous ouvre à la Nature et à la vie, aux autres et à nous-mêmes. Il ne présuppose rien,
hormis l’universel. Il ne croit à rien, hormis à la vérité en tant qu’objet de recherche. La
métaphysique est pour lui l’essentiel de la philosophie. Cela ne l’empêche pas de donner à
la morale et à l’éthique leur part (qui n’est pas la même : la morale porte sur les droits et
les devoirs inconditionnels de l’être humain, l’éthique, ou les éthiques, dépendent du
choix de chacun), ni d’apporter, sur l’une et sur l’autre, de décisifs éclairages. Pour lui,
« la philosophie est la recherche de la vérité au sujet du Tout de la réalité, et de la place de
l’homme dans le Tout. » Pour André Comte-Sponville, la pensée de Marcel Conche est
l’une des rares philosophies de ce temps.
Pourquoi ces deux auteurs ?
Tout d’abord, bien sûr, parce qu’ils touchent tout deux aux notions de complexité du réel
et leur façon différente de le faire entraîne des positions très différentes sur une série de
points importants (pensée versus action, vérité versus bonheur).
Ensuite parce qu’un séminaire de Philosophie et Management me semblait être le moment
approprié de juxtaposer les textes d’un philosophe et ceux d’un guru du management.
Comme on le verra, ce qui ressort clairement de cette juxtaposition est le manque de
rigueur dans l’usage des mots et des concepts dans les textes de Senge (qui pourtant ne se
défend pas mal par rapport à la moyenne des autres gurus du management).

Enfin, parce que, tout deux, pour des raisons personnelles, me sont chers :
Lorsque j’étais chez Arthur D. Little, j’ai souvent utilisé dans mon travail les « 5
disciplines » de Senge, qui était par ailleurs attaché à Arthur D. Little au travers d’une
des filiales du groupe, Innovation Associates. J’ai prolongé la réflexion initiée avec
Senge sur les organisations apprenantes, la clarification et le partage d’une vision et
d’une stratégie au travers de Kaplan & Norton et de leur célèbre Balanced Scorecard,
que j’ai développée pour de nombreuses organisations. Pourtant la pratique de la
gestion du changement et la lecture de certains auteurs comme François Jullien (dans
son « Traité de l’efficacité) me fait parfois douter de la pertinence et de l’efficacité de
la gestion par objectifs, du plan dressé d’avance et de l’héroïsme de l’action
occidental.
Il y a quatre ans, presque jour pour jour, j’ai commencé à lire mon premier livre de
Marcel Conche, « Présence de la Nature ». Je ne l’oublierai jamais. Mon premier fils,
Julian, venait de naître. Pour le calmer j’allais le promener au parc du Cinquantenaire.
Je profitais des moments où il s’endormait sous les arbres pour lire le livre de Conche
que m’avait donné mon grand ami Jean Jadin. Et je sentais ainsi tout particulièrement
la présence de la Nature dont parlait Conche. Aussi, tous ces éléments, outre la
stimulation intellectuelle que me procuraient les mots de Conche, font de la lecture de
ces premières pages un moment inoubliable pour moi. Depuis, j’ai lu pratiquement
toute l’œuvre de Conche. La lecture de ses livres reste un élément décisif dans mon
évolution philosophique, même si, je l’avoue sans honte, je suis loin d’avoir tout
compris de ce qu’il écrit, et cela bien qu’il écrive d’une manière limpide. En effet, ce
qu’il écrit est d’une puissance extraordinaire. C’est d’ailleurs aussi pour cela que j’ai
saisi avec joie l’opportunité de vous faire cette présentation : elle a été pour moi
l’occasion de faire le point sur ce que je comprend de l’œuvre de Marcel Conche et de
vous introduire brièvement à la pensée de ce philosophe essentiel.
Après une brève introduction de la pensée des deux auteurs, je structurerai ma réflexion
autour de trois binômes conceptuels :
Ce qui est « vraiment » réel et ce qui n’est pas « vraiment » réel
Pensée et action
Vérité et bonheur

2. Brève introduction à la pensée systémique de Peter Senge
La pensée systémique de Peter Senge est l’une des 5 disciplines que Senge préconise de
suivre pour faire de nos organisations des « organisations apprenantes, capables de réaliser
leurs plus grandes ambitions ».
Ces 5 disciplines complémentaires sont :
La maîtrise personnelle (« personal mastery ») : « la discipline de clarifier et
d’approfondir continuellement notre vision personnelle, de focaliser nos énergies, de
développer notre patience et de regarder la réalité de manière objective. » C’est la
« fondation spirituelle des organisations apprenantes ».
Les modèles mentaux (« mental models ») : « la discipline d’apprendre continuellement à
remettre en question nos préjugés, nos visions et images intérieures qui influencent la
façon dont nous comprenons le monde et la manière avec laquelle nous agissons. » Il
s’agit également d’apprendre à mener des conversations enrichissantes (apprenantes) qui
équilibrent « inquiry and advocacy », mettant à nu la schémas mentaux selon lesquels nos
interlocuteurs et nous-mêmes pensons.
L’élaboration de vision partagée (« building shared vision ») : « la discipline de traduire
une vision individuelle (celle du ou des leaders de l’organisation) en une vision partagée
par tous les membres de l’organisation, c’est-à-dire un ensemble de principes et de
pratiques guidant les actions de chacun, de manière à lier tous les membres à une identité
commune et au sens d’une destinée commune ».
L’apprentissage d’équipe (« team learning ») : « la discipline d’engager le dialogue, de
suspendre les préjugés et de s’engager dans un véritable processus de « brainstorming »,
de penser ensemble. » Cette discipline implique également de pouvoir reconnaître les
« patterns » d’interactions entre les membres d’une équipe qui menacent la capacité
d’apprendre.
La pensée systémique (« system thinking ») : « la discipline d’apprendre à contempler le
tout et pas seulement les parties individuelles de ce tout. » Il s’agit d’un cadre conceptuel,
un corps de connaissance et d’instruments développés depuis 50 ans facilitant l’analyse de
« patterns » et la compréhension de comment agir pour les changer. C’est la colle qui lient
entre elles les autres disciplines. Les 10 lois de la pensée systémique sont les suivantes :
1. Today’s problems come from yesterday’s solutions
2. The harder you push, the harder the system pushes back
3. Behaviour grows better before it grows worse
4. The easy way out usually leads back in
5. The cure can be worse than the disease
6. Faster is slower
7. Cause and effect are not closely related in time and space
8. Small changes can produce big results – but the areas of highest leverage are often the
least obvious
9. You can have your cake and eat it too – but not at once
10. Dividing an elephant in half does not produce two small elephants, it produces a mess
Comme le dit clairement Senge, les instruments et idées présentées dans sont livre ont pour
but de détruire l’illusion que le monde est crée de forces séparées, non-reliées entre elles.
Senge ne manque pas d’ambitions : citant Archimède, il pense qu’ils doivent contribuer à
procurer un « levier suffisamment long pour pouvoir faire basculer le monde d’une seule
main » et ce en provoquant une « metanoia », « a shift of mind » permettant aux organisations
de devenir apprenantes.

Senge ne s’arrête d’ailleurs pas aux organisations : ils considère que la pensée systémique
peut aider non seulement le développement des organisation mais aussi de l’intelligence
humaine, de l’humanité dans son ensemble.
Pour comprendre cela, sans développer ici toutes les idées du livre de Senge, il suffit d’attirer
l’attention sur le fait que la pensée systémique enseigne qu’il y a deux types de complexité : la
complexité détaillant les interactions entre de nombreuses variables (« detail complexity ») et
la complexité dynamique (« dynamic complexity ») qui montre que les causes et les effets ne
sont pas souvent proches dans le temps et dans l’espace et que des interventions qui
pourraient paraître directes ne produisent pas nécessairement les effets escomptés.
Ainsi, comme l’écrit Senge : « Today the primary threats to our collective survival are slow,
gradual developments arising from processes that are complex both in details and in
dynamics. The spread of nuclear arms is not an event, nor is the “greenhouse effect”,
malnutrition and underdevelopment in the Third World, the economic cycles that determine
our quality of life, and most of the other large-scale problems in our world. »
Tout ce qu’écrit Senge me paraît faire sens, du moins au niveau de « notre » monde et de nos
organisations, et mon propos ne sera pas de le contredire. Plutôt j’essayerai de montrer, en le
contrastant avec Conche, que la pensée de Senge est elle-même prisonnière d’une vision
implicite « réductrice » du « monde » et que cela a des conséquences implicites sur les
attentes qu’il a de pouvoir contribuer à changer le « monde ».
Le problème est bien entendu que, comme il s’agit d’un livre de management et pas de
philosophie, Senge n’explicite pas ou trop peu les fondements de sa vision du « monde » et de
sa pensée systémique. Il écrit pourtant tout à la fin de son livre quelques phrases qui
permettent d’entrevoir ces fondements : “The earth is an indivisible whole, just as each of us
is an indivisible whole. Nature (and that include us) is not made up of parts within wholes. It
is made up of wholes within wholes. All boundaries, national boundaries included, are
fundamentally arbitrary. We invent them and then, ironically, we find ourselves trapped in
within them.” Et il continue en mentionnant “Gaia”, la théorie selon laquelle la biosphere, tout
ce qui vit sur la terre, est en soi un grand organisme vivant. Le « réel » auquel Senge fait
implicitement référence est donc celui de notre monde, de la biosphère.
Par ailleurs, en ce qui concerne la capacité d’agir, sa référence au long levier d’Archimède
pour faire basculer le monde est suffisamment explicite. Tout son livre est un plaidoyer pour
nous faire comprendre qu’une autre façon de penser doit nous permettre de mieux agir sur le
monde.
Enfin, on peut se poser la question des fins de ces actions ? Senge ne les explicites pas, se
limitant à parler de manière générique des aspirations des organisations apprenantes, qui, au
travers d’une vision partagée, doit être compatibles avec les aspirations de tous les membres
de ces organisations. On peut supposer qu’au delà du profit, les organisations apprenantes
recherchent donc le « bonheur ».
Avant de passer à Conche, notons que la pensée systémique de Senge fait écho aux
discussions que nous avons eues avec nos précédents orateurs et qu’elle n’est pas contraire à
celles-ci.

Ainsi, la pensée systémique fait partie de l’approche du monde par modèles que nous a
présenté Bernard Walliser. On peut dire également que la pensée systémique est proche de
Russel évoqué par Luc de Brabandère qui nous a dit : « Jusqu'à Russel, en Occident, on était
dans le paradigme du connecteur logique "ou". Aujourd'hui, on serait plutôt dans la logique
du "et" quitte à mettre ensemble des contraires. » Luc nous a dit également des choses très
proches de Senge lorsqu’il nous a dit : « Tout d'abord, on a le sentiment que, dans le monde,
les choses sont plus complexes qu'avant (pensez au clonage, à Internet, etc.). Mais la
complexité se retrouve aussi dans la manière dont nous percevons les choses. »
Les thèmes abordés par Besnier et par Arnsperger sont eux aussi proches de ceux abordés par
Senge :
« La rationalité analytique héritée de Descartes émet l'idée que toute réalité est décomposable
en éléments ultimes. Or, pour la théorie sur le complexe, les phénomènes sont globaux. En ce
sens, le tout est supérieur à la somme des parties. La conséquence en est qu'il n'y a pas
d'élément fondateur : on est toujours confronté à des phénomènes indécomposables. »
(Besnier)
« Qu'est-ce être libre dans un système complexe ? Mon exposé se centrera sur la notion de
système tel qu'il a été étudié et hérité dans la philosophie ; je verrai aussi la question de la
liberté et nous comprendrons qu'il existe différents types d'exercice de la liberté dans le
système. » (Arnsperger)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%