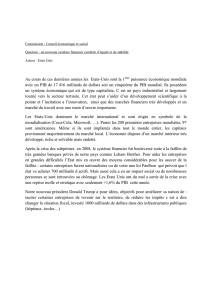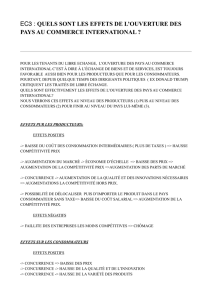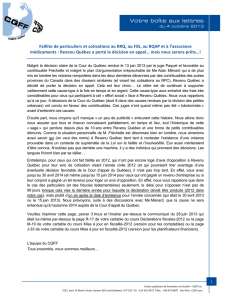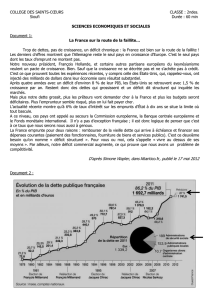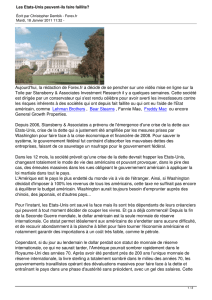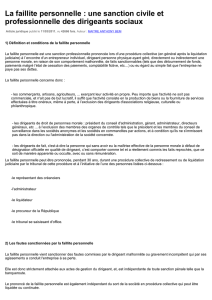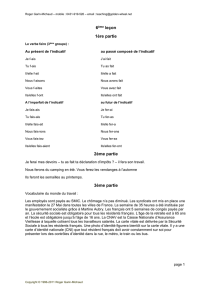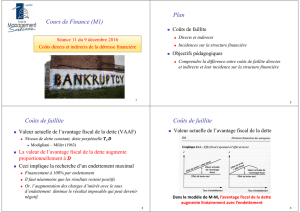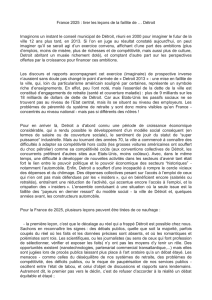Les changements de structures juridiques et

Les changements de structures juridiques et financières affectent-elles la santé des
entreprises ?
Par
Essaid Tarbalouti
GREER, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Caddi Ayyad, Marrakech

Les principales analyses de cette partie sont la raison du contrat d’entreprise et
les déterminants de sa disparition.
Coase [1937] rappelait qu’une entreprise tend à se développer lorsque les coûts
représentés par l’organisation et la coordination au sein de celle-ci sont inférieurs aux
coûts inhérents à l’exécution de la même transaction au moyen d’un échange sur le
marché ou aux coûts d’organisation au sein d’une autre entreprise. En revanche, lorsque
ces coûts sont supérieurs aux coûts du marché, l’entreprise n’a pas de raison de survivre.
Le chapitre 3 de cette partie est donc une analyse sur les raisons qui permettent
d’augmenter les gains et de réduire les coûts au sein de l’entreprise.
Ainsi, il est habituel de distinguer la spécialisation et l’économie d’échelle
comme deux caractéristiques essentielles dans l’augmentation des gains. Toutefois, ces
éléments ne sont pas sans coûts. Ceux-ci peuvent excéder les coûts du marché entraînant
ainsi la faillite de l’entreprise.
Les causes de l’augmentation de ces coûts (ce que nous verrons dans le chapitre
4), au terme de la loi de faillite sont d’ordre financier. Ainsi, une procédure collective
doit être ouverte à partir du moment où l’entreprise n’est plus en mesure de faire face à
son passif exigible avec son actif disponible. Par conséquent, si l’entreprise pouvait
avoir accès à des ressources financières suffisantes pour faire face à ses échéances, elle
ne serait pas en situation de faillite.
Toutefois, les difficultés financières ou plutôt l’augmentation des coûts au sein
de l’entreprise peuvent résulter de facteurs d’origines macro-économiques et micro-
économiques.

Introduction
L’entreprise vit et meurt. Sa constitution comme sa disparition nécessite la
compréhension de sa nature. En effet, pendant longtemps l’entreprise était qualifiée de
«boîte noire». Les décisions prises en son sein étaient considérées comme prises par un
sujet unique ou un groupe unanime
226
. Depuis l’article célèbre de Coase, «The Nature of
the Firm», Coase [1937]) et à la suite des travaux d’Alchian et Demsetz [1972], on s’est
rendu compte de l’intérêt à traiter l’entreprise comme un contrat qui a pour but de faire
respecter les clauses contractuelles afin de procéder à une allocation des ressources et à
une coordination des décisions individuelles plus efficaces
227
.
Les économistes, Meckling et Jensen [1976] considèrent que ce contrat est un
lieu de coordination, de spécialisation des tâches. Il est également un lieu de séparation
de la propriété et du contrôle
228
, où les dirigeants non propriétaires exercent un pouvoir
de décision économique par délégation des propriétaires dont le but de maximiser les
gains à l’échange.
Cette coordination peut confronter des intérêts divergents qui ne vont pas
toujours agir au mieux des intérêts de l’entreprise. Ainsi, par exemple, lorsque les
dirigeants et les actionnaires sont des maximisateurs rationnels d’utilité, les dirigeants
ne vont pas agir dans l’intérêt de leurs mandants. Ceux-ci peuvent limiter les
divergences par rapport à leurs intérêts en investissant dans des coûts de prospection et
des coûts de contrôle des comportements des dirigeants (appelé coûts d’agence). Cet
investissement peut être coûteux.
Lorsque les gains de cette interaction sont supérieurs aux gains produits
séparément et aux coûts d’agence, ils continuent cette coopération. En revanche, lorsque
les gains résultant de cette interaction sont inférieurs aux coûts d’agence, les membres
de l’entreprise peuvent déclencher la dissolution de l’entreprise ou sa faillite.
Les gains au sein de l’entreprise peuvent provenir de la spécialisation des
activités, du rôle que joue la séparation de la propriété dans le contrôle de l’entreprise et
226
ALCHIAN A. A. et WOODWARD S. [1988], «The Firm Is Dead ; Long Live the Firm. A Review of
Oliver E. Williamson's The Economic Institutions of Capitalism», Journal of Economic Literature, vol.
26, n°1, Mars, pp 65-81 ; voir également COBBAUT R. [1994], «Théorie Financière», 3è Ed.,
Economica, pp 310.
227
COASE R. [1937], «The nature of the firm», Economica ; ALCHIAN A. A. et DEMSETZ H. [1972],
«Production, Information Costs, and Economic Organization», The American Economic Review, vol. 62,
pp 777-795 ; à cette conception s’oppose l’approche qui considère l’entreprise plus comme une institution
qu’un contrat. Voir GUYON Y. [1992], «Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés», 7è
Edition, Economica, tome 1, pp 91.
228
La relation contractuelle dans laquelle une ou plusieurs personnes (les mandants) engagent une ou
plusieurs autres personnes (les mandataires) en vue de bénéficier pour leur compte d’une ou plusieurs
activités, dont l’exercice implique nécessairement qu’on leur délègue un pouvoir de décision. JENSEN
M. C. et MECKLING W. [1976], «Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and
Ownership Structure», Journal of Financial Economics, vol. 3, pp 305-360. Pour une revue de littérature
des différentes définitions d’entreprise, le lecteur peut se référer au livre de TIROLE J. [1993], «Théorie
de l’organisation industrielle», Tome I, Ed. Economica, pp. 31-123.

de l’affectation des ressources
229
. Simultanément, cette multiplicité des fonctions au
sein de l’entreprise engendre des coûts d’agence. Ces coûts peuvent provenir de
l’organisation et de la coordination de l’activité au sein de l’entreprise. Ces coûts
peuvent excéder les gains engendrant ainsi la disparition de l’entreprise.
Une interrogation se pose ainsi : comment le droit de faillite peut-il les réduire ?
Avant d’y répondre, nous pensons qu’il est judicieux de comprendre l’intérêt de
constituer une entreprise et comment la divergence d’intérêts entraîne des coûts
d’agence. Nous montrons ensuite comment le droit de faillite qui est propre au contrat
de l’entreprise peut réduire ces coûts.
Ainsi, l’article sera organisé de la manière suivante : la première section sera
consacrée à l’analyse du rôle des gains et des coûts de la spécialisation, de la
complémentarité dans la constitution de l’entreprise et de sa disparition. La deuxième
section s’intéresse au rôle de l’introduction de la dette dans la structure du capital dans
la réduction des coûts d’agence qui résultent de l’organisation de la production au sein
de l’entreprise et les coûts qu’elle génère. Enfin, la troisième section traitera le rôle du
droit de la faillite dans la réduction de ces coûts.
SECTION 1 - LE CONTRAT D’ENTREPRISE
Les raisons qui incitent les parties à constituer un contrat d’entreprise sont
multiples : les économies d’échelle ou d’envergure, la complémentarité des
compétences et la spécialisation des tâches. Toutes ces raisons peuvent inciter les
individus à coopérer afin d’économiser les coûts qu’ils auraient supportés s’ils avaient
décidé de créer une entreprise individuelle (§1). Toutefois, si les conséquences de ces
raisons sont bénéfiques pour la constitution de l’entreprise, elles engendrent des coûts
liés à la divergence d’intérêts et qui peuvent être réduits par le recours au droit de la
faillite (§2).
§1 - Economies d’échelle, spécialisation et complémentarité
Dans leurs travaux sur la nature de l’entreprise, Alchian et Demsetz [1972]
définissent l’entreprise comme une équipe composée de plusieurs individus de
compétences variées. Sa constitution est fondée sur les gains de la production en
équipe
230
.
229
POSNER R. A. [1986], assimile la dette à la responsabilité limitée. Il considère que la dette constitue
un composant primordial de l’entreprise sinon la responsabilité limitée n’aurait aucun intérêt.
230
ALCHIAN A. et DEMSETZ H. [1972], «Production, Information Costs and Economic Organization»,
The American Economic Review, vol. 62, pp 777 à 779 (777-795) ; voir également LEHN K. [1982],
«Property Rights, Risk Sharing, and Player Disability in Major League Baseball», The Journal of Law
and Economics, vol. 25, Octobre, pp 343-344 (343-366) ; DE ALESSI L. [1983], «Property Rights,
Transaction Costs, and X-Efficiency : An Essay in Economic Theory», The American Economic Review,
vol. 73, n° 1, pp 64-65 (64-79), sur le rôle des coûts de transaction et des droits de propriété sur la
maximisation de la richesse.

En ce sens, l’entreprise est constituée lorsque les gains au sein de cette entité
sont supérieurs aux gains de la production individuelle. Ces gains sont le produit de la
division de travail et de la complémentarité des facteurs de production
231
.
La division du travail constitue un moyen qui permet de produire plus en équipe
ou dans une entreprise qu’individuellement. L’entreprise est souvent conditionnée par la
spécialisation des tâches. L’individu se spécialise dans une fonction de production
lorsqu’il a un avantage comparatif, c’est-à-dire lorsque le prix du produit sur le marché
est supérieur au coût d’opportunité
232
.
D’une manière générale, lorsque l’ensemble des individus au sein de l’entreprise
ont chacun un avantage comparatif absolu dans une fonction précise de production de
l’entreprise, celle-ci a de forte chance d’avoir des possibilités de production supérieures
à la production du même produit par un individu non spécialisé. Pour illustrer cette
analyse, supposons que si un patron spécialiste dans la commercialisation du produit
consacre tout son temps à la gestion administrative, alors qu’il devrait se consacrer à la
commercialisation du produit en raison de son avantage comparatif, la perte est telle que
l’entreprise vend moins de produits et fournit moins d’efficacité dans la gestion
administrative.
Toutefois, si la spécialisation constitue un élément déterminant dans la
constitution de l’entreprise, la complémentarité des facteurs de production et le savoir
spécifique de l’entreprise paraissent également un élément explicatif de la constitution
de l’entreprise. En effet, la complémentarité des facteurs de production est réalisée
lorsque les gains de ces facteurs de production au sein de l’entreprise sont supérieurs
aux gains de ces mêmes facteurs pris séparément. Cette complémentarité dépend des
facteurs de production et du résultat de la coopération.
Toutefois, si la coordination entre l’ensemble des facteurs de production permet
de produire plus que la production séparée de ceux-ci, l’équipe sera la forme
d’entreprise qui permettra de profiter des gains de la complémentarité.
A long terme et avec la combinaison de ces facteurs de production, l’entreprise
observe un rendement croissant au cours du temps et trouve peu à peu des tâches qui
leur conviennent le mieux. Cette spécialisation crée un savoir faire spécifique à
l’entreprise et augmente sa valeur
233
.
Ainsi, si les gains de la spécialisation et de la complémentarité constituent un
mécanisme incitatif pour un ensemble d’individus à constituer une entreprise, les coûts
d’organisation, d’opportunisme et d’entente paraissent être un obstacle qui peut peser
lourdement sur la création de l’entreprise ou sa continuation
234
.
231
JENSEN M. C. et FAMA E. F. [1983], «Agency Problems And Residual Claims», The Journal of Law
and Economics, vol. 26, Juin, pp 345 (327-349) ; KLEIN P. G. [1996], «Economic calculation and the
limits of organisation», The Review of Austrian Economics, vol. 9, n°2, pp 3-28
232
FAMA E. F. [1980], «Agency Problems And The Theory of The Firm», The Journal of Political
Economy, vol. 88, n°2, pp 290 à 292 (288-307).
233
PRESCOTT et VISSCHER [1980], «Organization Capital», The Journal of Political Economy, 88, pp
446-461.
234
WILLIAMSON O. E. [1984], «Corporate Governance», The Yale Law Journal, vol. 93, pp 1200 à
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%