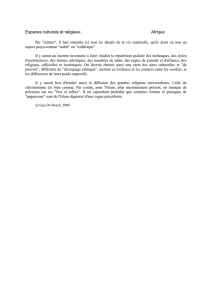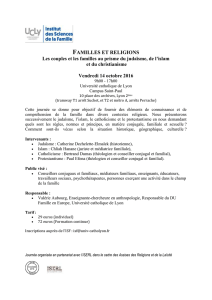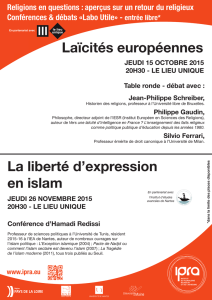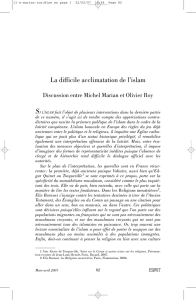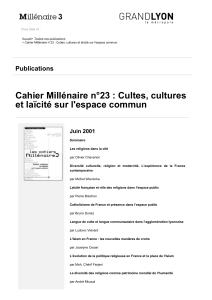les monothéismes

Mini-atlas des religions du monde – section 1 : les religions monothéistes : le catholicisme – page 1 sur 20
LE
CATHOLICISME
Il touche 600 millions d'êtres humains et se rattache à
l'ensemble des religions bibliques ; il s'est longtemps
confondu avec le christianisme jusqu'au schisme avec
l’orthodoxie, puis le protestantisme (cf. articles
Orthodoxie et Protestantisme ).
L'Eglise Catholique est l'assemblée des hommes liés
entre eux par une même foi en la divinité de Jésus
Christ et qui reconnaissent l'autorité de l'Eglise
fondée par lui - avec à sa tête, le Pape (successeur de
Saint-Pierre, élu par le Sacré Collège ) qui lui-même,
nomme les évêques.
Date d’apparition et fondation :
Il est apparu avec le prophète Jésus-Christ. Celui-ci
est né au plus tard en 6-7 de notre ère ; baptisé par
Jean Baptiste après 30 ans de « vie obscure», il
commence à prêcher en Galilée. Sa prédication
d'abord itinérante puis au Temple de Jérusalem, irrite
les Pharisiens qui le soupçonnent de vouloir ruiner la
paix romaine. Trahi par l'un de ses disciples, Judas, il
est arrêté puis crucifié le vendredi, veille de la Pâque
Juive. Cinquante jours plus tard, les 12 apôtres
affirment que Jésus est ressuscité et qu'il leur est
apparu ; ils appellent les Juifs à reconnaître en lui le
Messie qu'Israël attendait et à se convertir à la
"Bonne Nouvelle" (=Evangile). C'est le début du
christianisme.
L'historicité de Jésus est attestée par Flavius Josèphe,
historien d’origine juive, et Pline l’ancien, sans
omettre Tacite ; c'est la vérité historique
contrairement aux Evangiles, vérité de foi.
Les livres saints et bases de la croyance :
La Bible (Ancien et Nouveau Testament ) constitue
les Saintes Ecritures ; l'Ancien Testament relate tous
les épisodes antérieurs de l’histoire juive à la
naissance de Jésus-Christ (il s’agit en fait de la Bible
juive intégrée par les chrétiens). L'Eglise insiste sur le
sens religieux de ses promesses : l'annonce du
Messie, salut de l'âme, pardon des péchés... Le
Nouveau testament est l'ensemble des textes sacrés
postérieurs à la venue de Jésus au monde et reconnus
par le droit canon ; il comprend les Quatre Evangiles
(Luc, Jean, Marc et Matthieu ), des épîtres (lettres
écrites par ses disciples dont les plus célèbres sont
Saint Paul et Saint Pierre), plus l'Apocalypse de
Saint Jean. Les autres textes sont dits apocryphes,
c’est-à-dire non reconnus comme sacrés.
L’Eglise Catholique (ce mot signifie « universelle »)
ajoute comme base à sa croyance l’ensemble des
écrits des «pères de l'Eglise » (Tertullien, Irénée,
Augustin…) sous le nom général de «Tradition ».
Elle lui accorde la même importance qu’à la Bible,
comme suite de la révélation divine.
Dogmes et éléments de doctrine :
Après Vatican II, l'Eglise est « le peuple de Dieu de
la nouvelle Alliance». Le Credo la définit comme un
objet de foi : elle est Une (un seul Dieu et Père),
Sainte (ses membres sont appelés à vivre dans la
Sainteté de Dieu), Catholique (à vocation universelle)
et Apostolique (enseignement des apôtres).
On distingue 7 sacrements, signes sacrés produisant
des effets de grâce surnaturels : baptême,
confirmation, eucharistie, pénitence, ordre, mariage,
extrême onction.
Les fêtes répartissent sur une année les événements
majeurs de la vie de Jésus, de Marie et des Saints : à
partir de l'Avent (fin novembre), début de l'année
liturgique, on pourra distinguer Noël, les 40 jours de
Carême, la Semaine Sainte (passion du Christ ),
Pâques (résurrection du Christ ), l'Ascension (du
Christ vers le ciel ), la Pentecôte (descente de l'Esprit
Saint sur les apôtres ), l'Assomption (mort de Marie).
L’influence culturelle :
Les influences culturelles du catholicisme sont
énormes : sur l'enseignement (jusqu’à la séparation
des Eglises et de l'Etat, en 1905, en France ), sur la
littérature (importance des moines scripteurs au
Moyen Age ; théologiens - Saint Thomas d'Aquin,

Mini-atlas des religions du monde – section 1 : les religions monothéistes : le catholicisme – page 2 sur 20
Saint Augustin, sans compter les ouvrages exaltant
les vertus chrétiennes : Polyeucte de Corneille ou Le
Génie du Christianisme de Châteaubriand ; sur
l'architecture (la basilique Saint-Pierre par le Bernin,
les nombreuses églises et cathédrales ), la peinture
(l’adoration des Mages de Mantegna, de
Rembrandt...), la musique (messes, requiem).
Lieux saints :
On distingue deux types de lieux saints :
- ceux de la Palestine, avec Jérusalem (Temple,
Jardin des Oliviers...), Bethléem …
- ceux liés à l’histoire de l’Eglise et de ses Saints,
comme Lourdes, Cestochowa, Saint-Jacques de
Compostelle, Lisieux...
Dans tous les cas les formes du pèlerinage massif et
des processions sont les plus courantes.
Aire d’extension :
Le catholicisme, s'il s'est développé originellement en
Palestine, puis dans le Bassin Méditerranéen, s'est
rapidement donné comme tâche d'évangéliser le
monde grâce aux croisades, aux grandes découvertes
et à la colonisation avec les ordres missionnaires.
De nos jours, le catholicisme, s'il est très présent en
Europe, connaît une expansion considérable dans les
pays du sud : à titre d'exemple, le nombre de
cardinaux formés par l'Italie, les Etats-Unis, la
France, l'Espagne et l'Allemagne ne s'élève qu'à 68
(sur 155 cardinaux au total ).
Il connaît un renouveau avec la fin du communisme
mais la diversité de la pratique religieuse et les
tensions dues à la laïcisation sont fortes (Pologne).
Lieux de conflit :
Deux types de conflits peuvent opposer les
catholiques à d’autres religions ou groupes :
D’une part dans des affrontements sous-tendus par
des problèmes politiques : c'est le cas de l’Irlande du
Nord ou du Liban ;
D'autre part, des franges fondamentalistes
réactionnaires et/ou intégristes menacent la paix dans
le monde par les guerres ou des affrontements à base
religieuse, souvent inséparables d'ailleurs de l'identité
ethnique ou nationale (Azerbaïdjan, Inde du sud,
Soudan, ex-Yougoslavie, Afrique sahélienne).
Auteurs : Rémi Bourdot – Cécile Penot – remis en
forme et complété par JMD –
Eléments de références complémentaires :
Lectures
Collection «que sais-je ? » :
De très nombreux titres de cette collection traitent
d’aspects liés au catholicisme, la consultation du
catalogue s’avérera utile. Nous extrayons les
suivants :
- Le Nouveau testament – J. Grosjean – n° 1231
- Histoire du catholicisme : - J.B Duroselle &
J.M Mayeur – n° 365
- La foi catholique – P. Poupard – n° 2050
- La théologie catholique – C. Wackenheim –
n°1269
Les collections «maîtres spirituels » et «spiritualité »
aux éditions du Seuil sont également très fournies
pour le champ du catholicisme :
- Saint Thomas d’Aquin et la théologie – M.D
Chenu – n° 17
- Saint François d’Assise et l’esprit franciscain
– I. Gobry – n° 10
- Saint Ignace de Loyola et la Compagnie de
Jésus – A. Guillermou – n°23
Existent également des ouvrages sur Saint Bernard,
Saint Benoît, Saint Jean de la Croix…
Un ouvrage de référence :
Nouvelle encyclopédie catholique (1235p.)– groupe
THEO - Droguet et Ardant – 1989 –
Littérature
De très nombreux écrivains ont mis en œuvre des
religieux, des communautés ou posé des problèmes
dans l’optique catholique. Il est impossible de les
citer tous. Nous proposons, comme initiation, les
quelques auteurs et titres suivants :
François Mauriac décrit à travers les situations
romanesques les tensions intérieures et le combat
contre le mal : « Thérèse Desqueyroux », «le
sagouin » sont les œuvres les plus abordables. Lire
aussi les carnets et écrits journalistiques qui attestent

Mini-atlas des religions du monde – section 1 : les religions monothéistes : le catholicisme – page 3 sur 20
des combats de l’homme en tant que chrétien
catholique.
Georges Bernanos fut aussi un grand écrivain
catholique. Ses œuvres sont publiés en collection de
poche.
Françoise Dolto a écrit un ouvrage intéressant sur
«L’évangile au risque de la psychanalyse ».
Le romancier Gilbert Cesbron se situait aussi dans
une optique catholique militante : « Il est minuit
Docteur Schweitzer », «chiens perdus sans
colliers » «c’est Mozart qu’on assassine »…
Paul Claudel et Charles Péguy offrent de brillants
exemples de poésie et de théâtre catholiques.
Musique :
La musique sacrée est d’une richesse presque infinie,
compte tenu du temps long dans lequel elle s’inscrit.
Elle se trouve symbolisée par quelques genres
d’œuvres remarquables appuyées sur le culte ou la
liturgie catholique : les Requiem, la Messe, certains
offices particuliers (Vêpres, baptêmes…). Plutôt que
de donner des références précises forcément
subjectives et incomplètes, nous conseillons certains
compositeurs réputés pour la qualité de leurs
compositions sacrées : Mozart, Beethoven, Bach,
Dvorak, Franck, Messiaen, Vivaldi… On y trouve
tous les genres d’œuvres citées précédemment. Ces
œuvres sont aujourd’hui accessibles dans des
collections économiques de bonne qualité à des prix
défiant toute concurrence.
Art :
Comme pour la musique, il est impossible de citer les
œuvres d’art nées du catholicisme. Les plus beaux
musées originels et gratuits sont les nombreuses
cathédrales et églises de notre pays. Ainsi la Guyenne
comporte un nombre important d'églises romanes de
très grande valeur artistique. Des guides régionaux
sont édités régulièrement. L’art gothique et l’art
baroque nous ont laissé également de magnifiques
lieux de culte, un peu partout en France. L’Italie est
un véritable conservatoire de l’art catholique, à
travers des villes comme Rome, Florence ou Milan,
sans oublier Assise. La peinture a été marquée de
manière indélébile par cette origine religieuse, de
Giotto ou Fra Angelico à la peinture la plus
contemporaine. Des livres d’art abordables se
trouvent aujourd’hui édités sur ce thème. La sculpture
et la statuaire sont des formes majeures de l’art
catholique, ne serait-ce que par la place qu’elles
occupent dans les églises. L’art a toujours été un
moyen majeur de conforter ou d’entretenir la foi des
fidèles.
La pensée :
Nous nous devons de citer l’importance de la pensée
catholique dans le monde intellectuel. La philosophie
occidentale doit tout à la foi catholique, y compris ses
plus belles controverses. Des religieux célèbres furent
d’immenses philosophes, comme Saint Thomas
d’Aquin ou Saint Augustin. La religion occupa
l’espace de la pensée moderne jusqu’à la fin du XIX°
siècle. Si aujourd’hui le débat ne se polarise plus sur
ce terrain, il demeure une école de pensée catholique
de tout premier ordre, animée par des ordres comme
les Dominicains ou les Jésuites, relayée par des
revues comme «Etudes » ou «Esprit ». Toujours
intéressante à connaître, cette pensée est loin des
caricatures qu’en donnent les médias, comme la
pensée musulmane ou juive d’ailleurs, qui sont
traitées de la même manière caricaturale.[compléments
JMD]
LE PROTESTANTISME

Mini-atlas des religions du monde – section 1 : les religions monothéistes – l’Islam –
4
Dates d’apparition :
XVI° siècle
Les 95 thèses de Luther sont affichées à la porte de
l’église du château de Wittenberg le 31 Octobre
1517.
Fondateurs :
- Martin LUTHER (1483-1546), né à
Eisleben en Allemagne ; ordonné prêtre, il enseigne
l’Ecriture Sainte à l’université de Wittenberg. Il
rédige 95 thèses contre la pratique des indulgences
(=pardon et rémission par l’Eglise d’une peine que
les péchés méritent). A voulu réformer l’Eglise de
l’intérieur, sans la quitter. Est excommunié et mis
au ban de l’Empire.
- Ulrich ZWINGLI (1484-1531). Même
mouvement en Suisse allemande.
- Jean CALVIN (France 1509- Genève
1564). Sa pensée et son action rayonnent si
largement que Genève devient la capitale spirituelle
du protestantisme d’expression française.
N.B. : * Sont appelées ‘luthériennes’ les Eglises
protestantes issues de la réforme de Luther, et
‘réformées’ celles qui se réclament de l’héritage de
Calvin et de Zwingli.
* L’anglicanisme représente une voie
intermédiaire entre catholicisme et protestantisme.
Il est né en 1534 avec Henri VIII en Angleterre.
Bases de la croyance :
La Bible (Ecriture Sainte), comprenant l’Evangile
(« bonne nouvelle », en grec). Elle est formée de
l’Ancien Testament (bible juive) et du Nouveau
Testament
Points principaux de la doctrine :
- un triple refus par rapport au catholicisme :
un homme (le pape), une femme (Marie), une
chose (la messe) ;
- trois grands principes : Sola Scriptura ;
Sola Gratia et Sola Fide ; Testimonium Spiritu
Sancti.
- un esprit et des structures
démocratiques ; liberté de recherche ; simplicité.
Vocabulaire spécifique :
- temple : édifice dans lequel les protestants
célèbrent leur culte.
- culte : office religieux, composé de
prières, de chants, de commentaires de la Bible,
etc...
- pasteur : ministre du culte protestant.
- prédication : discours où le pasteur
commente un texte biblique pendant le culte. Acte
central du culte protestant, la prédication est
proclamation et actualisation de la Parole de Dieu.
- cène : dernier repas de Jésus pris avec ses
disciples avant sa mort. Les chrétiens célèbrent cet
événement dont Jésus demanda la répétition (Luc
22,19 ; première lettre aux Corinthiens 11, 24-25).
Ce rite (appelé cène, communion ou eucharistie) a
lieu au cours du culte. La cène est un sacrement,
qui n’est pas nécessairement célébré au cours de
chaque culte protestant, contrairement à la messe
catholique dont il constitue le centre et le sommet.
- sacrement : le protestantisme n’en
reconnaît que 2 : le baptême et la cène. (le
catholicisme en reconnaît 7 : le baptême,
l’eucharistie, l’ordination, la confirmation,
l’extrême onction, la pénitence et le mariage)
- confirmation : cérémonie où les adultes
confirment le baptême qu’ils ont reçu enfants. Elle
est un sacrement chez les catholiques et non chez
les protestants qui ne lui trouvent pas de clair
fondement biblique.
- synode : assemblée de fidèles et de
pasteurs délégués par leur Eglise. Le synode
désigne le véritable gouvernement des Eglises et le
pouvoir chez les protestants.
Fêtes remarquables :
Rameaux : entrée de Jésus dans Jérusalem
(dimanche qui précède Pâques).
Pâques : résurrection de Jésus (date variable, en
fonction des lunaisons).
Ascension (40 jours après Pâques).
Pentecôte (fête très importante chez les
protestants) : l’Esprit Saint parmi les apôtres, qui
« parlent
en langues » (phénomène dit de
« glossolalie » et marque le début de
l’évangélisation. (50 jours après Pâques).
Noël : naissance du Christ.(25 Décembre).
+ Fête de la Réformation, le dernier
dimanche d’Octobre.
TROIS DEFINITIONS ESSENTIELLES

Mini-atlas des religions du monde – section 1 : les religions monothéistes – l’Islam –
5
Première définition : un triple refus par rapport
au catholicisme romain.
Dans la mesure où le protestantisme se
différencie principalement du catholicisme romain,
il est tout à fait possible, pour le définir, de se
référer à ce qui constitue les points marquants
d’une opposition séculaire et fondamentale. La
séparation du catholicisme romain d’avec les
protestants date du XVI° siècle : les Réformateurs,
désireux alors de corriger les erreurs et les abus de
leur Eglise du dedans, c’est-à-dire sans avoir à la
quitter ou à en fonder une autre, ont été rejetés de
l’Eglise romaine et condamnés.
Un triple refus caractérise le désaccord
entre les protestants et Rome. Ce triple refus peut
être exprimé dans une formule lapidaire : un
homme, une femme, une chose ; à savoir : le
pape, Marie, la messe, trois données essentielles
qui caractérisent le catholicisme romain et sont
étrangères au protestantisme. Ce dernier, dans son
ensemble, quelles que soient ses composantes et
familles spirituelles, se reconnaît dans ce triple
refus.
1- Un homme, le pape.
Dans cette définition, le pape prend une valeur
proprement symbolique : les protestants peuvent
avoir pour tel ou tel pape un réel respect, mais la
fonction, l’institution pontificale, n’en restent pas
moins l’expression de tout un ensemble qui
demeure étranger au protestantisme. Le pape est
l’image d’un système d’autorité, d’une hiérarchie,
d’une institution pyramidale, d’un pouvoir, que le
protestantisme récuse parce qu’il n’en trouve pas le
fondement et la justification dans la Bible. Dire le
pape, c’est donc dire aussi les cardinaux, les
archevêques, les évêques, les curés, les abbés, etc.
2- Une femme, Marie.
Les protestants ont pour Marie, mère de Jésus, tout
le respect qu’on doit porter à la mère du Seigneur.
Ce que la Réforme a rejeté, c’est le culte marial.
Dieu seul est Dieu, et le culte, l’adoration, ne
sauraient s’adresser à Marie élevée au rang de
véritable déesse. Là encore, Marie est le signe d’un
problème plus vaste ; le protestantisme, en effet, a
d’emblée refusé aussi tout ce qui, de près ou de
loin, pouvait s’identifier au culte des saints et à la
vénération des reliques. Le culte marial et celui
des saints contredisent, trahissent et dénaturent
profondément le strict monothéisme Soli Deo
gloria ! (A Dieu seul la gloire !), telle peut être, à la
suite de Calvin, la devise de tous les protestants.
3- Une chose, la messe.
L’opposition entre catholiques romains et
protestants au sujet de la messe ne vient pas,
comme on le croit le plus souvent, du refus de la
Réforme de souscrire à la doctrine dite de la
présence réelle dans le sacrement de la Cène,
doctrine selon laquelle le corps et le sang de Jésus
sont réellement présents dans le pain et le vin de
la Cène. Luther, Zwingli et Calvin ont élaboré sur
le sujet des doctrines très différentes. Là n’est donc
pas le débat premier et fondamental.
Ce que le protestantisme unanime récuse, et
a toujours récusé, c’est l’idée du sacrifice de la
messe : le prêtre ordonné peut transformer le pain et
le vin de la Cène en vrai corps et en vrai sang de
Jésus-Christ. Il le peut par le pouvoir extraordinaire
que lui donne son ordination.
Fidèle au témoignage biblique, le
protestantisme n’admet qu’un seul sacrifice, qui
a eu lieu une fois pour toutes, et qu’il n’est au
pouvoir de personne de reproduire.
Conclusion :
Un homme (le pape), une femme (Marie),
une chose (le sacrifice de la messe) : ces trois
données nous renvoient au coeur d’une opposition
où il est permis de trouver, de manière évidente,
trois caractères propres du catholicisme romain.
Cependant, une telle définition comporte une
faiblesse : on voit bien ce que le protestantisme
rejette et nie, mais on ne voit pas, en revanche, ce
qu’il affirme. Il est, par conséquent, important de
recourir aussi à un autre type de définition.
Deuxième définition : trois grands principes.
Il est possible de définir le protestantisme par 3
grands principes fondamentaux. Les principes
du protestantisme ne définissent pas sa doctrine,
mais plutôt un style et un état d’esprit.
1- Premier principe – Ecriture et
tradition : ‘Sola scriptura’ (L’Ecriture
seule).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%