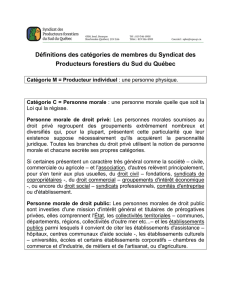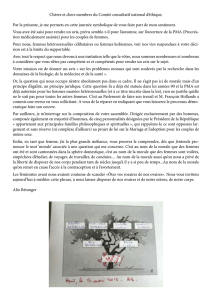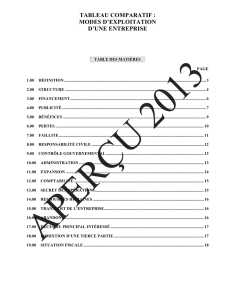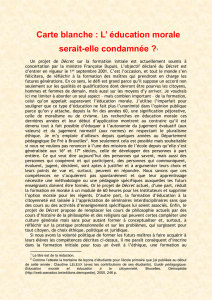La morale et la science des moeurs

Lucien Lévy-Bruhl (1903)
LA MORALE
ET LA SCIENCE
DES MŒURS
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociolog[email protected]
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm

Lucien Lévy-Bruhl (1903), La morale et la science des mœurs. 2
Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi à partir de :
Lucien Lévy-Bruhl (1903),
La morale et la science des mœurs.
Une édition électronique réalisée à partir de la 3e édition du livre de
Lucien Lévy-Bruhl publiée en 1927.
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word
2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Édition complétée le 22 février 2002 à Chicoutimi, Québec.

Lucien Lévy-Bruhl (1903), La morale et la science des mœurs. 3
Table des matières
PRÉFACE DE LA TROISIÈME ÉDITION (1927)
CHAPITRE PREMIER. - Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de morale théorique
I. Conditions générales de la distinction du point de vue théorique et du point de vue
pratique. - Cette distinction se fait d'autant plus tardivement et difficilement que les
questions considérées touchent davantage nos sentiments, nos croyances et nos intérêts.
- Exemples pris des sciences de la nature et en particulier des sciences médicales
Il. Application au cas de la morale. - Sens particulier que les philosophes ont donné ici
aux mots de « théorie » et de « pratique ». - La morale serait une science normative, ou
législatrice en tant que théorique. - Critique de cette idée. - En fait, les morales théori-
ques sont normatives, mais non pas théoriques
III. L'antithèse morale entre ce qui est et ce qui doit être. - Différents sens de « ce qui doit
être » dans les morales inductives et dans les morales intuitives. – Impossibilité d'une
morale déductive a priori. - Raisons sentimentales et forces sociales qui se sont oppo-
sées jusqu'à présent à des recherches proprement scientifiques sur les choses morales
IV. Idée d'une réalité morale qui serait objet de science comme la réalité physique. -
Analyse de l'idée positive de « nature ». - Comment les limites de la « nature » varient
en fonction des progrès du savoir scientifique. - Quand et sous quelles conditions un
ordre donné de faits devient partie de la « nature ». - Caractères propres de la réalité
morale
CHAPITRE Il. Que sont les morales théoriques actuellement existantes
I. Les doctrines morales divergent par leur partie théorique et s'accordent par les
préceptes pratiques qu'elles enseignent. - Explication de ce fait : les morales pratiques
ne peuvent pas s'écarter de la conscience morale commune de leur temps. - La pratique
ne se déduit donc pas ici de la théorie; mais la théorie, au contraire, est assujettie à
rationaliser la pratique existante
II. De là vient que : 1º la spéculation morale des philosophes a rarement inquiété la
conscience ; -2º il n'y a guère eu de conflits entre elle et les dogmes religieux ; - 3º elle
se donne pour entièrement satisfaisante et possède des solutions pour tous les
problèmes, ce qui n'est le cas d'aucune autre science. - En fait, c'est l'évolution de la
pratique qui fait apparaître peu à peu des éléments nouveaux dans la théorie
III. La pratique aurait ses principes propres indépendamment de la théorie. - Carnéade. - La
philosophie morale du christianisme. - Kant et la Critique de la Raison pratique. -
Effort pour établir la conformité de la raison et de la foi morale. - Causes de l'insuccès
de cet effort

Lucien Lévy-Bruhl (1903), La morale et la science des mœurs. 4
IV. Pourquoi les rapports rationnels de la théorie et de la pratique ne se sont pas encore
établis dans la morale. - Les autres sciences de la nature ont traversé elles aussi une
période analogue. - Comparaison de la « morale théorique » des Modernes avec la
physique des Anciens. - Tant que la méthode dialectique est employée, la « métamorale
» subsiste
CHAPITRE III. - Les postulats de la morale théorique
I. Premier postulat : la nature humaine est toujours identique à elle-même, en tout temps
et en tout lieu. - Ce postulat permet de spéculer abstraitement sur le concept de «
l'homme ». - Examen du contenu de ce concept dans la philosophie grecque, dans la
philosophie moderne et chrétienne. - Élargissement de l'idée concrète d'humanité au
XIXe siècle, dû au progrès des sciences historiques, anthropologiques, géographiques,
etc. - Insuffisance de la méthode d'analyse psychologique, nécessité de la méthode
sociologique pour l'étude de la réalité morale
II. Second postulat : le contenu de la conscience morale forme un ensemble harmonieux et
organique. - Critique de ce postulat. - Les conflits de devoirs. - L'évolution historique
du contenu de la conscience morale. - Stratifications irrégulières; obligations et
interdictions d'origine et de date diverses
III. Utilité des morales théoriques dans le passé, malgré l'inexactitude de leurs postulats. -
Fonction qu'elles ont remplie. - La morale antique plus libre et plus affranchie d'arrière-
pensées religieuses que les morales philosophiques des Modernes jusqu'au XIXe siècle.
- Ici la Renaissance n'a pas eu son plein effet. - Réaction à la fin du XVIIIe siècle. -
Succès apparent et impuissance finale de cette réaction
CHAPITRE IV. - De quelles sciences théoriques la pratique morale dépend-elle ?
I. L'objet de la science n'est pas de construire ou de déduire une morale, mais d'étudier la
réalité morale donnée. - Nous ne sommes pas réduits à constater simplement cet ordre
de faits ; nous pouvons y intervenir efficacement si nous en connaissons les lois
II. Trois acceptions distinctes du mot « morale ». Comment s'établiront les applications de
la science des mœurs à la pratique morale. - Difficulté d'anticiper sur les progrès et sur
les applications possibles de cette science. - Sa différenciation et ramification
progressives
III. On peut se représenter cette marche d'après l'évolution de la science de la nature
physique, plus avancée. - Causes qui ont arrêté le développement de cette science chez
les Anciens. - La physique d'Aristote se propose de « comprendre » plutôt que de «
connaître », et descend des problèmes les plus généraux aux questions particulières. -
Les « sciences morales » ont encore plus d'un caractère commun avec cette physique. -
Comment elles prennent une forme plus voisine de celle des sciences modernes de la
nature

Lucien Lévy-Bruhl (1903), La morale et la science des mœurs. 5
IV. Rôle considérable des mathématiques dans le développement des sciences de la nature.
- Jusqu'à quel point les sciences historiques peuvent jouer un rôle analogue dans le
développement des sciences de la réalité sociale
CHAPITRE V. - Réponse à quelques objections
I. Comment rester sans règles d'action, en attendant que la science soit faite ? – Réponse :
la conception même de la science des mœurs suppose des règles préexistantes
Il. N'est-ce pas détruire la conscience morale que de la présenter comme une réalité
relative ? - Réponse : ce n'est pas parce que nous le connaissons comme absolu que le
devoir nous apparaît comme impératif; c'est parce qu'il nous apparaît comme impératif
que nous le croyons absolu. -Si les philosophes ne font pas la morale, ils ne la défont
pas non plus. - Force du misonéisme moral. - L'autorité d'une règle morale est toujours
assurée, tant que cette règle existe réellement
III. Mais il y a pourtant des questions de conscience : au nom de quel principe les résoudre
? - Réponse : notre embarras est souvent la conséquence inévitable de l'évolution
relativement rapide de notre société, et du développement de l'esprit scientifique et
critique. - Se décider pour le parti qui, dans l'état actuel de nos connaissances, paraît le
plus raisonnable. - Se contenter de solutions approximatives et provisoires, à défaut
d'autres
IV. Qu'importe que l'autorité de la conscience morale subsiste en fait, si elle disparaît en
droit ? Que devient l'idéal moral ? - Réponse : analyse du concept d'idéal moral. - Part
de l'imagination, de la tradition et de l'observation de la réalité présente dans le contenu
de ce concept. - Rôle conservateur, au point de vue social, d'une certaine sorte d'idéalis-
me moral. - La recherche scientifique, héritière véritable de l'idéalisme philosophique
d'autrefois
CHAPITRE VI. - Antécédents historiques de la science des mœurs
I. État présent de la science des mœurs. - Principales influences qui tendent à maintenir
les anciennes « sciences morales » : traditions religieuses ; prédominance de la culture
littéraire. - Les moralistes ; caractères généraux de leurs descriptions et de leurs
analyses. - Plus près de l'artiste que du savant, préoccupés de peindre ou de corriger, ils
ont peu de goût pour la recherche spéculative
II. Les philologues et les linguistes, véritables précurseurs d'une science positive des
mœurs. - Leur méthode rigoureuse et scrupuleuse. - Rôle analogue des sciences écono-
miques et de la psychologie expérimentale. - Influence des théories transformistes. -
Rôle capital des sciences historiques. - Conflit apparent et connexion véritable de
l'esprit historique avec la méthode d'analyse génétique du XVIIIe siècle
III. Lenteur inévitable des changements de méthode. - Exemple pris de la physique du
XVIe siècle. - Causes qui retardent la transformation des « sciences morales ». - For-
mes de transition où les anciennes méthodes sont encore mêlées aux nouvelles. -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
1
/
206
100%