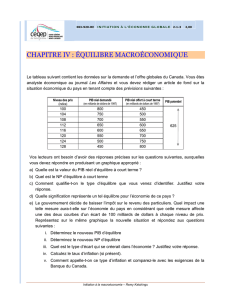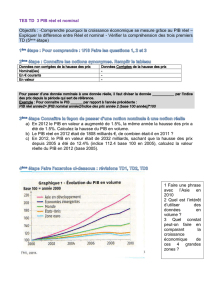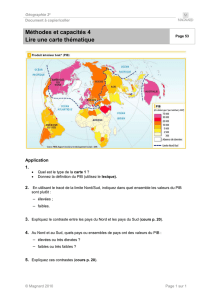BTS Droit 2e - Petit Fichier

21
Chapitre 2 – Comment se crée et se mesure la richesse ?
Corrigés
Page d’ouverture (p. 19)
1. Quels corps de métiers, quelles machines et quels matériaux peuvent être
nécessaires à la réalisation d’un programme immobilier comme celui-ci ?
Les corps de métiers intervenant sur un projet immobilier de cette ampleur sont nombreux
(liste non exhaustive) : architectes, maçons, plombiers, électriciens, grutiers, etc. Les
machines nécessaires sont, elles aussi, très variées : grues, bétonnières, camions,
bulldozers, etc. Enfin les matériaux employés sont très divers : béton, fers d’armature,
briques, tuiles, zinc, parquet, carrelage, etc.
2. La construction et la vente de ces appartements créera-t-elle une richesse
supplémentaire ? Pourquoi ?
Vraisemblablement oui, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils sont construits. En vendant les
appartements plus chers que les sommes nécessaires à leur construction, une richesse
supplémentaire est créée permettant de rémunérer les personnes qui ont travaillé sur le projet,
les apporteurs de capitaux, etc.
1. Le rôle du capital et du travail dans la création de richesse
Découvrir (p. 20)
1. L’activité d’un chirurgien est-elle de produire un bien ou un service ?
Un chirurgien produit un service de santé, sa profession ne consiste pas à fabriquer un bien.
2. Un chirurgien peut-il opérer tout seul ou faut-il d’autres personnes avec lui ?
Quelle que soit l’opération, un chirurgien est toujours assisté par d’autres personnes :
anesthésiste, infirmières, autres chirurgiens, etc.
3. De quel matériel a-t-il besoin pour opérer ?
Le matériel utilisé par un chirurgien est fonction de l’opération qu’il a à effectuer. On peut
citer : bistouris, échographe, clamps, caméra, etc.
Document 1 (p. 20)
4. De quoi a besoin cette entreprise pour aménager des espaces verts ?
Une entreprise comme Dufaÿ-Mandre a besoin, pour exercer son activité de pelleteuses, de
jardiniers, de tondeuses, de graines, d’arbres, de commerciaux, de secrétaires, d’engrais, de
terre végétale, de désherbant, de chef de travaux, des paysagistes, de grues, etc.
5. Classez ces facteurs de production en trois catégories : travail, capital, matières
premières.
Travail : jardiniers, commerciaux, secrétaires, chef de travaux, paysagistes…
Capital : pelleteuses, tondeuses, grues…
Matières premières : graines, arbres, engrais, terre végétale, désherbant…

22
Chapitre 2 – Comment se crée et se mesure la richesse ?
6. Pourquoi l’entreprise Dufaÿ-Mandre investit-elle régulièrement ?
Une entreprise comme Dufaÿ-Mandre doit régulièrement investir pour disposer en
permanence d’un matériel performant, fiable, moderne et en bon état de marche.
7. Donnez des exemples de chacun de ces facteurs de production pour une
entreprise de service comme un salon de coiffure.
Travail : coiffeurs, apprentis, secrétaire (pour un gros salon), visagistes, coloristes, etc.
Capital : ciseaux, sèche-cheveux, caisse, ordinateur…
Matières premières : shampoing, teinture, gel, laque…
Document 2 (p. 21)
8. Quel choix doit effectuer ce chef d’entreprise ?
Ce chef d’entreprise doit choisir entre deux techniques de production pour son entreprise pour
répondre à une nouvelle commande.
9. Qu’est-ce qui différencie les deux combinaisons productives envisagées ?
Ces deux techniques de production n’utilisent pas les mêmes quantités de capital et de travail
pour aboutir pourtant au même résultat. La première est très intensive en facteur travail
(beaucoup d’ouvriers et peu d’investissement en matériel). La deuxième est au contraire très
intensive en facteur capital (un investissement lourd en matériel mais qui ne nécessite que peu
d’intervention humaine, donc peu de travail).
10. En quoi peut-on dire que l’une des combinaisons substitue du capital au
travail ?
Les combinaisons productives doivent aboutir au même résultat, à la même production. La
deuxième est pourtant, comme vu précédemment, beaucoup plus intensive en facteur capital.
Ainsi, elle permet de se passer des travailleurs de la première possibilité à laquelle elle
substitue une machine « ultramoderne » : elle substitue donc du capital au travail.
11. D’après les dessins, quelle est la meilleure combinaison des facteurs de
production ?
Ces deux combinaisons étant techniquement équivalentes (puisqu’elles permettent d’arriver
au même niveau de production) le moyen avancé par le conseiller pour choisir entre les deux
est de comparer leur coût : il suffit pour lui de choisir celle qui implique la dépense la moins
élevée.
Document 3 (p. 21)
12. La substitution du capital au travail est-elle toujours possible ? Justifiez votre
réponse.
Non. Il est, pour le moment tout du moins, des métiers, des activités, des professions où la
machine ne peut pas remplacer l’homme (avocat, expert comptable, chirurgie, coiffure, etc.).
13. Quelles conséquences sur l’emploi la substitution du capital au travail peut-
elle avoir ?
Il est double. La substitution du capital au travail supprime à court terme des emplois dans les
secteurs concernés. Toutefois, à moyen et long terme, ces emplois sont transférés vers

23
Chapitre 2 – Comment se crée et se mesure la richesse ?
d’autres secteurs où la machine ne peut que difficilement remplacer l’homme. Globalement,
l’effet est le plus souvent positif (selon la théorie du déversement) : les emplois créés
compensent au minimum ceux qui ont été détruits.
14. Quelles sont les conséquences possibles de la substitution du capital au travail
sur la qualification des agents ?
La substitution du capital au travail supprime des emplois peu qualifiés, souvent pénibles,
parfois dangereux. Les emplois créés le sont, en général, dans des secteurs nécessitants de
meilleures qualifications (secteurs juridique, de gestion, de finance, commercial, de
service, etc.). Une des conséquences envisageables de la substitution du capital au travail est
donc l’amélioration de la qualification des agents.
2. Le rôle de l’information et des savoirs dans la création de
richesse
Découvrir (p. 22)
1. Les savoirs (méthodes, techniques, façons de faire, etc.) ont-ils augmenté dans
l’agriculture entre le début du 20e siècle et aujourd’hui ? Donnez des exemples.
Les savoirs ont énormément augmenté depuis le début du 20e siècle. D’une agriculture très
intensive en facteur travail, nécessitant beaucoup de main-d’œuvre, nous sommes passés à
une agriculture fortement mécanisée, ne nécessitant que peu d’exploitants agricoles. Par
ailleurs, les techniques et savoirs (sélection des espèces, engrais, etc.) ont aussi énormément
évolué.
2. Qu’ont permis ces savoirs sur la production des agriculteurs ?
L’évolution de ces techniques et savoirs a permis d’augmenter énormément les rendements et
donc de produire beaucoup plus de denrées agricoles.
Document 1 (p. 22)
3. Comment a évolué le rôle de l’information depuis une vingtaine d’années ?
Le développement des techniques de l’information et de la communication, l’informatisation,
le développement de l’internet, ont rendu l’information plus abondante et plus accessible : elle
est par là même devenue, comme l’indique le document, « une matière première stratégique »
dont la maîtrise est une nécessité pour la plupart des organisations.
4. Pourquoi les entreprises doivent-elles maîtriser l’information ?
L’ouverture des marchés a rendu la concurrence internationale de plus en plus forte et rude.
La maîtrise de l’information sortante (ne pas divulguer leurs savoir-faire, leurs techniques,
leurs secrets de fabrication, etc.) aussi bien que celle des informations entrantes (savoir ce que
préparent les concurrents, connaître les évolutions technologiques, les nouvelles
tendances, etc.) est donc devenue un facteur clef de succès pour rester compétitif.

24
Chapitre 2 – Comment se crée et se mesure la richesse ?
5. En quoi le HTC 7 Pro illustre-t-il la phrase soulignée ? Quels autres exemples
pouvez-vous citer ?
Comme le montre le document, des entreprises de pays émergents (comme le Taïwanais
HTC) dépassent de plus en plus le stade de la copie pour devenir de vrais innovateurs avec
des produits à la fois compétitifs, techniquement avancés et novateurs. Le HTC 7 Pro en est
un très bon exemple, mais ils sont nombreux dans ce cas : Samsung (qui développe tablettes
et Smartphones), Hyundai (qui développe des voitures) ou encore LG (qui développe des
téléviseurs, des téléphones, etc.) et bien d’autres encore.
Document 2 (p. 23)
6. Comment est considéré et géré le capital humain au sein du groupe Banque
populaire ?
Le capital humain est considéré par le groupe Banque Populaire comme « une donnée
essentielle » ayant un « rôle stratégique ». En favorisant le capital humain, les Banques
Populaires accroissent les compétences, la polyvalence, l’adaptabilité de leurs employés ce
qui leur permet de rester compétitifs face aux mutations et aux évolutions de l’environnement
économique et financier.
7. Pourquoi les nations ont-elles besoin de « travailleurs qualifiés » ?
Les nations ont besoins de travailleurs qualifiés car le capital humain accumulé par ces
derniers permet de générer de la croissance économique ainsi que de préserver et de
développer l’emploi (et donc de limiter ou de diminuer le chômage).
8. Quelles sont les principales composantes du capital humain ?
Le capital humain est immatériel. Ses principales composantes sont les connaissances
acquises par les agents, leur savoir-faire ainsi que leurs compétences diverses et variées.
9. Que permet le capital humain sur les gains de productivité ? Pourquoi ?
Le capital humain permet d’accroître les gains de productivité. En augmentant les
connaissances, les compétences, les savoir-faire des agents, le capital humain accumulé les
rend plus efficaces, plus polyvalents, ce qui leur permet de produire plus pour une même
charge de travail.
3. La mesure de la production
Découvrir (p. 24)
1. Ces deux personnes vendent-elles leurs réalisations au prix des matériaux
nécessaires à leur production ? Pourquoi ?
Non, vraisemblablement le peintre ne vendra pas son tableau au prix de la toile et de la
peinture et l’ébéniste ne vendra pas son meuble au prix du bois et du verni nécessaire à sa
fabrication. En réalisant ces œuvres, ces deux artisans intègrent beaucoup plus de valeur que
celle des matériaux au produit fini. Ils intègrent la valeur de leur talent, de leur travail, de leur
temps mais aussi d’une partie du capital nécessaire à leur fabrication… Autant de raisons qui
font que le prix de vente doit nécessairement être bien plus élevé que le prix des matériaux
qu’ils incorporent.

25
Chapitre 2 – Comment se crée et se mesure la richesse ?
Document 1 (p. 24)
2. Dans l’exemple du dessin, l’entreprise vend 6 000 de ses voitures dans l’année.
Comment calcule-t-on sa valeur ajoutée ?
Dans l’exemple du dessin, la valeur ajoutée créée par l’entreprise est égale à :
(10 000 € – 7 500 €) 6 000 = 15 000 000 €
3. Quelle différence y a-t-il entre le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée ?
Le chiffre d’affaires d’une entreprise est égal au montant total des ventes qu’elle a effectué
sur une période donnée, alors que sa valeur ajoutée est égale au montant de la richesse qu’elle
a créée. La valeur ajoutée est donc égale au chiffre d’affaires diminué du montant des achats
externes qu’elle a effectué.
4. Pourquoi seule la valeur ajoutée permet-elle de mesurer la contribution réelle
d’une entreprise à la richesse créée ?
La valeur ajoutée, comme son nom l’indique, mesure la valeur que crée l’entreprise dans le
processus productif, la valeur qu’elle ajoute grâce à sa technique, son talent, son savoir-faire,
son capital. C’est bien la mesure de la richesse dont elle est seule à l’origine. Le chiffre
d’affaires comprend, lui, la valeur des biens et services qu’elle a acheté à d’autres entreprises
et donc qu’elle n’a pas créé. On ne peut donc l’utiliser pour mesurer la richesse qu’elle
génère.
Document 2 (p. 25)
5. La valeur ajoutée créée en 2011 par les entreprises allemandes situées en
France est-elle comptabilisée dans le PIB de l’Allemagne ou de la France ?
Justifiez.
La valeur ajoutée créée en 2011 par les entreprises allemandes situées en France est
comptabilisée dans le PIB de la France. En effet, le PIB mesure la richesse dégagée en un an
par les facteurs de production situés dans l’économie nationale, quelles que soient les
personnes qui possèdent ces facteurs.
6. Indiquez si les productions suivantes sont marchandes ou non marchandes : les
services bancaires, les conseils de Pôle emploi, le raccordement à l’ADSL, la pose
d’un plâtre sur un bras cassé aux urgences.
Production marchande : service bancaire, raccordement à l’ADSL.
Production non marchande : conseils de Pôle emploi, pose d’un plâtre aux urgences.
7. Quel lien faites-vous entre le PIB, le PIB marchand et le PIB non marchand ?
PIB = PIB marchand + PIB non marchand.
8. La croissance économique étant égale a ̀ la variation du PIB en % entre deux
années, calculez la croissance en France en 2010.
Croissance de la France en 2010 = (1 715 / 1 690) – 1 100 = 1,47 %
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%