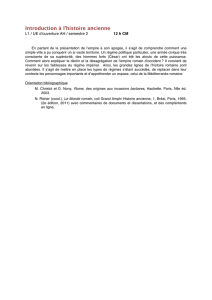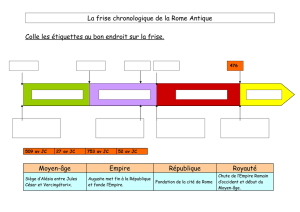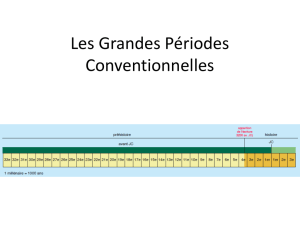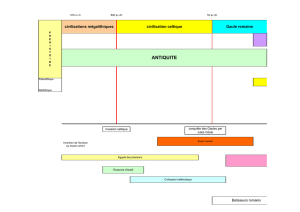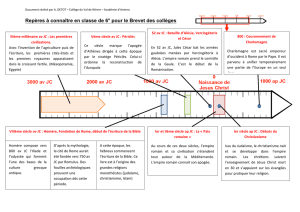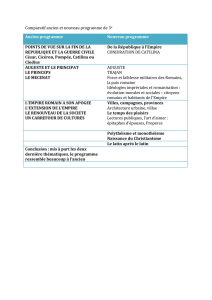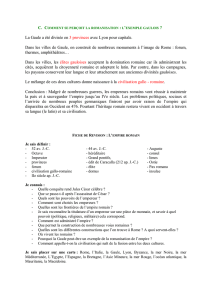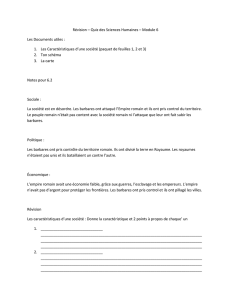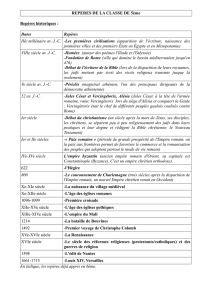Le Limes romain, la Grande Muraille de Chine et le

Le Limes romain, la Grande Muraille de Chine et le souffle des empires
L’Empire Romain connut sa plus grande expansion en 116 après J.-C., sous le règne de l’empereur
Trajan. Ce chef romain réussit, en effet, à conquérir l’Arménie et la Mésopotamie, jusqu’à Ctésiphon, la capitale
de l’Empire Parthe. La domination de Rome s’étalait donc à l’époque sur trois continents : l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. Romain était l’ordre de l’ancien monde, romaines les voies de communication, romain le système
économique et diplomatique qui reliait entre eux des peuples aux cultures extrêmement différentes. Mais
pourquoi l’expansion de Rome s’arrêta donc en si bon chemin ?
L’élan expansionniste de Rome ne s’arrêta pas à cause d’une confrontation avec des peuples
particulièrement doués sur le champ de bataille. Pendant une grande partie de son histoire, les limites de
l’Empire Romain furent tracées sur les lieux d’affrontement avec des armées qui ne se battaient pas de façon
traditionnelle, mais qui préféraient plutôt dresser des embuscades inattendues, suivies par un rapide retrait.
Comme a écrit Luttwak dans son livre La Grande Stratégie de l’Empire Romain : « Les Romains eux-mêmes ne
pouvaient utiliser efficacement leur forces contre des nations constituées par des guerriers qui habitaient
éparpillés dans les campagnes et dont les forces ne dépendaient pas de la survie d’une structure économique
et sociale fondée sur les villes. Il y avait donc une raison technique et militaire à la base des limites
géographiques de l’expansionnisme de l’empire. Ces limites n’étaient pas simplement dues à des questions de
place, de distance ou de population ; il s’agissait plutôt de limites de type qualitatif et, bien plus important,
elles concernaient en même temps la diplomatie coercitive et la guerre. C’est pour cette raison que les
Romains ne pénétrèrent jamais dans la zone semi-désertique de l’Afrique septentrionale, dans les régions
d’Europe Centrale encore couvertes de forêts, dans les plaines de l’Ukraine moderne, dans le haut plateau
aride de l’Iran ou dans les déserts d’Arabie
1
».
Environ deux siècles avant Trajan, Marcus Licinius Crassus, dans sa tentative de gagner du prestige vis-
à-vis des deux autres triumvirs, Jules César et Pompée le Grand, essaya de vaincre les Parthes, dont le règne
s’étendait de l’Iran moderne jusqu’à l’Afghanistan. Crassus fut impressionné par la tactique militaire de cette
population du Proche Orient, qui consistait en des attaques éclaires éphémères par ses chevaliers et ses
archers à cheval. Il pensait par contre que ces sorties n’étaient pas dictées par une finesse militaire, mais
uniquement par de la couardise. En réalité, les attaques des Parthes furent extrêmement efficaces et
affaiblirent la résistance des Romains, jusqu’à leur déroute dans la seule bataille rangée, celle de Carrhes, en 53
av. J.-C.
Crassus paya sa défaite avec la mort sur le champ de bataille. Ce fut la tragique conclusion d’un dessein
militaire mû par l’ambition et la convoitise qui s’éloignait de façon substantielle des préceptes stratégiques
propres de l’Empire Romain. Les campagnes de conquête et les guerres menées par Rome ne se fondaient pas
sur le courage de l’armée ou sur l’héroïsme des guerriers : leur principe fondamental était emprunté « à la
méthode et à la prudence » (toujours Luttwak). L’organisation, la préparation et la gestion avisée des
ressources étaient les clés de leur succès militaire.
On comprend mieux avec ces bases le sens du rapport des Romains avec l’espace : l’expansion était
motivée par l’intérêt et le calcul et, contrairement à l’attitude des multinationales modernes, la croissance
s’arrêtait quand les coûts de l’annexion dépassaient les bénéfices. Les professeurs du lycée qui, en observant le
Limes européen, nous disaient que les Romains s’étaient trompés en ne repoussant pas leur frontières jusqu’à
la partie la plus étroite du continent, qui joignait idéalement l’actuelle Odessa à Kaliningrad, avaient tort. Se
1
Luttwak, Edward N. (1976), La Grande Stratégie de l’Empire Romain, Economica.

limiter aux rives du Danube était une attitude dictée par la règle de la prudence et de l’intérêt ; dompter les
populations de la Germanie n’aurait desservi aucun but stratégique et aurait été bien trop onéreux. C’est pour
cette même raison qu’en Bretagne on préféra bâtir la frontière fortifiée du « Mur d’Hadrien », longue 118
kilomètres, plutôt que de stabiliser le « Mur d’Antonin », plus au nord et long seulement 59 kilomètres.
L’essence du rapport des Romains avec l’espace s’exprimait également dans la structure des frontières,
qui évolua progressivement au fil des siècles. Sous le système « Julio-Claudiens », en gros d’Auguste à Néron,
on atteignit le niveau militaire minimum, avec une armée composée vingt-cinq légions seulement. Il n’existait
pas de frontières armées comme on pourrait les imaginer aujourd’hui et la sécurité était garantie par un réseau
d’« états clients » qui étaient récompensés par leur fidélité à Rome. En cas d’émeutes ou d’invasions d’une
certaine importance, les légions mobiles interceptaient l’ennemi à l’intérieur même du territoire de l’empire.
Ce fut seulement avec la successive dynastie des Flaviens que démarrèrent les grands travaux de
fortification des frontières. Toutefois, l’élévation des murailles et des tours de garde n’arrêta pas le
développement des stratégies romaines : dans un premier temps, la force de frappe militaire consistait dans la
capacité des milices de sortir des frontières armées et d’intercepter les ennemis à l’extérieur. Progressivement,
surtout lors de la « grande crise du 3ème siècle », la tactique se mua en une sorte de défense « en profondeur »,
avec un système de protection « intérieur » pour la surveillance des principaux axes de communication et des
agglomérations.
Pendant ce long parcours, ce ne fut pas seulement la conception militaire que Rome avait d’elle-même
qui changea, mais également son rapport avec les « états clients ». Le succès de la plus importante ville-état de
l’antiquité fut rendu possible aussi grâce à sa capacité de créer une « structure économique » interculturelle,
qui la transforma en un « empire hégémonique ». Ce fut justement la croissance des anciens « états clients »
qui commença à représenter la principale menace pour la sécurité des populations romaines des frontières.
Une des raisons qui motiva la métamorphose progressive de l’approche défensive en stratégie de fortification.
Aujourd’hui, on pourrait dire que la Rome républicaine, et, en partie, celle impériale, fondaient leur
pouvoir non seulement sur la force, mais également sur le « soft-power ». Si les frontières furent par la suite
« armées et surveillées », cela dépendit de causes internes et externes. Les luttes de pouvoir pour le contrôle
du siège impérial obligeaient fréquemment à rappeler les troupes des périphéries pour les affecter à des
batailles sur le front interne ; au-delà du Limes, on craignait que des nouveaux « états clients » puissent devenir
trop forts, en remettant en question le pouvoir et l’intégrité de Rome.
Ce fut à ce moment-là qui naquit le premier concept historique d’« empire territorial », concept qui a
par la suite caractérisé le rapport de beaucoup d’autres puissances nationalistes avec l’étranger.
On compare souvent la Chine à l’Empire Romain justement pour cette caractéristique de la
territorialité. La Grande Muraille était non seulement une ambitieuse ouvre architecturale, mais également la
réalisation matérielle d’une attitude politique. Dès les premières palissades érigées au 5ème siècle av. J.-C. et
jusqu’aux immenses fortifications de la dynastie Ming (1368-1644), l’idée chinoise était celle de séparer le
territoire contrôlable de celui habité par des tribus indomptables, d’origine mongole ou manchoue. En citant
encore une fois Luttwak, on peut employer à propos de cet aspect historique chinois une description relative
au système frontalier romain sous la dynastie des Flaviens : « […] les méthodes de planification utilisées par les
Romains dans les zones frontalières nécessitaient que les habitants et le territoire fussent adaptés à
l’établissement et au développement, de façon à permettre une sorte d’auto-romanisation volontaire de la
part d’une population fleurissante, en réponse à l’introduction des idées et des produits manufacturés
romains. D’autre part, du point de vue diplomatique, il était nécessaire que les peuples qui vivaient au-delà des

frontières fussent sensibles aux menaces et aux suggestions exercées par le système romain de contrôle
indirect
2
».
Si on veut comparer le progrès stratégique de l’Empire Romain avec celui de la Chine, on ne peut par
contre pas adopter une théorie « déterministe » du développement. Il n’est pas dit qu’une phase hégémonique
(ou, selon notre définition, de « soft-power ») soit suivie par une « territoriale » (qu’on devrait donc définir
comme « hard-power »). Il s’agit plutôt de phases qui s’alternent pendant les cycles de longue haleine des
empires.
L’hégémonie permet des périodes de conquête, parce qu’elle ne se fonde pas sur des frontières
tracées dans la pierre. La territorialité représente quant à elle le sommet de l’expansion, c’est-à-dire le
moment où la complexité du système extérieur dépasse celle du système intérieur. La muraille définit une
frontière et permet donc de se concentrer sur la situation domestique, jusqu’à la reprise de l’expansion.
Il est évident que, pour un empire, les deux aspects de l’hégémonie et de la territorialité coexistent, car
l’un n’exclut pas l’autre ; il faut toutefois imaginer le « Souffle des Empires » comme étant caractérisé par des
phases qui voient une des deux caractéristiques prévaloir sur l’autre, pour ensuite décliner et laisser la place à
sa concurrente. La territorialité renferme dans ses frontières ce que, pour l’empire, peut être défini comme
l’« idée politique nationale », c’est-à-dire l’ensemble de toutes les cultures qui partagent une même idée
culturelle – et donc économique et sociale – compatible.
La Chine moderne est passée d’une phase de « territorialité », prédominante jusqu’à l’arrivée de Deng
Xiaoping, à celle d’une plus importante expansion de sa prétention hégémonique, grâce à l’outil de la « guerre
économique
3
». Ce n’est pas une stratégie « nouvelle » : elle a, en effet, caractérisé le développement des
grands « cycles d’accumulation du capital » de l’époque moderne et contemporaine, dictant les possibilités de
naissance de la Venise des marchand, des Pays-Bas, de l’Empire Britannique et des Etats-Unis
4
.
Deng a représenté la fin du « colonialisme interne » de la Chine : en 1978, le processus de
nationalisation Han était pratiquement conclu et le territoire chinois était devenu une zone de compétence
semi-exclusive de l’ethnie centrale. Avec la fin de Mao, avait aussi disparu la tension civile qui découlait du
contraste entre la désormais chétive opposition du Kuomintang et le Parti Communiste. Le système national
domestique était revenu à un niveau de complexité gérable ; au-delà de la Grande Muraille, les opportunités
offertes, dans un premier temps par la crise soviétique et, ensuite, par la fin de la Guerre Froide, furent des
exhortations à l’expansion.
La Chine, dans son rôle d’empire socialiste, a été plus chanceuse que son homologue soviétique.
Moscou a vécu sa phase de complexité interne jusqu’en 1937, l’année « de la terreur et du rêve », quand le fou
lucide Staline transforma Moscou et tout le pays en un système parfait pour la persécution des dissidents et
pour le développement d’un idéal « utopique d’une nouvelle société
5
». La phase d’expansionnisme se
prolongea pendant les courtes et très violentes années de la deuxième guerre mondiale, en refaisant ensuite
2
Luttwak, Edward N., op. cit.
3
Pour éviter de citer l’omniprésent Luttwak (Luttwak, Edward N. (1990), From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of
Conflict, Grammar of Commerce, The National Interest), nous vient en aide l’école française des années 1990 : Esambert,
Bernard (1990), La guerre économique mondiale, Olivier Orban ; et Harbulot, Christian (1992), La machine de guerre
économique, Economica.
4
Braudel, Fernand (1986), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Armand Colin ; et aussi
Arrighi, Giovanni (1996), Il lungo XX secolo: denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il Saggiatore.
5
Schlögel, Karl (2010), Terror und Traum, Fischer Taschenbuch Verlag.

régulièrement surface seulement pendant de courtes périodes, jusqu’à la catastrophe de l’intervention en
Afghanistan dans les années 1980. L’URSS dut se confronter à la stratégie impérialiste américaine le long de ses
propres frontières, en une globalisation du conflit qui réduisit les prétentions de Moscou dès 1945.
Beijing n’as pas rencontré sur son chemin récent ce genre de limites et sa croissance se poursuit sur
tous les continents.
Arrivés à ce point, on pourrait se demander si le développement d’un « empire commercial » ait un
sens. Le principe, comme pour la territorialité, est que le développement sur des nouveaux marchés a un sens
tant que les avantages dépassent les coûts. Beijing, de ce point de vue, est une réalisation ultérieure des grands
cycles d’accumulation du passé, mais de façon bien plus évoluée
6
. Le grand Empire Britannique a été critiqué
par les historiens marxistes pour ses concepts de domination et de vexation ; mais il a été également
désapprouvé par les libéraux, car « […] le fait que l’impérialisme ait déformé le marché – en se servant de tout,
de la force aux tarifs préférentiels, pour le modeler à l’avantage de la mère patrie – a également desservi sur le
long terme l’économie britannique
7
».
Les Etats-Unis ont résisté à la tentation de coloniser le territoire ou, du moins, de le faire à la façon
anglaise. Washington a stimulé la croissance d’économies démocratiques, libérales et intégrées, afin de
protéger les frontières claires en Europe et en Asie (voir, par exemple, son soutien au Japon) ; là où les
frontières n’étaient pas clairement définies, comme au Moyen-Orient ou en Afrique, il a financé la croissance
d’« états clients », en récompensant le chef de la tribu du moment, qu’il s’appelle Reza Pahlavi (en Iran) ou
Hosni Moubarak (en Egypte).
La Chine contemporaine n’impose pas de modèles politiques à ses principaux partenaires commerciaux
et elle se limite à créer un système de « protection économique » avec les réalités étrangères. La cohésion du
système politique interne, incarnée par l’hyper-conservateur Parti Central, permet de gérer l’expansion
extérieure sur la base d’un concept « prudent et administratif » plutôt qu’« héroïque et éphémère ». C’est sur
la stabilité domestique que se fonde le pouvoir extérieur ; et les objectifs internationaux prennent appui sur les
nationaux. La pulsion à la croissance impériale est offerte par des idéaux qui outrepassent l’économie : c’est
l’idée d’exceptionnalisme, soit-il anglais, américain ou chinois, qui crée l’anxiété de conversion du monde ;
l’économie n’en est que l’instrument.
Il n’est pas crédible de penser que la logique du « désintérêt » chinois pour les questions politiques des
autres puisse représenter l’axe de travail sur le long terme des relations de Beijing avec le reste du monde. Cela
est possible uniquement pendant la phase « expansive » de l’empire. Au fil des années, d’autres risques
apparaitront : qu’on le veuille ou pas, des significations politiques sont attachées aux marchandises échangées.
Beijing fait de la politique quand, en marge de la crise de 2008, injecte des milliards de dollars pour revitaliser
l’industrie énergétique de Moscou, au cœur de l’économie russe. Beijing fait de la politique en étant aussi
timide dans ses critiques vis-à-vis de l’Iran et de la Corée du Nord pour leurs respectives ambitions nucléaires.
C’est également un fait politique le soutien de la Chine à Robert Mugabe dans son rôle très discuté de
président du Zimbabwe.
Si l’on prend tout cela en considération, on peut conclure que la Chine n’est, en réalité, pas encore un
empire, mais seulement une force nationale en pleine phase de conquête. Elle deviendra un empire seulement
6
Braudel et Arrighi soulignent comme les grands cycles d’accumulation ne devraient pas être interprétés de façon
« séquentielle », mais nous ne pouvons pas nous abstenir de remarquer comme chaque réalisation impérial-capitaliste ait
repris des aspects des cycles précédents, en les peaufinant et en les exprimant à nouveau. Ceci a été surtout vrai pour le
passage du cycle britannique à celui américain et cela arrive de nouveau pour le passage au cycle chinois.
7
Ferguson, Niall (2003), Empire. How Britain Made the Moderne World, Allen Lane.

si elle réussira à imposer un système de valeurs et de notions sociales, économiques et politiques. Si elle
acceptera la responsabilité d’être un empire.
Aujourd’hui, sont déjà à l’œuvre certaines dynamiques qui pourraient contraindre Beijing à revenir à
une phase territoriale. Les conflits intérieurs sont en augmentation et, de plus, il y a des zones où l’idée
nationale est en déclin. La frontière russo-chinoise, lieu d’affrontements très violents pendant les derniers
siècles, pourrait être la première à vaciller dans le cas d’un retour à la territorialité. Pendant la dernière période
de vie de l’Empire Romain, les troupes en garnison le long du Limes germanique avaient désormais acquis la
physionomie et l’aspect culturel des tribus barbares, avec des légionnaires blonds et bien plus hauts que leurs
collègues romains. En Chine, à cause des décennies de politique de l’« enfant unique », il y a aujourd’hui une
majorité d’hommes ; à la frontière avec la Russie, cela a encouragé les unions transnationales.
A l’Ouest de la Chine, la population ouïgoure du Xinjiang est de moins en moins attirée par le modèle
central et l’« avantage attendu de la rébellion » est en train de dépasser celui de la fidélité. La Chine, pour le
moment, est un « empire » seulement à l’intérieur de ses frontières et ces signaux suggèrent que dans ce
domaine Beijing soit déjà revenu à la territorialité (si jamais il en était sorti).
D’autres pays, considérés comme des « états clients », sont en train d’apprendre des Chinois
l’organisation du travail et la productivité. Même les Etats-Unis sont en train de se réorganiser et essayent de
s’intéresser de moins en moins aux questions politiques d’autrui, en rêvant de plans pour la renaissance des
exportations.
La circularité entre hégémonie et territorialité peut être interrompue si des éléments destructeurs de
ce type se produisent. C’est pour cette raison que l’Empire Chinois, pour démontrer d’être tel, devra les
affronter.
Le monde externe à la Chine est en train de redevenir plus complexe par rapport aux années 1990 et
c’est pour cela que les apparats internes de Beijing doivent être capables de répondre avec des réformes. Le
modèle dirigiste du Parti Central a été un succès dans un système fragmenté – comme celui de l’après 1989 –
mais maintenant la Chine va être soumise à des nouvelles impulsions. Comme dans la Rome antique, ces
impulsions pourraient se traduire en des tentations de lutte entre factions et groupes de pouvoir, en amenant
ainsi le pays à la désagrégation. Ou, au contraire, elles pourraient inspirer la naissance d’une Chine nouvelle qui
colorera de rouge une grande partie du monde. Ou peut-être que le système a conduite étatique réussira à lire
correctement la situation et à conserver l’avantage national : il s’agirait, dans ce cas, d’un réel changement
d’époque. Mais nous, vieux européens, au fond, nous ne croyons pas que cela soit possible.
Stefano Casertano (Rome, 1978) est professeur de politique internationale à l’Université de Potsdam, en
Allemagne, MBA de la Columbia University et Ph.D. de l’Université de Potsdam. Depuis 2011, il est Senior
Fellow du think tank allemand BIGS. Son domaine de prédilection est l’histoire des rapports entre les grandes
puissances depuis l’après-guerre, en particulier dans le secteur de l’énergie.
Il est l’auteur d’une trilogie sur la géopolitique énergétique qui sera complétée en 2011. Le premier volet de la
série a été « Sfida all'Ultimo Barile » (Brioschi Editore, 2009), soit Défi au Dernier Baril, une histoire de la guerre
froide pour le contrôle du pétrole de 1945 à nos jours. En 2010, ce travail a été développé par la publication de
« Oro Blu » (Fuoco Edizioni), Or bleu, ouvrage dédié aux rapports énergétiques entre Chine, Russie et Europe.
Et cette année sortira donc « La Guerra del Clima » (Francesco Brioschi, 2011), La Guerre du Climat, analyse de
 6
6
1
/
6
100%