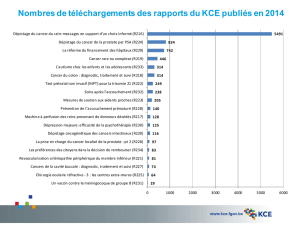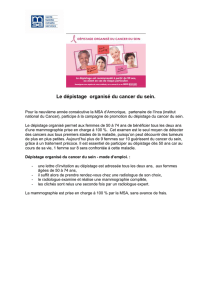A la demande d`un journaliste qui demande un avis sur les articles

1
A propos de la polémique sur le dépistage du cancer du sein
Les polémiques successives sur le dépistage des cancers du sein viennent de connaître un nouvel
épisode avec une publication du magazine Que Choisir, juste avant la campagne annuelle d’Octobre
Rose. Douze ans après la méta-analyse de Goltzsche et Olsen dite "méta-analyse danoise" ou "méta-
analyse du Lancet" publiée en 2000 (Gotzsche PC, Olsen O. Is screening for breast cancer with
mammography justifiable ? Lancet 2000 ; 355 : 129-34), 6 ans après la « méta-analyse » de la revue
Prescrire, en 2006 (Rev Prescrire 2006 ; 26 : 348-74.), les mêmes arguments sont repris. Pourtant, des
réponses objectives, claires, argumentées, avaient été apportées par la communauté scientifique
internationale.
La publication du magazine Que Choisir laisse entendre en outre que l’intérêt porté par les
professionnels de santé à la santé publique en général et au dépistage du cancer du sein en particulier
ne serait pas fondé sur le seul espoir de sauver des vies et d’alléger la souffrance. Cela démontre une
profonde incompréhension des contrats d’objectifs conventionnels passés entre l’Assurance maladie et
les professionnels de santé. Les représentants des professionnels de santé et de l’Assurance maladie
apporteront sans doute une réponse, nous nous contenterons d’aborder ici la problématique de santé
publique.
Le dépistage des cancers du sein, à côté des bénéfices espérés (sauver des vies), a potentiellement
des effets délétères (Dilhuydy MH, Barreau B. The debate over mass mammography : is it beneficial for
women ? Eur J Radiol 1997 ; 24 : 86-93). La population et les acteurs de santé tendaient à les ignorer,
ne retenant que les bénéfices espérés. Ce sont les acteurs du dépistage qui ont fait connaître ces effets
délétères. Pour en atténuer l’impact Ils ont mis en place un contrôle de qualité et une formation à tous
les niveaux, ainsi qu’une évaluation rigoureuse et continue.
A titre d'exemple, un effet iatrogène important du dépistage est le surdiagnostic, mis en évidence par les
pionniers du dépistage organisé grâce à l’évaluation de leurs programmes expérimentaux. Il consiste à
détecter des lésions qui ne seraient jamais devenues des cancers maladie du vivant de la femme : ces
femmes sont "atteintes d'un cancer" du seul fait du dépistage alors qu'elles n'auraient rien eu et/ou
seraient décédées d'autre cause. En surveillant le taux de biopsies chirurgicales et le taux de cancers in
situ de bas grade détectés, en imposant aux radiologues, tous formés par le même organisme de FMC,
d'utiliser un système de référence (BI-RADS/ACR) pour classer des images mammographiques, en
conseillant de surveiller certaines calcifications au lieu de toutes les prélever, l’organisation du dépistage
a permis de maintenir le surdiagnostic dans des limites acceptables.
Les acteurs du dépistage organisé ont demandé qu’une information claire et loyale soit dispensée aux
femmes à qui l’on propose le dépistage. Si les recommandations nationales sur la communication en
tiennent compte, il faut reconnaître que cette information n’est pas déclinée partout aussi clairement,
tant il est plus facile de ne prôner que les bénéfices du dépistage dans une démarche purement
incitative. Pourtant, le fait de prendre en compte les effets délétères et de les mettre en exergue ne veut
pas dire que l'on est « contre la mammographie » mais pose le principe qu’un dépistage mal fait,
appliqué sans limite d’âge, sans évaluation, peut être plus nuisible qu'utile. C’est pour cette raison que
l’on a organisé le dépistage, afin que le choix rationnel de la population bénéficiaire, l'assurance de
qualité opposable à tous les intervenants et l’évaluation continue et rigoureuse soient au rendez-vous.
Lorsqu’on le leur explique clairement, les femmes sont capables de le comprendre et si elles adhèrent,
de le faire en toute connaissance de cause.
Les polémiques autour du dépistage organisé des cancers du sein s’appuient trop souvent sur une
démarche de conviction, tant de la part des détracteurs que des avocats du dépistage. Pourtant, la santé
publique n’a rien à voir avec la conviction, elle est basée sur l’épidémiologie et l’analyse statistique. Il
faut donc revenir sur les chiffres sous-tendent ce débat :
- Il est démontré que le dépistage par la mammographie, dans des conditions prédéfinies de qualité
et d'évaluation, réduit la mortalité par cancer du sein de 20 % dans la population de femmes à laquelle il
est proposé. Si l’on ne comptabilisait que les femmes qui ont participé, cette réduction serait plus
importante, mais cela introduirait un biais. Toutes les méta-analyses (14 au total) de l'ensemble des
essais réalisés démontrent ce bénéfice. Il faut noter qu’il s’agit d’essais anciens où la qualité des
mammographies et la performance des lecteurs étaient très en deçà de la performance actuelle.

2
- La méta-analyse de Goltzsche et Olsen ou "méta-analyse du Lancet", qui fut interprétée par les
médias comme très défavorable à la mammographie, et que reprennent largement les auteurs de la
revue Prescrire, démontre le même bénéfice lorsqu'elle est ré analysée avec une méthodologie adaptée.
C’est ce qu’on réalisé les méthodologistes de la Fondation Cochrane (Olsen O, Gotzsche PC. Screening
for breast cancer with mammography (Cochrane review). In : The Cochrane Library, Issue 4 : 2001.
Oxford : update software.) en corrigeant les erreurs de la première analyse qui était menée comme pour
les essais thérapeutiques "en intention de traiter" avec la mortalité brute comme critère. Les essais
analysés ne sont pas conçus pour cela et n’ont pas assez de puissance statistique pour donner un
résultat avec la mortalité globale comme critère. Il a fallu analyser comme pour une intervention en
population générale avec la mortalité relative par cancer du sein comme critère pour démontrer que
cette méta-analyse donne le même résultat que les autres. La HAS (à l’époque ANAES) a fait en 2002
une excellente analyse méthodologique de la méta-analyse du Lancet.
- Quand à la parution de la revue Prescrire, il ne s'agit en aucun cas d'une méta-analyse. La méta-
analyse est une technique statistique de ré analyse et d’addition des data de plusieurs essais en tenant
compte d'éventuels biais et différences, pour en augmenter le poids. Les auteurs de Prescrire on fait
uniquement une revue de la littérature, leurs conclusions reflètent une opinion qui n'a pas de signification
statistique. Il ne s'agit pas non plus d'un consensus d'experts, simplement des questions posées,
souvent à juste titre, par les auteurs.
Ces données statistiques peuvent être discutées en fonction de deux facteurs essentiels : l’âge de la
population invitée, et la dispersion des retombées :
- l’âge de la population invitée : plus les femmes sont âgées, plus le dépistage mammographique
est performant ; les seins sont moins denses, les mastopathies bénignes disparaissent, il y a moins de
faux négatifs et moins de faux positifs. Mais plus les femmes sont âgées, moins le bénéfice en « années
de vie de qualité » sauvées est important. La réduction de mortalité spécifique par cancer du sein est
maximale lorsque les mammographies sont proposées aux femmes de 55 à 65 ans, elle atteint alors 30
%, comme l’a démontré la revue à long terme des essais suédois. Si l’on considère l’ensemble de la
population de 50 à 75 ans, cette réduction reste statistiquement significative mais est plus proche de 20
%. Le bénéfice attendu reste supérieur aux risques encourus.
Chez les femmes de 40-49 ans il existe aussi un bénéfice, plus faible, plus long et plus difficile à mettre
en évidence ; l'équilibre avantages / inconvénients ne paraît guère, en l'état actuel de nos pratiques,
suffisamment favorable à titre collectif pour mettre en place une action en population générale. Les
femmes qui réalisent ce dépistage à titre individuel doivent en être justement informées.
Chez les femmes de plus de 75 ans les propositions de dépistage mammographique varient en fonction
de l’évaluation individuelle de l’espérance de vie ; le bénéfice en années de vies sauvées serait bien
difficile à mettre en évidence, et la mammographie doit être mise en balance avec la pratique régulière
de l’examen clinique, plus facile à réaliser et plus performant chez la femme âgée.
- La dispersion des retombées : même si au total, chez les femmes de plus de 50 ans, le bénéfice
attendu est supérieur aux effets délétères encourus, il y a une dispersion des effets : ce ne sont pas les
mêmes qui encourent les effets délétères et qui recueillent les bénéfices. Les premières sont plus
nombreuses, les dernières bénéficient beaucoup puisqu'elles ont la vie sauvée. D’où l’importance de la
participation des femmes : si peu de femmes ont une mammographie, il y a peu de probabilités qu’il y
ait suffisamment de vies sauvées, seuls les inconvénients seront observés, l’équilibre efficacité / risques
ne sera pas favorable aux femmes. C’est pour cette raison que les professionnels de santé, les
décideurs, les efforts de communication, mettent autant l’accent sur la participation.
La participation des femmes au dépistage est donc aussi une affaire de solidarité citoyenne : pour que
certaines soient sauvées, il faut que d’autres, beaucoup plus nombreuses, acceptent de ne recueillir du
dépistage que des inconvénients. La plupart de inconvénients sont mineurs, comme par exemple le fait
de passer des mammographies pour n’en retirer aucun bénéfice personnel. D’autres sont beaucoup plus
délétères, comme les faux négatifs et la fausse réassurance, les faux positifs, les biopsies inutiles, et le
surdiagnostic avec surtraitement. Cette notion de solidarité, sans assurance que l’on puisse soi-même
bénéficier, doit faire partie des informations données aux femmes. Et contrairement à ce que l’on peut
craindre, cette information « passe bien », nous en avons fait l’expérience.

3
Enfin, il faudra à l’avenir, plutôt que de polémiquer sur des données acquises, établir une veille continue
pour tenir compte des progrès que l’on ne manquera pas d’accomplir. Les avancées technologiques de
l’imagerie du sein devront être observées, il est possible qu’il devienne nécessaire d’ajouter ou d’opter
pour d’autres techniques afin d’améliorer les objectifs de santé publique avec un minimum d’effets
délétères. Une meilleure connaissance des facteurs de risque d’avoir un cancer du sein permettra peut-
être de mieux cibler la population à dépister et les moyens à mettre en œuvre pour cette population. Les
progrès thérapeutiques sont majeurs, leur impact sur la réduction de mortalité par cancer du sein, que
l’on observe depuis quelques années, est équivalent à celui du dépistage. La recherche amènera
d’autres progrès qui pourraient remettre en cause le dépistage tel qu’il est pratiqué actuellement.
Dr MH Dilhuydy
Octobre 2012
1
/
3
100%