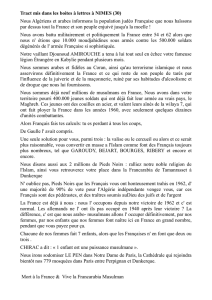Dans un article – Mahomet : le choc des ignorances (Mahomet ou

NOTES SOCIALES 3
Dans un article – Mahomet : le choc des ignorances (Mahomet ou Mohamed, Muhammad « celui qui mérite les
louanges »), l’expert en religions du Monde, Henri Tincq écrit : « L’histoire à nouveau s’emballe. Près de vingt ans après
l’affaire Rushdie, l’affrontement entre un Occident arc-bouté sur la défense de ses libertés et un islam insurgé contre le
blasphème se répète. Comme si personne n'avait tiré les leçons d'une crise majeure qui, en 1989 déjà, avait opposé, d'un
côté, les héritiers de Voltaire, de Rousseau et des droits de l'homme et, de l'autre, les fanatiques d'un obscurantisme
islamique partout désignés du doigt. En vingt ans, ni l'escalade du terrorisme, ni les efforts diplomatiques, ni les ponts jetés
par les hommes de dialogue n'ont eu raison des malentendus, des ignorances, de l'aveuglement hystérique des uns, du refus
de toute autocritique chez les autres. »(1)
Sans doute, n’aurons-nous pas posé le problème de manière définie ou finie. Sans doute, n’aurons-nous pas posé le
problème de sorte qu’il ait une solution, quand chacun pourra être sensible à la généralité abstraite d’un Occident arc-bouté
sur ses libertés et d’un islam insurgé contre le blasphème, d’un camp des héritiers de Voltaire et de Rousseau et de celui des
fanatiques d’un obscurantisme islamique.
Dans les années 80, lors de la montée en puissance légale de l’islamisme en Algérie, un reportage nous avait introduit sur le
lieu d’élaboration d’un journal reflétant ce nouveau courant politique : les ordinateurs Macintosh occupant une salle de
rédaction ordinaire, dénonçaient en actes et par avance, un prétendu retour en arrière, à un Islam archaïque ou pur ou
fondamentaliste. Les vingt ans de socialisme algérien n’avaient été rien d’autre que ce moment d’accumulation primitive
où sinon tous, du moins beaucoup furent potentiellement en mesure d’accéder à l’une des classes dominantes en voie de
constitution. Lors de la mise en place de cette structuration sociale dans ces grandes lignes, la chasse aux intellectuels
progressistes qui rêvaient d’une autre Algérie que celle abhorrée par Jean Sénac dans sa cave-vigie, se poursuivit sans
relâche, avec son lot de censure, d’emprisonnement, d’exil. Rapidement, le socialisme ne fut plus qu’un oripeau, et dans ce
vide idéologique, le recours au corpus religieux répond à un besoin situé dans le temps et dans l’espace. En quoi ici, une
réflexion théologique séparant le « bon grain de l’ivraie » serait-elle à même de répondre à ce besoin pratique ?
Selon Henri Tincq, « Mohamed Arkoun, universitaire, spécialiste de l'histoire de la pensée islamique, s'étonne encore que
la représentation de l'Europe chrétienne dans la conscience musulmane – nourrie par les Croisades – occupe plus de place
que la Révolution anglaise et française qui, pourtant, ont “consacré une rupture décisive avec la symbolique religieuse et
produit l’avènement de la raison et des Lumières, qui sont l’impensé musulman” ».(2)
Peut-être. Mais, ailleurs, dans un Orient doublement lointain, un chrétien orthodoxe, Michel Alak et Salah al Bitjar
fondaient en 1943, à Damas en Syrie, le Parti Socialiste de la Renaissance Arabe. Un « nationalisme » arabe et un
socialisme étranger au communisme, se donnaient pour objectifs, la résolution des problèmes sociaux et le renversement
des anciennes valeurs imposées par des classes réactionnaires. Un nouvel ordre économique devait autoriser une
renaissance du peuple arabe. Les Frères Musulmans qui proposaient de nouvelles valeurs islamiques les accusaient
d’athéisme. Le Baath reconnaissait l’Islam comme une partie essentielle de l’héritage arabe, même si tous les arabes ne
sont pas musulmans, s’inspirait de ses valeurs positives. Mais il prônait la laïcité ou cantonnait l’Islam à la vie privée.
A la fin de l’année 1963 et au début de la suivante, le Baath s’empare du pouvoir en Irak et en Syrie. Dans le premier pays,
il ne se maintiendra que durant quelques mois qui seront marqués par une sanglante répression contre les communistes. Il le
retrouvera durablement en 1968. En Syrie, il se maintiendra au pouvoir au prix d’une lutte violente en son sein, entre la
gauche et les modérés. Dans ces deux pays, l’expérience baassiste s’est accompagnée d’une élimination des éléments
progressistes et a abouti à des régimes autocratiques. Il ne devrait pas être autrement surprenant qu’aujourd’hui à Damas,
les héritiers de ceux qui avaient combattu les anciennes valeurs théocratiques et celles nouvelles des Frères Musulmans, se
lancent dans une surenchère islamiste, pour recouvrer un semblant de légitimité populaire quand ils en sont tellement
dépourvus.Cette expérience malheureuse n’efface pas ceci que la conception d’une démocratie laïque a été historiquement
possible pour une conscience musulmane et / ou arabe.
Sur le plan historique, il n’est pas possible non plus d’oublier comment la France traita de terroristes ceux là mêmes qui
avaient appris dans les écoles de la République les modèles sociétaux démocratiques, ou comment durant la guerre froide,
l’Occident contribua activement à la chasse aux progressistes au Moyen-Orient et en Afrique.
Pour la période actuelle, Mohamed Kacimi complète en notant que « cette campagne d'indignation a été essentiellement
orchestrée par les régimes les plus fondamentalistes et les plus totalitaires, du royaume wahhabite d'Arabie, à la tribale
Libye, passant par le Fatah dans les territoires palestiniens pour faire pièce au Hamas.
En jetant quelques hectolitres de lait danois à la poubelle, Riyad prend, à moindre frais, le leadership d'un monde arabo-
musulman où il était en perte de vitesse depuis des années. (…) Le roi Abdallah d'Arabie devient un Saladin qui terrasse
tous les Coeur de Lion de Rotterdam. Je me demande toujours comment ces foules si indifférentes aux violations que
portent leurs gouvernants à leur vie, s’enflamment à ce point dès qu'on touche à leur au-delà ? Comment des foules si
privées de libertés manifestent, non pour être libres, mais pour fustiger la liberté d'autrui ? » (3) Et Soheib Bencheick
ajoute : « Lorsque certains Etats arabes boycottent par des mesures diplomatiques et économiques le Danemark, pays

paisible et pacifique, que penser de leur docilité envers les Etats-Unis à qui ils sont malheureusement livrés,
poings1iés? »(4)
Mohamed Kacimi ne se contente pas de relever quelques contradictions propres à toute real politik bien au-delà de l’aire
moyen-orientale. « Ce monde arabo-musulman est un vaste Goulag, sans Zinoviev ni Soljenitsyne, où Dieu-qui-est-Grand a
pris la place du petit-père-des-peuples. Et qu'on n'aille pas nous ressortir, ad nauseam, et à chaque flambée de violence,
l'âge d'or de Bagdad, l'érotisme des Mille et une Nuits, les parfums d'Orient, la poésie des souks et des hammams, et la
tolérance de l'Andalousie. Une culture ne se juge pas sur les Andalousies qu'elle a connues mais sur les Andalousies
qu'elle peut engendrer ». Et retrouvant les accents du vieux Charlie Marx, sur la misère religieuse comme expression de la
misère et protestation contre la misère, il poursuit : « la force de l'islam de nos jours, c'est qu'il enseigne aux hommes à ne
pas désespérer de la vie en la niant tout simplement. Le monde n'est qu'un dérisoire prélude à l'éternité. Et c'est pour cela
que des millions de désespérés s'y engouffrent jetant derrière eux le monde réel, comme un vêtement trop sale. Dans cette
attitude schizophrénique, tout malheur est la faute de l’autre.(…) Religion de blessés et de démunis, l'islam n'accueille
donc que des victimes et tous ceux qui ne l'habitent pas sont forcément des coupables»(5).
Non pas un Islam en soi avec comme sous-produit, une oumma essentialisée, mais un Islam situé dans le temps et dans
l’espace. Un espace-temps qui, quand bien même comporterait-il des analogies avec celui dans lequel nous nous inscrivons
ici, en est totalement distinct.
Dans d’autres espaces — Etats Unis, Israël, France — , les trois religions du Livre vont être également affectées par des re-
lectures intégristes.
En 1977, un commando de la Fraternité de St Pie X prend d’assaut l’église St Nicolas du Chardonnet, et la méthode sera
réutilisée ailleurs, en France. En 1997, à l’occasion des vingt ans d’occupation illégale et en présence de Bruno Gollnisch,
secrétaire général du Front National, l'abbé Laguérie y donne une messe où il réitère les appels à une reconquête des
églises. Entre-temps, en 1988, Mgr Lefebvre (1905-1991) consacre, sans l’accord du pape, quatre évêques à Ecône en
Suisse où il a trouvé refuge. L’actuel pape, Benoît XVI, pourrait revenir sur l’excommunication ayant frappé ces derniers
pour schisme. (6)
Il y a toujours eu dans l’Eglise, une fraction plus ou moins résiduelle, proche de l’extrême droite. Mais ici, il y a montée en
puissance du courant traditionaliste. Et, sans que l’une explique nécessairement l’autre dans une causalité faible, cette
montée est parallèle à celle du Front National. La problématique politique de l’immigration du Front National du début des
années 80 est devenue par contagion celle de tous les grands partis. Il serait sans doute opportun ici, de se demander ce
qu’il en a été pour l’Eglise quand les frasques d’un Lefebvre et la pauvre prophétie attribuée à Malraux sur la religiosité du
nouveau siècle auront peut-être empêché que l’on s’interrogea plus avant sur l’émergence de nouvelles formes du religieux
en France.
Au moment où il était, pour s’en réjouir ou s’en désoler, question de désenchantement du monde, la hiérarchie catholique
mettait au ban les prêtres ouvriers et reconnaissait le mouvement du renouveau charismatique.
Au-delà, la place du religieux dans la sphère publique s’accroît sensiblement et toujours raisonnablement, eu égard les
dérives intégristes des uns et des autres, jusqu’à devenir une place entière, sans laquelle il n’y aurait pas eu nécessité de
recourir à la …laïcité ! Ouverte ou fermée, poser à nouveau la question laïque signifie nécessairement, en contrepoint,
l’émergence d’une nouvelle question religieuse.
« La liberté d'expression doit-elle ou non s'arrêter à cette frontière du sacré? On ne manie pas impunément, même pour la
fiction ou la dérision, des symboles et des figures comme celle du "Prophète". La figure prophétique est un paradigme
commun à toutes les théologies tirées d'une Révélation divine. La preuve en est la rapidité avec laquelle les autorités
chrétiennes ou juives ont volé au secours des musulmans outragés par les caricatures de leur Prophète. Ainsi se trouve- t-
on face à la répétition du même conflit qu'il y a vingt ans entre deux imaginaires, deux systèmes d’exclusion mutuelle
fondés sur l'ignorance. Ignorance des ressorts intérieurs à la foi musulmane d'un côté. De l'autre, ignorance de la liberté
de création dans un monde arabo-islamique privé de droits et de démocratie » (7).
A la généralité abstraite d’un Islam en soi, d’une foi musulmane et de ses ressorts internes, répond la généralité abstraite
d’une liberté d’expression et d’une liberté de « l’artiste et de l’écrivain (…) sacralisée en Occident ». Pourtant à bien y
regarder, rien de moins sacrées que ces libertés sans cesse battues en brèche sauf à transformer les puissants qui se
succèdent depuis Voltaire et Rousseau, en … blasphémateurs impénitents.
L’alliance dans ce débat, des trois religions n’est pas stupidement corporatiste, simplement institutionnelle. Les trois
représentations se saisissent très logiquement de chaque occasion pour poursuivre la redéfinition du religieux dans nos
sociétés laïques. N’est-il pas en effet possible en cette circonstance de tenter de penser raisonnablement, entre gens de
dialogue et responsables, une liberté d’expression délimitée par le respect des convictions de chacun, des rythmes internes
de la foi, d’une liberté d’expression qui pourrait « s’arrêter à cette frontière du sacré » ?
Pour le théologien Soheib Bencheikh, ancien mufti de Marseille, actuellement directeur de l’Institut Supérieur des Sciences
Islamiques, la question ne se pose tout simplement pas. « Cette revendication (l’exigence pathétique de gouvernements
“musulmans ” ou d’organisations “islamiques” comme l’UOIF d’excuses solennelles des chefs de gouvernement ) insolite
de mémoire d'Arabe, suscite bien des interrogations. Ces musulmans ignorent-ils l'enseignement coranique, qui nous incite
à transcender les polémiques? N'ont-ils pas dans le coeur le verset "et lorsqu'ils (les croyants) sont apostrophés par les
ignorants, ils disent: Paix" ? Ne savent-ils pas que le Prophète lui-même a subi les affres et les injures les plus humiliantes?
Lorsque les polythéistes de son époque le qualifiaient de fabulateur et d'imposteur, il ne leur a pas tordu le cou mais leur a

répondu: "Dieu sera juge entre nous le jour de la rétribution. " Ces musulmans ignorent-ils que l'islam, qui a traduit et
étudié les philosophies les plus athéistes et argumenté face aux idéologies les plus redoutables, destructrices et semeuses
de doutes, ne saurait trembler aujourd'hui devant un dessin caricatural et de mauvais goût ? Pourtant, une religion sûre
d'elle-même, convaincue de sa solidité, ne peut fuir les critiques et les mises en cause. Alors, comment veulent-ils que les
bases de l'islam vacillent aujourd'hui devant une futile provocation? » (8) Hier, lorsque la pensée socialiste était caricaturée
par l’image du communiste avec un couteau entre les dents, n’invitions nous pas tout un chacun à laisser la peur du rouge
aux bêtes à cornes ?
« Et que faire des caricatures ? conclut Mohamed Kacimi. Mieux vaut en rire comme le dit le Coran VIII, 30 : “Ils (les
incroyants) se moquent mais en matière de moquerie, Dieu est insurpassable” ». (9)
Dans la tradition coranique, « Dieu a 99 noms, cent moins un. Quiconque les énumère entrera dans le Paradis ; Il est le
singulier (witr) qui aime qu’on énumère Ses noms un à un » (Boukhâri, tome 8, B.12, R.12) Il est par exemple, le tout
miséricordieux, celui qui magnifie, le novateur, celui qui ouvre. (10)
Dès lors que « l’intégrisme commence quand l’homme perd le sens de l’humour »(11), Dieu pourrait être aussi le grand
humoriste.
L’incompréhension d’un tel Islam met à jour pour Soheib Bencheikh, une « autre ignorance (…) plus grave encore. Ces
musulmans ignorent-ils que la liberté d'expression la plus totale est un édifice commun à toutes les pensées, construit pour
toutes les convictions, même les plus contradictoires et inassimilables? Tout un chacun a droit de cité, qu'il soit beau ou
laid, fou ou sage, provocant ou responsable. Faut-il rappeler que c'est grâce à cette même liberté d'expression que l'islam
lui-même peut élever la voix à tout moment dans les pays démocratiques. ? Qui empêche un musulman, en France ou
ailleurs en Europe, de proposer ses valeurs? Qui entrave un croyant qui veut publier ses convictions? N'est-il pas permis à
tous les citoyens, y compris les musu1mans, de critiquer tout projet ou de promouvoir toute action? Au moment où l'islam
n'a pas bonne presse en Occident, c'est grâce à cette même liberté d'expression que nous, musulmans, pouvons nous
défendre pleinement. » (12)
Pour peu que nous inscrivions l’Islam dans des espaces-temps distincts, l’argumentaire de S. Bencheikh s’oppose point par
point à celui de H. Tincq. En premier lieu, il y a un Islam européen, qui comme véritable spiritualité dispose d’une force
interne le rendant totalement imperméable à toute caricature invariablement dérisoire . En second lieu, cet Islam a besoin de
la plus grande liberté d’expression pour pouvoir continuer de se développer, s’enrichir, mais aussi pour être en mesure de
se défendre lorsqu’il est stigmatisé. En cette dernière occasion, cet Islam européen pourrait, avec d’autres, sauver cette
liberté d’expression quand l’“opinion” n’est plus qu’invective, quand cette liberté selon des mots prêtés à Bertolt Brecht, se
dissout d’elle même dès qu’elle sombre dans la haine raciale.
De la sorte, la double incompréhension n’est plus seulement celle de quelques musulmans : dans notre seul espace-temps,
elle est bien plus large. Sa mise à jour conduit tout aussi bien à récuser avec force, ici, ces appels un peu nauséabonds, à
protéger, encourager, aider les porteurs d’un Islam modéré, et là, la possibilité de caricaturer les tenants d’un Islam
européen, en «supplétifs (…) dans un avatar pasteurisé, clean de Radio Mille Collines». (13)
Quid dès lors d’une limitation responsable de la liberté d’expression, d’une autocensure, d’une limitation non pas relative à
une question religieuse in abstracto mais qui viendrait s’inscrire - en se surajoutant - dans un procès récent de limitations
successives de la liberté d’expression ? (14)
De cet Islam européen en devenir autonome, de cet Islam théologique inscrit dans un espace distinct de ceux où prévalent
soit les valeurs théocratiques réactionnaires du wahhabisme, soit celles récentes des divers islamismes, de cet Islam
singulier ne se déduit pas pour autant, une communauté musulmane d’Europe ou de France.
« Le terme de communauté désigne un groupe d'individus vivant, de façon plus ou moins ouverte ou fermée, à part du reste
de la société (distance spatiale), et à part également du mode de vie de cette société (distance culturelle). Vis-à-vis de cette
définition, il est déjà clair que les musulmans européens constituent tout au plus une communauté idéale, et non réelle :
même s’ils ont des références culturelles communes, et même s'ils se rassemblent en certaines occasions, ils ne vivent pas
en vase clos et n'ont pas des moeurs fondamentalement distinctes des autres Européens. Contrairement à la représentation
dominante, y compris chez les politiques, le musulman n'habite pas toujours en banlieue ou dans le Londonistan, et même
s’il y habite, son “occidentalité” l'emporte largement sur son “islamité”. » (15)
Pour Abdennour Bidar, philosophe, il n’y a pas d’un point de vue strictement sociologique, de communauté musulmane en
Europe ou en France. Tous les musulmans européens n’habitent pas en banlieue, et tous les musulmans européens n’ont pas
un même rapport à l’Islam. Peut-être sont-ils européens précisément en ce que leur rapport à l’Islam est dans ses grandes
lignes et très majoritairement, similaire à celui des catholiques, des protestants ou des juifs à leurs traditions religieuses.
« Rien, aujourd'hui en Europe, ne ressemble moins à un musulman qu'un autre musulman : certains se vivent comme
musulmans à partir de la religion, vécue d’ailleurs soit comme simple croyance ou espérance, soit activement comme
pratique, plus ou moins régulière elle-même selon les cas individuels, mais d'autres, très nombreux, se sentent musulmans
par héritage culturel au sens le plus large et non plus du tout religieux. Ceux-là tiennent à l’islam, non pas par la foi et la
prière, mais aussi bien par une éthique (valeurs traditionnelles de la convivialité, de la famille) que par des coutumes
(alimentaires, festives), ou même encore par un certain mode de participation original à la culture de consommation
occidentale (choix de produits au label "islamique", viande halal, Mecca Cola, etc.). Il n'y a plus ici de musulman type ;
nous sommes tous devenus des musulmans atypiques.» (16)

Cette culture, nous dit encore Abdennour Bidar, a radicalement muté hors de sa forme autoritaire d’origine. Elle est
devenue démocratique à travers un processus d’appropriation individuelle par chaque conscience musulmane européenne,
de la question de son identité. Cette mutation aboutit à ce qu’il désigne comme un self-islam.
« Cette construction par chacun de son identité musulmane a un nom précis dans le panthéon des valeurs universelles,
celui d'autonomie - capacité et devoir de chaque homme à se fixer ses propres règles d'action et ses propres principes
d'accomplissement. Et ce choix fait par chacun de sa propre identité islamique est l'exercice de la responsabilité la plus
haute que chaque être humain peut avoir, la responsabilité de se construire soi-même. Il assume ce que Michel Foucault
appelait le "souci de soi", cette construction de soi par soi qu’Epictète et Cicéron considéraient déjà comme le signe de la
véritable culture d’un homme. » (17)
Dans un espace donné, cette culture a ordinairement muté. Dans ces procès de construction de soi qui sont (peut-être
idéalement) ceux de cet espace, il importe peu de recourir à des références islamiques, chrétiennes, judaïques ou
areligieuses. Dans de tels procès, l’élément islamique n’est plus singulier mais particulier. Il n’est plus hétérogène, mais
rendu homogène dans un travail, dans en un accouchement d’une construction de soi socialement située. L’Islam, cet Islam
n’est plus une différence d’être, mais est devenu, ou tend à devenir une simple différence d’existence parmi d’autres.
Qu’est-ce qui nous empêche dès lors de voir cette réalité sociale établie ? Qu’est-ce qui nous la dissimule alors même que
ce qui devrait susciter notre étonnement, notre incompréhension serait au contraire que des musulmans inscrits dans le
même espace social que nous, parviennent à échapper à un destin commun ? Que des musulmans dotés dont on ne sait
quelle qualité propre, puissent se soustraire à des procès ordinaires, soit d’affaiblissement soit de renforcement du religieux,
strictement relatifs à une temporalité sociale et à ses moments.
Pour Abdennour Bidar, deux essentialismes permettent de travestir cette réalité sociale.
« D’abord, il y a le terrible essentialisme de notre représentation occidentale de l'islam : nous n'avons pas extirpé de notre
imaginaire d'anciens impérialistes la vision de ces sociétés musulmanes d'Orient vivant un islam monolithique où tout le
monde priait, jeûnait, se voilait, aimait et mourait selon les mêmes règles (y avait-il d'ailleurs, on peut se le demander, une
telle uniformité dans ces sociétés ?). Nous continuons à partir du préjugé que l'islam est par nature un système holiste, une
religion communautaire, imposant une loi collective. C'est pourquoi, bien qu'ayant sous les yeux un "self islam", nous
demeurons dans l’incapacité culturellement entretenue de le voir et de le prendre en considération. » (18)
Depuis un peu plus de trente ans, le procès de décolonisation est pour l’essentiel achevé et nous ne pouvons qu’être
interrogés par le recours fréquent aujourd’hui, à cet élément explicatif du colonialisme.
D’un simple point de vue “pratique”, on ne voit pas très bien comment une conception colonialiste qui aurait survécu de
façon massive à d’intenses chamboulements idéologiques durant ces trente dernières années, pourrait jamais être combattue
et annihilée. Par contre, nous pouvons imaginer comment différents « camps » en présence vont pouvoir, en interaction
(rôle positif / négatif), produire à nouveau le colonialisme comme une métaphysique déterminante.
Dans ce moment qui est le nôtre, cette tentative d’explication est socialement abstraite. Il ne suffit pas de tenter de lui
donner une pertinence, en évoquant à l’infini, un passé qui ne passe pas ou les cadavres dans le placard. Poser socialement
la question de cette cécité collective sur ce self islam, c’est se demander qu’est-ce qui dans ce moment particulier, c’est à
dire à la différence simplement des années 70, 80, tend à produire l’idée d’une communauté musulmane, et d’une
communauté musulmane menaçante.
Pour peu qu’une telle question soit fondée, les enjeux en seraient considérables : l’essentialisme dénoncé à juste titre ici,
serait moins un résidu historique, qu’une production sociale en cours, qu’un horizon malheureusement probable.
« Ensuite, (…) il y a la façon dont les musulmans eux-mêmes, en dépit des changements qui s'opèrent dans leur propre
rapport à l'islam, ont intériorisé l'image d'une communauté homogène, régie par les mêmes règles et unie autour des
mêmes représentations religieuses. La plupart persistent à entretenir le mythe fondateur d"'un seul vrai islam". Dès qu’on
ose parler de remise en question individuelle de la charia (loi religieuse) et d'interprétations plurielles du Coran, c'est la
levée de boucliers: "l'islam n'est pas à la carte" ; "l'islam ne saurait être qu'un, le même pour tous, dogme unique énoncé
par le Dieu unique". Même les musulmans ayant, de fait, un rapport très libre aux prescriptions de l'islam traditionnel,
restent souvent persuadés qu'en droit on ne touche pas au sacré: dissociation totale, chez la plupart, entre théorie
(dogmatique) et pratique (libérée). » (19)
Les musulmans – les soumis à Dieu – présents depuis trois générations ou plus sont inscrits dans un long procès. Il n’est
aisé pour personne, de passer d’une culture de groupe, de valeurs communes et d’un système d’allégeances contraignant
mais protecteur, à une culture individuelle, à l’autonomie. L’Islam culturel est dans une phase transitoire. L’entretien du
mythe d’un seul vrai Islam est une forme de fidélité à ce qui s’en va, à ce qui disparaît.
Alors qu’il ne nourrissait guère d’illusions sur sa “communauté”, Albert Camus disait qu’ils reconnaissait les siens à
l’envie de rire qu’il le prenait lorsqu’il les rencontrait n’importe où dans le monde. Demeure ici le souvenir ou une
nostalgie d’une ancienne appartenance commune. Elle engendre une proximité affective plus grande avec quelques uns,
une reconnaissance plus rapide entre anciens … pieds-noirs, kabyles, chaouis ou soixante-huitards ! Mais sans illusion, tant
il est clair – ou devient clair très rapidement - que cette proximité est sans avenir parce que sans existence sociale.
Donnée transitoire, cette fidélité dans l’idée permet des avancées en pratique, qui sont aussi des arrachements.
De plus en considérant la grande masse des travailleurs immigrés des années 60-70 et de leurs descendants, il pourrait être
possible de penser que les deux essentialismes repérés par Abdennour Bidar ne sont pas de même niveau. L’un pourrait
facilement apparaître comme le produit d’instances idéologiques dominantes, l’autre comme la forme résiduelle d’un long
procès d’adaptation d’une minorité ethnique.

Mais ce second essentialisme est posé comme problème au même titre que le premier. Or tout comme dans le premier cas,
en ce qui concerne le recours explicatif au colonialisme, on ne peut que s’étonner que cette fidélité résiduelle à un seul vrai
Islam fasse problème aujourd’hui quand hier, les chocs idéologiques, affectifs, vécus par la première génération à son
arrivée en France n’ont inquiété que peu de monde. Personne alors pour se soucier de leur compatibilité culturelle, ou d’une
éventuelle incompatibilité. Ces premiers immigrés devaient, à n’importe quel prix – et le prix fut souvent élevé –
s’adapter : point barre.
Cela étant, cette fidélité dans l’idée à un seul vrai Islam, a aujourd’hui, dans notre seul espace, un destin …ouvert. Ou
encore, ici aussi, ce second essentialisme pourrait être une forme à venir, plutôt qu’une forme résiduelle. Il ne sera alors en
aucun cas le résultat naturel d’une évolution des musulmans de France dont nous savons ne serait-ce que de manière
critique qu’il pourrait être tout autre. Il sera le produit idéologique d’une interaction entre différents camps dépassant les
clivages religieux autour d’une question sociale absente.
« Il faut donc de toute urgence extirper de l’imaginaire collectif la représentation d’une “communauté musulmane”, qui
serait un Etat dans l’Etat, ou tout au moins un groupe fermé en décalage avec le grand groupe social. C’est de ce colossal
préjugé sociologique que surgit le thème de la “discrimination positive ” : se figurant que les musulmans forment une
entité sociale distincte, soudée en un bloc homogène par les mêmes croyances et les mêmes moeurs, on se croit obliger, par
respect pour cette différence jugée si radicale, de lui accorder des droits spéciaux adaptés à son mode de vie. Or c'est
justement avec de la discrimination positive, et en laissant se développer une société pluriculturelle, où les groupes sociaux
sont jugés trop différents pour les rassembler sous les mêmes règles, que l'on créera inévitablement une communauté
islamique repliée sur elle-même ! L'idée de "communauté musulmane européenne" est un concept sociologiquement vide:
si les politiques cherchent des interlocuteurs musulmans, si les sociologues et les journalistes veulent mener une enquête de
terrain, qu'ils arrêtent de vouloir trouver en face d'eux une pseudo-communauté regroupée à l'écart et vivant selon des
mœurs étranges, une tribu avec à sa tête des "califes représentants". Sortons donc de ce type de vision postcolonialiste où
le musulman d'Europe reste un "indigène importé" auquel il faut offrir les conditions de vie spéciales que son “islamité”,
assimilée à une essence intangible, à une forme unique, est censée réclamer. » (20)
Quand tous les musulmans n’habitent pas la banlieue, ou quand tous les musulmans n’appartiennent pas tous au même
niveau de l’échelle sociale, le destin de la fidélité dans l’idée à un seul Islam est doublement ouvert. Il est de façon générale
en ce sens qu’il peut ou non être produit pour les temps qui viennent comme essentialisme. Il est également à un niveau
particulier, quand des existences sociales plus ou moins en crise peuvent ou non générer une fidélité en acte à cet Islam
unique.
La destinée sociale d’un médecin, d’un professeur d’université, d’un entrepreneur musulman, pieds-noirs, … n’est pas dans
notre espace-temps, celle d’un chômeur musulman, pieds-noirs, … vivant en banlieue. Plus que jamais, les communautés
affectives sont illusoires, sans avenir, ou encore dans cette configuration comme dans d’autres moins difficiles, se
manifeste la puissance révolutionnaire du capitalisme qui défait toutes les anciennes allégeances, plus sûrement que
n’importe quel travail idéologique. En contrepartie, personne ne peut s’abstenir de répondre en pratique et ne serait-ce que
par défaut à la question sociale telle qu’elle se pose aujourd’hui.
Il est trop simple d’attribuer seulement à des politiques, à des journalistes majoritairement “autochtones ”ou véritablement
indigènes la recherche des représentants d’une « communauté musulmane » ou des interlocuteurs nécessaires à la mise en
place d’une discrimination positive.
Il faut le redire avec force, la discrimination positive s’accorde d’un état des inégalités sociales. Elle vise seulement à les
répartir plus équitablement par rapport à des critères ethniques.
La première génération d’immigrés a été employée massivement dans la métallurgie, les mines et l’industrie automobile
frappées de plein fouet, dès les années 80, par des licenciements massifs. L’histoire relativement récente de l’immigration,
et la mise en place d’un capitalisme archaïque ont pour résultat logique une proportion de musulmans plus forte dans les
classes défavorisées. Le rétablissement artificiel, ou en tous les cas son idée, d’une équité ethnique présuppose la
construction ou reconstruction idéologique d’une ethnicité. Il serait vain ici, de ne pas tenter de comprendre que cette
essentialisation à venir n’est pas le seul fait des “racistes” ou encore d’intellectuels approximatifs. Bien au contraire, des
alliances contre-nature peuvent se nouer, des interactions entre musulmans et non-musulmans se mettrent en place.
Ici, pour quelques uns, dans une simple négation du racisme à l’embauche, il y a des places à prendre dans le cadre d’une
raréfaction du travail (on imagine sans peine, les effets pervers en termes de racisme “petits blancs ”). Mais surtout là, il y a
des places de “califes représentants ” qui s’ouvrent. Et elles se présentent car la question sociale est de plus en plus dure,
que la question du maintien d’un ordre social se fait plus aiguë, et que l’une des possibilités de répondre à cette dernière est
d’avoir des relais dans ce qui pourrait être produit comme communauté avec à nouveau une culture collective s’imposant
au groupe.
Rachid Amirou, professeur de sociologie, écrit : « La véritable caricature a consisté à agresser la complexité, l'intelligence
et la nuance qui doivent guider toute oeuvre de pensée. En cela ces caricatures renvoient à une vulgarité de pensée; cette
misère intellectuelle ne peut en aucun cas se draper de l'habit de la "liberté d'expression". Le simplisme, maladie infantile
du néoconservatisme comme de l'islamisme, tel est le véritable fléau du siècle. » (21) Nous pourrions ajouter que le Charlie
Hebdo qui s’est vendu à quatre cent mille exemplaires n’a pas grand chose à voir avec le Hara Kiri censuré pour avoir titré
à l’occasion de la mort du général de Gaulle : « Bal tragique à Colombey les Deux Eglises : Un mort ».
Il est dans ce pays, suffisamment d’esprits fins pour déjouer de telles caricatures, mais sans qu’à l’évidence cela ne suffise.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%