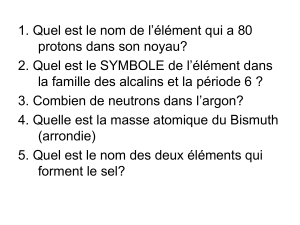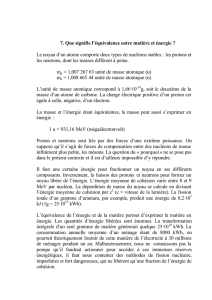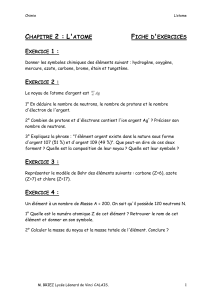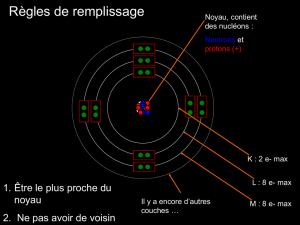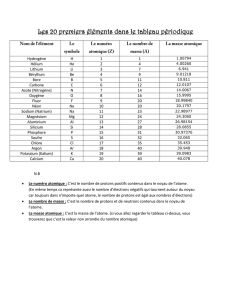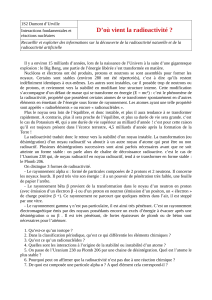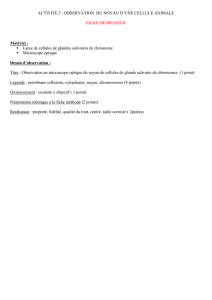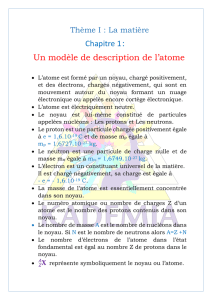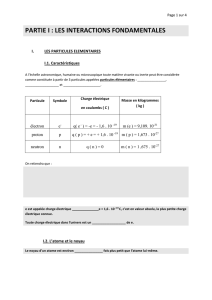Chapitre 5 LE NOYAU ET LA RADIOACTIVITE

1 / 5
Chapitre 4 LE NOYAU ATOMIQUE ET LA RADIOACTIVITE
I - INTRODUCTION HISTORIQUE
- Un jour de 1896, Henri Becquerel range dans son armoire un
sachet de sels d'uranium à coté d'une plaque photographique
vierge. Quelques jours plus tard, il retire la plaque et il la
développe. Il constate que la plaque photo est impressionnée sans
avoir été exposée à la lumière. Après avoir renouvelé cette
expérience, il en conclut que l'Uranium émet un rayonnement
spontané qu'il nomme "rayons uraniques".
- En 1898, Marie Curie découvre que la pechblende, un minerai
d'uranium, émet davantage de rayonnements que l'uranium lui-même. Elle
en déduit que ce minerai contient, en très petite quantité, un ou plusieurs
éléments beaucoup plus actifs que l'uranium. A l'aide de son mari Pierre
Curie, et après deux ans d'effort, elle parvient à isoler deux nouveaux
éléments : Le Polonium (baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie) et
le Radium. A cette occasion, Marie Curie inventa le mot "radioactivité".
- En 1897, Thompson découvre le premier composant de l'atome :
l'électron, particule de charge électrique négative.
En 1904, il propose un premier modèle d'atome, surnommé depuis "le
pudding de Thompson". Il imagine l'atome comme une sphère remplie
d'une substance électriquement positive et fourrée d'électrons négatifs.
- En 1912, Rutherford découvre le noyau atomique. Son nouveau modèle
d'atome montre que sa charge électrique positive, ainsi que l'essentiel de sa
masse, est concentrée en un noyau quasi-ponctuel.
Les électrons de l'atome se déplacent autour de ce noyau. La force électrique
attractive du noyau sur les électrons joue le rôle de la force de gravitation
pour les planètes ; d'où le nom de modèle d'atome planétaire.
A noter que contrairement à l'atome des Grecs, celui de Rutherford n'est ni
indivisible, ni plein puisqu'il contient essentiellement du vide.
L’expérience célèbre qui lui permit de
déterminer la taille du noyau utilisait des
particules alpha positives dont il bombardait
une mince feuille d’or. Les particules étaient,
pour la plupart, non déviées par les noyaux
d’or. La distance noyau-électrons est 105 fois
plus grande que le diamètre du noyau.
(Diamètre de l’atome = 10-10 mètre ;
diamètre du noyau = 10-15 mètre = 1 Fermi).
Particule alpha noyau d’or

2 / 5
II - LE NOYAU ATOMIQUE
III - L’ISOTOPIE
235 238
Noyau d’uranium 235 U Noyau d’uranium 238 U
92 92
A Nombre de nucléons (ou de masse)
Notation du noyau X symbole
Z Numéro atomique
Noyau de
Sodium
11 protons positifs
Z = 11
12 neutrons neutres
N = 12
Soit 23 nucléons :
A = Z + N = 23
1 2 3
Noyau d’hydrogène H Noyau d’hydrogène H Noyau d’hydrogène H
1 1 1
Des noyaux isotopes ont le même numéro atomique Z mais des nombres de neutrons différents.
Ils ont donc des nombres de masse, A, différents.
Quelle est la composition des noyaux isotopes 235U et 238U sachant que l’uranium a le numéro
atomique Z = 92 ?
92p,92e-,143n
92p,92 e-, 146n
1 2 14
Noyau de carbone 12 C Noyau de carbone 14 C
6 6

3 / 5
IV – STABILITE DU NOYAU
Tous les noyaux ne sont pas stables. Certains se désintègrent, au bout d’un temps plus ou
moins long, par radioactivité, en émettant des rayonnements de plusieurs sortes, plus ou
moins dangereux. On constate que les noyaux stables peuvent être groupés autour d’une ligne
dans le diagramme N = f (Z).
V – LA RADIOACTIVITE
La radioactivité affecte les noyaux placés hors de cette ligne, appelée vallée de la stabilité. On
peut distinguer ceux qui sont au dessus de la vallée de stabilité, comportant donc un nombre
trop grand de neutrons, ceux qui se trouvent au dessous de la vallée de stabilité, comportant
donc un nombre trop grand de protons, et ceux qui sont trop gros, comportant à la fois trop de
protons et trop de neutrons.
Ces trois situations vont donner lieu à trois types de radioactivité différentes, la radioactivité
, la radioactivité + et la radioactivité -.
Chaque type de radioactivité conserve le nombre de nucléons et le nombre de charges.
A A1 A2
X = X1 + X2 avec A = A1 +A2 et Z = Z1 + Z2
Z Z1 Z2
Nombre de
protons
Numéro
atomique Z
Nombre de
neutrons
N = A - Z

4 / 5
Electron
La radioactivité
nucléaire
60 60 0
Co Ni + e
27 28 -1
28Ni
27Co
Positon ou
antiélectron
La radioactivité
nucléaire
30 30 0
P Si + e
15 14 +1
15P
14Si
La radioactivité
nucléaire
222 218 4
Rn Po + He
86 84 2
Noyau
d’hélium
86Rn
84Po
La radioactivité n’est pas une désintégration du noyau avec changement de son
identité mais une simple désexcitation, suivant parfois les désintégrations , + ou -.

5 / 5
Certains noyaux, beaucoup trop instables, nécessitent de nombreuses désintégrations avant de
parvenir à un noyau stable. Ils engendrent une famille radioactive dont le schéma ci-dessous
est un exemple célèbre.
FAMILLE RADIOACTIVE DE L’URANIUM 238
Désintégration
Désintégration
-
Matériaux de la
croûte terrestre
238
U
234
Th
234
Pa
234
U
4,47.10
9
ans
24,1 jours
1,17 min
2,46.10
5
ans
-
-
230
Th
7,54.10
4
ans
4,2 Mev
4,8 Mev
4,7 Mev
226
Ra
1600 ans
4,8 Mev
Gaz Radon
Descendants solides pouvant
se déposer dans les poumons
Fin de la série : plomb stable
214
Pb
214
Bi
214
Po
3,05 min
26,8 min
19,9 min
1,65.10
-
4
s
-
-
6 Mev
7,69 Mev
218
Po
222
Rn
3,82 jours
5,5 Mev
210
Pb
210
Bi
210
Po
22,2 ans
5,01 jours
138 jours
-
-
5,3 Mev
206
Pb
stable
1
/
5
100%