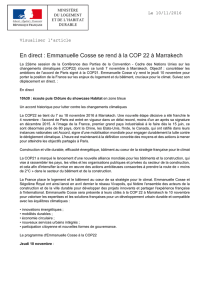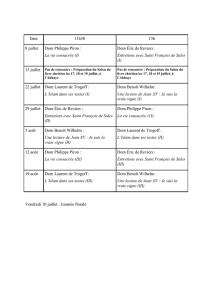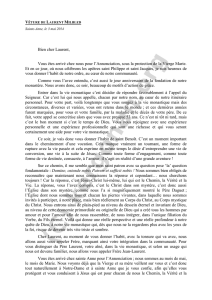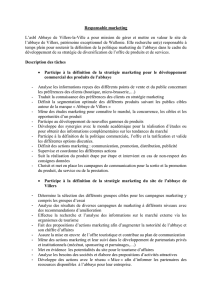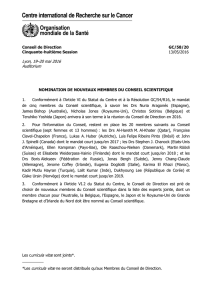Jean Mathys - Les Amis de Saint

1
Jean* Mathys : de Westmount à Saint-Benoît-du-Lac
Jean Mathys naquit à Montréal le 20 mars 1908, le troisième d’une famille
de cinq enfants. Son père, François-Benoît Mathys, était originaire de
Bruxelles. (*C'est au moment de sa profession religieuse qu'il prend le nom de Jean-Anselme.)
Après avoir fait des études en génie civil et en droit, il vint s’établir à
Montréal à l’âge de vingt et un ans. Il se spécialisa d’abord dans le
commerce du drap tout en travaillant au développement des relations
commerciales entre son pays d’origine et le Canada. Pendant une dizaine
d’années il exerça la fonction de vice-consul de Belgique à Montréal. S’étant
adapté rapidement à sa nouvelle patrie, il prit une part active à divers
organismes politiques, sociaux, scolaires et religieux.
Il avait épousé en 1898 Honorine Leman qui appartenait par sa famille à
l’élite de la bourgeoisie de Montréal. Son père était un médecin bien connu,
et elle comptait dans sa parenté des hommes qui s’étaient fait un nom dans
le monde des affaires et de la politique. Son frère, Beaudry Leman, fut
longtemps président de la Banque Canadienne Nationale. Deux de ses
grands-oncles Beaudry, les deux frères, avaient été maires, l’un de Montréal
et l’autre de Los Angeles (Californie). Elle était par alliance la cousine
d’Henri Bourassa.
On vivait à l’aise au foyer des Mathys. La maison de quatre étages qu’ils
habitaient Place Viger avait été achetée de monsieur Amable Jetté,
lieutenant-gouverneur de la province de Québec. Une demeure secondaire à
Saint-Eustache, sur les bords du lac des Deux-Montagnes, permettait à la
famille de passer les mois d’été à la campagne.
Monsieur et madame Mathys formaient un couple profondément chrétien et
soucieux d’inculquer à leurs enfants un idéal de vie inspiré de l’évangile et
de l’enseignement de l’Église. Si la réussite professionnelle était un objectif
légitime, elle ne devait jamais être atteinte aux dépens des valeurs
chrétiennes. L’aisance matérielle entraînait à leurs yeux l’obligation du
partage; ils donnèrent eux-mêmes l’exemple en aidant de nombreuses
œuvres avec une exceptionnelle générosité.

2
L’enfance de Jean fut heureuse. Aimé, choyé mais non gâté, il reçut une
forte éducation. On ne badinait pas à la maison quand il s’agissait de
l’obéissance, du respect d’autrui et des devoirs religieux. Son père, tout en
aimant bien ses enfants, remplissait son rôle de chef de famille avec une
autorité sans faiblesse. Jean, dans ses notes biographiques, le présente
comme un homme «assez sévère dans ses réprimandes mais juste, et je
dois dire qu’il a certainement contribué à me former le caractère». Sa mère,
toute bonté, sans rien sacrifier de l’essentiel, donnait à sa tâche
d’éducatrice une touche de tendresse et d’indulgence.
Le jeune Jean Mathys fit ses études primaires d’abord en
cours privés, puis à l’école Saint-Eustache des Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame. En marge de ses occupations
scolaires, il prit l’initiative, assez rare chez un jeune citadin
de cet âge, d’élever des poules – de 30 à 40 – dans un
poulailler aménagé dans l’arrière-cour de la maison.
«Avant de partir pour la classe, raconte-t-il, j’allais voir si
tout était en ordre et dès mon retour dans l’après-midi je
passais une bonne heure dans le poulailler.» Et «il fallait
que les invités de maman consentent à venir voir mes
poules s’ils voulaient avoir le privilège d’acheter mes
œufs». Déjà chez lui pointait le sens des affaires. Il acquit
ainsi très tôt une compétence d’aviculteur qui lui fut bien
utile quand, une fois au monastère, il fut chargé d’un
poulailler où les poules se comptaient par centaines. Ses
observations d’enfant attentif l’amenèrent à tirer des
conclusions aussi personnelles qu’inattendues. En effet,
plus tard il se plaira à déclarer dans ses conférences aux
Amis de Saint-Benoît qu’il «avait appris à connaître les
hommes en observant les poules dans la cour de la Place
Viger».
La situation centrale de la maison paternelle lui permit
d’assister à ces nombreux défilés et parades qui
sillonnaient à l’époque les rues au rythme bruyamment
cadencé des fanfares. Cette musique militaire l’enchantait
et le faisait vibrer d’enthousiasme. Quelque cinquante ans plus tard – en
1972 – il confiera : «Encore maintenant je préfère de beaucoup une bonne
fanfare à un récital d’orgue ou de violon.»

3
En 1921, la famille déménage à Westmount, le quartier le plus huppé de la
métropole. La même année, en octobre, Jean commence son cours classique
comme pensionnaire chez les messieurs de Saint-Sulpice au «Collège de
Montréal». Il y étudiera jusqu’en 1926. Ses succès scolaires seront
modestes; les bulletins conservés le rangent parmi les élèves moyens. Sa
mère suit avec sollicitude l’évolution morale et intellectuelle de son cher
«grand gars». Les
encouragements et les mots
d’ordre ne manquent pas. Elle lui
écrit de Saint-Eustache le 9
octobre 1921 : «Tu dois devenir
un homme instruit et sérieux qui
sache que les plaisirs et les
distractions doivent être
accidentels dans la vie et à titre
de repos pour mieux remplir les
devoirs qui en sont le but sur la
terre, préparation au grand but
du ciel.» Cette femme cultivée
déplore souvent les négligences
de son collégien en matière
d’orthographe; elle y revient
encore en janvier 1926 : «Gare
aux fautes d’orthographe…
Quatre dans ta dernière lettre,
pour un rhétoricien, c’est raide!»
Jean est alors en pension dans
un chalet de Ste-Marguerite-du-
Lac-Masson où il fait une cure de
repos et de grand air. Lui qui
jusque-là n’a jamais montré de goût pour les sports s’éprend du ski, et ses
progrès sont si rapides qu’il réussit, rapporte-t-on à sa mère émerveillée,
«cinq ou six fois le saut du Curé», une prouesse de champion, au dire des
connaisseurs.
En juin 1926, il passe avec succès les examens du baccalauréat de
Rhétorique et fait ses adieux à ses maîtres sulpiciens dont il reconnaîtra
avoir beaucoup reçu. Il restera particulièrement attaché à monsieur Léon
Pemberton, son directeur spirituel, qui l’aida à discerner la vocation à
laquelle il se sait maintenant appelé.
Au témoignage de Clothilde, la sœur aînée de Jean, il était fréquemment
question des bénédictins dans le cercle familial. Au cours d’un voyage en
Belgique, en 1900, madame Mathys avait eu l’occasion de visiter l’abbaye de
Maredsous et en avait été fortement impressionnée. Ces imposants
bâtiments néo-gothiques de construction toute récente, et surtout la vie des
moines si parfaitement réglée et uniquement consacrée à la prière et au
travail lui avaient laissé un souvenir qu’elle aimait évoquer. Cet idéal
bénédictin trouva un écho d’abord chez Clothilde qui devint oblate de Saint-
Benoît-du-Lac vers 1920 et, quatre ans plus tard, entra à l’abbaye de
Maredret. Atteinte par la maladie, elle ne put toutefois y rester que
quelques mois.

4
Jean également se sentit interpellé par l’idéal bénédictin au moment où
élève de rhétorique, il s’interrogeait sur l’orientation de sa vie. En avril
1926, il vint passer les Jours saints et la fête de Pâques à Saint-Benoît-du-
Lac. On aurait pu croire que la pauvreté de la maison et la rusticité du style
de vie des moines rebuteraient l’élégant jeune homme de Westmount, il
n’en fut rien. Il s’attacha tout de suite à cette petite communauté si
fervente dans son dénuement matériel. Il trouva aussi chez le supérieur
d’alors, dom Paul Cosse, un homme et un moine avec qui il s’entendit
parfaitement. Au cours de leurs entretiens la question de sa vocation tint
évidemment une place prépondérante. Il revint au mois d’août, et ce furent
des jours décisifs. Après avoir prié et consulté de nouveau le Père Cosse, il
écrivit à ses parents : «J’ai pris ma décision le jour de l’Assomption (15
août), je deviendrai fils de saint Benoît».
Cette décision, il ne la remit jamais en cause, même si, au cours des deux
années qui suivirent, de fortes pressions l’incitèrent à modifier son projet
vocationnel. Ses parents s’y montrèrent nettement défavorables. Non certes
pour des motifs égoïstes, ni non plus par mésestime de la vocation
bénédictine qu’ils tenaient en haute considération, mais parce qu’ils
estimaient que Jean était trop jeune et que sa santé, sans être mauvaise,
exigeaient des ménagements. Sa croissance avait été très rapide; à 18 ans,
il mesurait déjà six pieds deux pouces et son poids était loin de
correspondre à sa haute taille. De plus, le choix de la fondation canadienne
ne leur agréait guère, surtout à monsieur Mathys. Que Jean veuille entrer
dans l’Ordre de saint Benoît, il n’avait rien contre, mais il aurait préféré que
ce soit dans l’une ou l’autre de ces grandes abbayes de Belgique qui
comptaient de nombreux moines issus des meilleures familles du pays.
Finalement une solution de compromis fut acceptée de part et d’autre : les
parents de Jean ne s’opposeraient pas à son entrée à Saint-Benoît-du-Lac
pourvu qu’il se donne un délai de deux ans. Dans l’intervalle il compléterait
son cours classique par deux années au Collège Loyola dirigé par les
jésuites anglophones de Montréal. Il aurait ainsi l’avantage de se
familiariser avec la langue anglaise tout en acquérant plus de maturité et en
raffermissant sa santé.
Ce collège jouissait d’une réputation d’excellence et Jean y fit de solides
études. Il fut surtout marqué par le professeur de philosophie, le Père
Thomas I. Gasson, qui était également son directeur spirituel. Ses
condisciples, ayant vite reconnu ses qualités de leader et aussi «his
philosophical acuteness and his success as a salesman», l’élirent vice-
président de leur classe.
Si captivantes que furent ses études et ses activités sociales, elles ne lui
firent pas oublier Saint-Benoît-du-Lac. Entre avril 1926 et avril 1928, il y fit
pas moins de huit séjours de longueur variée. Et il y venait rarement les
mains vides. Son grand cœur s’ingéniait à faire don aux moines de ce que
leur impécuniosité ne leur permettait pas de se procurer. Le cadeau le plus
apprécié fut une barque qui rendit possibles d’agréables croisières sur le lac
et qui fit le bonheur du Père Bontront en élargissant le rayon de ses
expéditions de pêche.

5
Une vocation contrariée
En accord avec le Père Cosse, l’entrée de Jean au noviciat, au terme de ses
études au Collège Loyola, avait été fixée à l’automne 1928. Avant qu’il ne
quitte le monde, ses parents avait jugé bon de lui offrir un voyage de
quelques semaines en Europe. Son père lui-même l’accompagnerait et ils
visiteraient ensemble l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie et surtout
la Belgique où monsieur Mathys avait une nombreuse parenté.
Tout s’annonçait pour le mieux quand une lettre du Père Cosse datée du 6
mai assombrit les esprits en révélant que la communauté traversait une
crise majeure et que la survie de la fondation était sérieusement menacée
(cf. «L’Ami», no. 98, p. 9-11). La réaction de monsieur Mathys en apprenant
cette nouvelle fut radicale. Déjà indisposé par l’affaire de la Villa et l’échec
de Clothilde, il refusa tout net l’entrée de son fils dans ce monastère en
perdition; s’il voulait devenir bénédictin ce devrait être ailleurs que là. Pour
Jean, il n’était pas question de passer outre au veto paternel, ni non plus de
renoncer à sa vocation. Ces semaines en Europe qu’il aurait voulu vivre en
toute tranquillité d’esprit allaient être chargées de lancinantes
préoccupations vocationnelles.
Débarqués en Angleterre au début de juin,
ils passèrent quelques jours à l’abbaye de
Downside où, note-t-il, «Papa aurait voulu
que j’entre à cause de la grande largeur de
vues et des conditions sanitaires
excellentes ainsi que de l’exercice
physique». Lui-même s’entretint avec la
Père Abbé, dom Leander Ramsay, qui
l’assura qu’il était prêt à l’accepter comme
novice tout en étant d’avis que sa place
serait plutôt dans la fondation canadienne
malgré les difficultés du moment car,
concluait-il, «where is the fire there you
must fight». Ce conseil cornélien ne dut
pas effaroucher Jean et il l’aurait sans
doute suivi s’il n’en était tenu qu’à lui.
Quelques semaines plus tard, de passage à
Paris, les voyageurs rencontrèrent le Père
Cosse qui venait de rentrer du Canada et
leur apportait des nouvelles toute fraîches
de Saint-Benoît-du-Lac. La situation s’y
était encore aggravée et le noviciat avait
été fermé; à moins d’une intervention
vigoureuse de l’abbaye fondatrice de Saint-
Wandrille – d’ailleurs improbable – la communauté allait se dissoudre. Ce
constat persuada encore davantage monsieur Mathys que seul un
monastère aussi dynamique que Saint-André de Bruges pourrait assurer le
renflouement de la fondation. Tout à son idée, il prit l’initiative d’aller en
conférer avec la Père Abbé de ce monastère, dom Théodore Nève.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%