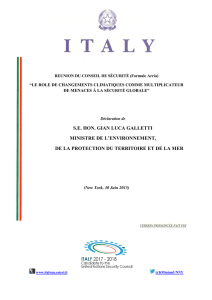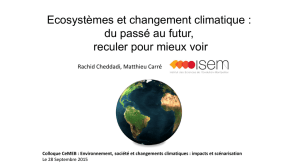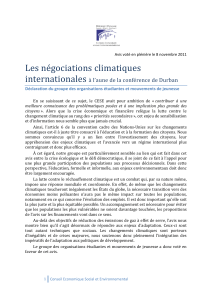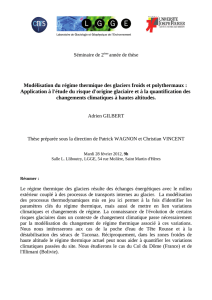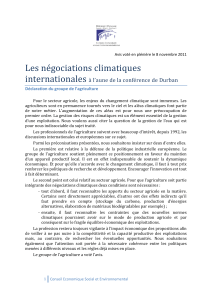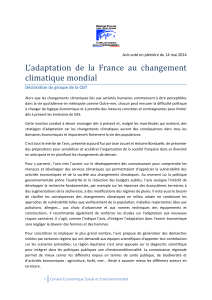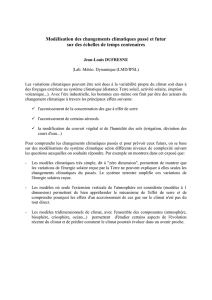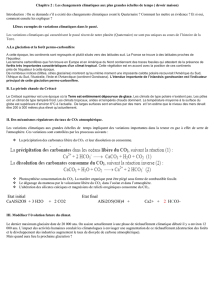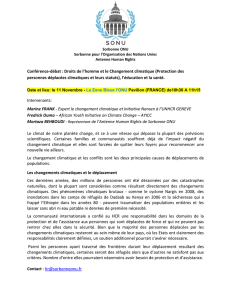et Formation(s)

I.R.D (Institut Recherche Développement)
www.ird.fr
Siège social : Le sextant-44, boulevard de Dunkerque-Marseille
Direction du Système d'Information
Service ”Informatique scientifique et Appui aux Partenaire du Sud”
Appel à projets interne
SPIRALES 2011
Formulaire de demande DSI-SPIRALES
« Soutien aux Projets Informatiques dans les Equipes Scientifiques »

Page 2 sur 11
Demande d’un soutien DSI sur les projets informatiques des UMR/UMI/LMI et
leurs partenaires.
Formulaire de demande DSI-SPIRALES 2011
« Soutien aux Projets Informatiques dans les Equipes Scientifiques ».
Les propositions doivent être adressées sous forme électronique (au format RTF, DOC
ou PDF) à l'adresse suivante : [email protected]
1. Nature du projet
1.1. Titre du projet
Une plate de modélisation de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes pour l’études changements
globaux : SIERRA (Simulator for tERRestrial lAndscapes)
1.2. Résumé du projet proposé (5 lignes maximum)
Les différents projets engagés sur la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes méditerranéens ont abouti au
développement d’outils d’analyse et de modélisation indépendants. Ces modules incluent le downscaling des scenarios
climatiques, leur utilisation dans les modèles de flux d’eau et de carbone (CO2, composés volatils organiques), ainsi
que les processus spatialement explicites comme la propagation des incendies ou les changements dans l’utilisation
des paysage. Nous proposons ici la création d’une plateforme de modélisation incluant tous ces modules.
1.3. Type de projet
(préciser année de démarrage : …)
2. Porteur(s) et collaborateur(s) du projet
2.1. Unité
UMR UMI LMI N° … Nom : unité sous contrat :CEFE
2.2. Département
Environnement & Ressources Santé Sociétés
2.3. Statut et coordonnées du porteur de projet
Prénom Nom – Statut / Catégorie – Localisation géographique – Téléphone – Fax – E-mail
Florent MOUILLOT, CR1, UMR CEFE, equipe IRD-DREAM, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier Cedex 5, France.
Tel : 04 67 61 32 55 / email : florent.mouill[email protected]

Page 3 sur 11
2.4. Nom et coordonnées du Directeur d'Unité (si différent)
Nom prénom - Statut / Catégorie – Localisation géographique – Téléphone – Fax – E-mail
2.5. Avis du directeur d'unité (obligatoire)
Le DU doit notamment être garant de l’esprit de SPIRALES (capitalisations de l’ outil développé et des savoir faire acquis, pour d’autres équipes
et/ou partenaires), et libérer ainsi un peu de temps de son équipe, après le projet.
Je ne fais pas partie d UMR IRD reférencée mais d une unité sous contrat, UMR CEFE/CNRS; montpellier.
Cette demande répond à une forte demande des partenaires et à un accumulation de travail conséquente sur la
modélisation des processsus écologiques qui doit etre valorisé par un outil transférable.
2.6. Site(s) de déroulement du projet
UMR CEFE, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier cedex 5, France
2.7. Site administratif à partir duquel se feront les dépenses budgétaires
Montpellier
2.8. Liste des unités (ou organismes partenaires) du projet
Organisme (laboratoire/unité) – Directeur - Localisation géographique
UMR CEFE, JD Lebreton, Montpellier, France
Ecole national des ingénieurs de Tunis, Tunisie
INRGREF, Tunis, Tunisie.
DGRE, Tunis, Tunisie
Université de la Manouba, tunis, Tunisie.
Université federal de Lavras, Lavras, Brazil.
2.9. Liste des intervenants impliqués de manière effective dans la réalisation du projet
Prénom Nom - Statut / Catégorie – Organisme (unité/laboratoire) - Localisation géographique - Email – Contribution
en % de temps homme ou en jours*homme (ETP total ou pour une période)
Florent MOUILLOT, CR1, IRD UMR CEFE, Montpellier, [email protected], 40j ETP
Serge RAMBAL, IR1, CNRS UMr CEFE, Montpellier, serge.rambal@cefe.cnrs.fr, 15j ETP
Hedia CHAKROUN, ENIT, tunis, hedia.chakroun, Hedia.Chakroun@enit.rnu.tn, 15j ETP
Hayet BEN MANSOUR, DGRE, Tunis. 4j ETP.
Joao Paulo DELFINO BARBOSA, UFLA, Brazil. 15, ETP.

Page 4 sur 11
3. Moyens / appuis demandés à la DSI
3.1 Contribution demandée à la DSI pour 2011 en euros HT
Montant 2011 demandé : € HT et % temps-homme ou jours*homme :
Ventilation par poste
prestation de service (dont stage) :
fonctionnement :
formation et valorisation (cf chapitre 7) :
appui d’un chef de projet de l’équipe IS (en % de tps-homme ou en jours*homme)
X appui d’un développeur de l’équipe IS (en % de tps-homme ou en jours*homme) : 60% tps homme.
La contribution demandée pourra être soit un développeur de l equipe IS, soit une compensation financière afin
d’employer un développeur externe. Le cout emploi sera partagé avec les programmes FUME, CLARIS et SCION dans
lequel des jours.hommes sont déjà prévu pour le développement et l’application de cette plateforme.
3.2 Montant(s) précédemment attribué(s) par la DSI - en euros HT
2008
2009
2010
Montants attribués (€ HT)
3.3 Moyens affectés au projet et Cofinancements acquis hors SPIRALES (€ HT)
Autres sources de financements acquis pour ce projet (ex. ANR…) : Montant (€ HT) :
Programme minsitere affaires étrangères : CORUS : 60.000€, 2007-2011
Programme ANR mesoeros : 53.000€, 2007-2010
Programme EU CLARIS-LPB : 65.000€, 2009-2011
Programme EU FUME : 205.000€, 2010-2013
Programme European Space Agency : 60.000€, 2010-2013.
Programme ANR SCION, 53000€, 2010-2012.
4. Description des besoins et du projet
4.1. Objectifs scientifiques (en précisant les aspects innovants)
L’étude de l’impact des changements globaux sur les agro-systèmes et les écosystèmes est une priorité de l’IRD, et
constitue un champ de recherche prépondérant dans les questionnements scientifiques actuels. L’objectif est de
comprendre comment une modification dans le système climatique et socio-économique va modifier les rendements et
les pratiques agricoles, la qualité des sols associés, le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes et leurs
services (ressources en eau, pâturage, forets..), avec les rétroactions potentielles sur le bilan de carbone
atmosphérique régional ou global. Depuis 2003, je suis engagé dans des activités d’analyse de série climatiques, de

Page 5 sur 11
scenarios climatiques simulés par les modèles de circulation générale, la compréhension de la variabilité régionale du
fonctionnement des écosystèmes et la modélisation de ces processus. Ces recherches m’ont amené à développer des
outils informatiques indépendants sur plusieurs thématiques :
i) L’analyse et la création de scenarios climatiques régionaux : Les modèles de circulation générale (GCM)
fournissent des séries temporelles climatiques journalières à une résolution spatiale variant de 50km a
250km pour un scenario référence REF (hypothèse de concentration en CO2 atmosphérique 360ppm) et
un scenario futur (FUT)(hypothèse de concentration atmosphérique en C02 à 720ppm). Le scenario
référence, à cause de la résolution spatiale assez grossière, est souvent différent des observations au sol.
Les méthodes classiques d’utilisation de ces scenarios climatique est donc le calcul d’anomalies entre les
scenarios REF et FUT, et d’appliquer ces anomalies sur les données réelles au sol. Pour les anomalies,
elles consistent en des variations de moyennes et d’écart type quotidiens. Pour les précipitations, les
anomalies peuvent être plus complexes qu’une simple différence de l’intensité des précipitations, mais
aussi inclure des différences dans la fréquence des événements. Dans le cadre du programme ANR
MESOEROS piloté par l’UMR IRD LISAH, nous avons développé une méthode générique permettant de
produire des scenarios spatialisés et utilisable dans les modèles d’érosion, de rendements agricoles ou de
fonctionnement des écosystèmes. Cette méthode, associée à une spatialisation automatique des
informations climatiques stationnelles, est en cours de valorisation auprès de la DGRE Tunis dans le cadre
du programme CORUS. L’outil a été développé sous MATLAB. Il est en cours d’utilisation dans le
programme européen FUME et le programme européen CLARIS pour application en Amérique du Sud
auprès de nos partenaires.
ii) La modélisation de la dynamique et du fonctionnement des écosystèmes : J’utilise dans mes projets
différents modèles de bilan eau et C dans les écosystèmes : un modèle local dynamique (SIERRA, Mouillot
et al. 2001, 2002, développé en Pascal) et un modèle global fonctionnel (CASA, Potter et al. 1995,
développé sous matlab). Ces deux modèles utilisent le bilan en eau des écosystèmes, les températures et
le rayonnement solaire pour simuler les facteurs de contrôle du bilan de carbone, la dynamique de la
biomasse et du carbone du sol. Ils utilisent différents modules de bilan hydrique du plus simple et plus
générique (CASA), au plus complexe (Ruffault and Mouillot, in prep). Ces modèles permettent de simuler la
variabilité saisonnière et interannuelle des flux et stocks d’eau du sol et de carbone, les échanges biosphère
atmosphère et les potentiels services écosystémiques associés à différentes échelles, du paysage au
globe. Ils sont en cours d’utilisation dans les projets FUME, CLARIS et ESA, et nécessitent les entrées
climatiques issues du précédent outil sur les scénarios climatiques.
iii) Flux latéraux et dynamiques spatiales : les modifications dans le fonctionnement des agro écosystèmes au
niveau régional est aussi associé aux modifications de l’occupation du sol, qui modifient les processus de
flux d’eau et de carbone selon les types fonctionnels des espèces en présence. Cette dynamique spatiale
est régie par les pressions anthropiques d’utilisation du sol (dont le Modèle CLUE fait référence), les
processus de colonisation par dispersion et installation des espèces, et la propagation des perturbations
comme les incendies. Ces modules sont aussi développés (langage pascal) de manière indépendante afin
de simuler des scenarios d’occupation du sol à insérer dans les modèles de fonctionnement de la
végétation.
iv) Enfin nous avons développé, pour des thématiques précises, les processus d’émission de composés
volatils organique émis par la végétation et qui interagissent avec les NOx atmosphériques pour générer de
l’ozone, fort polluant atmosphérique, les processus de pâturage sur la biomasse herbacée, ou les attaques
d’insectes sur les feuillages forestiers.
Nous sommes donc maintenant confrontés à un panel d’outils de modélisations, indépendants et codés sous
différents langages, avec lesquels nous devons jongler pour les faire interagir pour répondre à des questions socio-
écologiques ou atmosphériques. La transmission de ces outils est donc ralentie, et souvent impossible du fait de la
multitude de logiciels à acquérir pour utiliser l’ensemble des outils. Nos multiples projets en cours nécessitent
maintenant le couplage de tous ces processus afin de proposer des scenarios intégrant le maximum de processus
identifiés, et au sein d’une plate forme dans laquelle nous pourrons inclure nos propres développements ainsi que
les requêtes particulières des partenaires. Le programme ANR SCION, est lui-même un programme ANR de
couplage de nos modèles avec les modèles de nos partenaires CEFE/CNRS, montpellier, et applications en
Tunisie. Ce projet SPIRALE bénéficierait donc de la synergie impulsé par de programme ANR de mise en plate
forme des modèles de végétation.
7.2. Adéquation du projet avec la philosophie de SPIRALES (cf “SPIRALES_Notice.doc”)
Le projet que nous proposons pour l’appel d’offre SPIRALE est le fruit de 5 années de développement de modules au
gré des projets où nous sommes impliqués, des demandes de nos partenaires, et des disponibilités de ressources
humaines dont nous disposions. La nécessité de capitaliser ce savoir apparait maintenant dans la demande de
formation des différents modules qu’il est difficile d’assurer avec la dispersion des modules développés jusqu’à présent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%