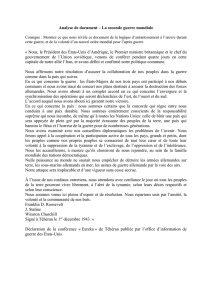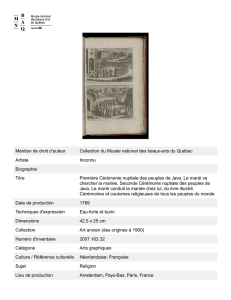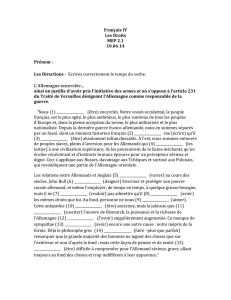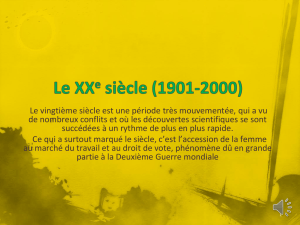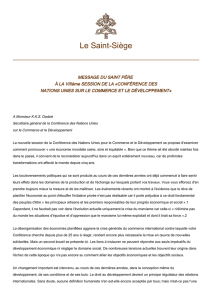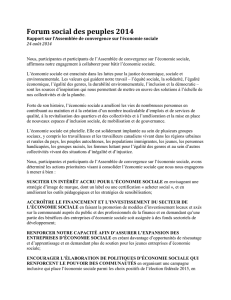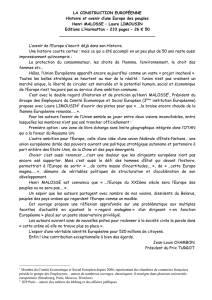L`Autriche-Hongrie

Mathilde L’Hour Vendredi 26 mars 2004
Conférence d’histoire de Mme Larrère
1
L’Autriche-Hongrie :
Prison des peuples ?
« Nous Slaves, nous accueillerons le dualisme
avec une douleur sincère, mais sans crainte. Nous
avons existé avant l’Autriche, nous existerons
encore après elle. »
Palacky, chef du parti national tchèque,
L’idée de l’Etat Autrichien, 1865
L’Empire austro-hongrois naît le 1er février 1867, avec la signature d’un Compromis. Celui-ci met en
place deux Etats souverains, l’Autriche et la Hongrie, ayant leur Constitution propre, leur administration, réunis
au sein d’une monarchie unique avec un empereur d’Autriche qui est couronné roi de Hongrie. Le Compromis
remet donc à égalité le royaume de Hongrie avec l’Autriche (c’est le sens du mot Ausgleich, nom allemand du
compromis qui implique une égalisation). Les deux entités conservent leur propre exécutif mais certaines
compétences sont partagées (diplomatie, défense et finances) et une harmonisation est faite en matière de
douanes et de transports pour conserver à l’économie un marché unique. La ligne de partage est fixée sur la
rivière de la Leitha. La Cisleithanie
1
comptera en 1880 près de 22 millions d’habitants, dont 37% d’Allemands
qui cohabitent avec des Italiens, des Tchèques, des Polonais dans dix-sept « Pays de la Couronne ». La
Transleithanie, royaume de Hongrie, compte en 1880 16 millions d’habitants dont 42% de Magyars vivant avec
des Roumains, des Tchèques et des Slaves du Sud. Les divers peuples se répartissent dans les provinces de façon
plus ou moins homogène. Les différents peuples, dont nous parlerons en terme de nationalités, qui cohabitent
dans l’Empire austro-hongrois jouissent-ils de la même autonomie, des mêmes libertés politiques, économiques,
culturelles, ou au contraire sont-ils comme enfermés dans cette nouvelle entité dualiste, privés de tout droit
d’expression ? Faut-il voir dans l’Autriche-Hongrie une prison des peuples ? La signature du Compromis laisse
de relatives libertés aux différents peuples, mais elle ressemble dans la pratique à un refus de reconnaître le droit
des nationalités autres que les Allemands et les Hongrois. Les peuples tchèques, slovaques, roumains, subissent
involontairement l’enfermement dans une nouvelle entité dualiste. Néanmoins, le manque de droit, ou
l’ « excès » de droit vont contribuer à l’accélération des revendications nationales, à la violence et au terrorisme,
réponse à l’enfermement sous autorité impériale.
Les Constitutions des deux entités permettent de relatives libertés
Avant de commencer, notons qu’aucun peuple n’est appelé « minorité ». C’est le terme de
« nationalité » qui les désigne. On parle d’ailleurs de « question des nationalités » (Nationalitätenfrage). D’autre
part, les droits du souverain sont toujours limités par ceux de ses peuples. C’est ainsi qu’il s’adresse à eux lors
des circonstances les plus graves, par exemple lorsque éclate en juillet 1914 la guerre avec la Serbie dans son
message « A mes peuples » (An meine Völker). Les peuples n’étaient jamais sans droit. Ils pouvaient se réclamer
de droits historiques et de privilèges anciens. Le Compromis de 1867 qui mêlent tant de nationalités dans un
même Empire le fait de façon autoritaire mais ne supprime pas toutes les libertés des peuples.
Des libertés en théorie communes à tous les peuples
Avec la formation de l’Autriche-Hongrie, tous les peuples accèdent à une infrastructure plus moderne.
Le commerce est stimulé par la disparition des douanes intérieures, ce qui permet à tous de faire des échanges,
même si les plus riches en tirent le plus grand avantage. La concurrence nouvelle est le signe d’une relative
liberté. D’autre part, les moyens de transport se développent, reliant les peuples entre eux et désenclavant
certaines régions grâce à des percées des Chemins de fer dans les montagnes. Mais les libertés accordées sont
aussi de nature constitutionnelle.
La Constitution autrichienne de décembre 1867 accorde des droits collectifs égaux aux peuples de la
Monarchie. Mais les juristes préfèrent accorder ces droits aux groupes ethniques (Volksstämme). Il est écrit dans
la Constitution de Cisleithanie, article 19 : « Tous les peuples de l’Etat sont égaux en droit et chaque peuple
possède un droit inviolable à conserver et à cultiver sa nationalité et sa langue ». En Hongrie, la loi XXIV des
1
La Cisleithanie, à l’ouest de la Leitha, ne s’appelle pas encore l’Autriche, bien que l’adjectif « autrichien »
existe déjà. La Cisleithanie est aussi appelée « Pays et Royaume représentés au Reichsrath », c'est-à-dire au
Parlement de Vienne.

Mathilde L’Hour Vendredi 26 mars 2004
Conférence d’histoire de Mme Larrère
2
nationalités votée par le Parlement de Budapest en décembre 1868, proclame les mêmes droits. Certains
dirigeants ont en effet tiré les leçons du passé
2
et veulent reconnaître le droit des nationalités pour s’en faire des
alliés.La langue sert d’instrument de base aux recensements -et non la nationalité qui n’existe pas encore en tant
que concept juridique. En 1880, pour le recensement, chaque citoyen habitant en Autriche doit indiquer
librement la langue usuelle (Umgangsprache), celle dont il se sert dans sa vie sociale et professionnelle. Les
citoyens habitants en Hongrie doivent indiquer, en revanche, leur langue maternelle, ce qui n’a rien à voir car il
s’agit d’une langue qu’on ne choisit pas. Il n’en demeure pas moins que les peuples ont le droit, théoriquement,
de parler la langue de leur nationalité. En réalité, le droit de parler sa langue ne sera respecter qu’en Cisleithanie,
et très partiellement ou tardivement.
En Cisleithanie, les peuples ont des droits politiques. Après 1867 en Bohême et en Moravie, ils peuvent
par exemple participer à la multiplication des associations. En 1870, les associations rassemblent 40% de la
population autrichienne. Toutes les activités économique, sociale, culturelle, prennent alors une coloration
nationale.Les peuples ont aussi le droit de créer des associations non politiques. Ainsi, nous le verrons plus loin,
seront créés des associations sportives. Les peuples jouissent donc, au moins en théorie du droit de s’exprimer
sans renier ni leur nationalité, ni leur loyalisme envers l’Empereur. Certains peuples vont d’ailleurs largement
utiliser ce droit.
Quelques peuples dans une « prison dorée »
L’Autriche-Hongrie n’a pas d’histoire commune et unificatrice, ce qui donne libre champ à toutes les
propagandes nationales. Certaines nationalités en profitent pour exalter leur héros historiques : Jan Hus, le grand
réformateur du XVIe siècle pour les Tchèques, Mathias Corvin, le défenseur contre les Turcs, ou Louis Kossuth,
le révolutionnaire de 1848 pour les Hongrois, par exemple. Cela contribue en partie à la création, dès avant 1867,
de patriotismes locaux qui permettent de rassembler les nationalités dominantes. Cela est vrai uniquement pour
les peuples qui ont déjà une histoire et qui vont pouvoir s’appuyer dessus pour asseoir leur légitimité. Ces
peuples là vont bénéficier d’une situation particulièrement favorable, en particulier en Cisleithanie. Les Polonais,
les Tchèques, les Italiens ou encore les Croates dans une certaine mesure, ayant des droits historiques, jouissent
de libertés plus importantes que d’autres nationalités.
Si les Polonais n’ont pas pu acquérir de droit d’Etat, le Reichsrath de 1868 promulgue une « résolution
galicienne » qui met sur pied une administration séparée avec un vice-roi responsable devant la Diète et
l’autonomie pour les affaires intérieures de la Province. En 1869, Vienne impose le polonais comme langue
administrative ; en 1870, elle créée à Cracovie une Académie des sciences et installe un Polonais comme
ministre sans portefeuille pour la Galicie. Les Diètes des différentes régions représentent les couches supérieures
de la population. Les Ruthènes étant exclus du droit de vote, les Polonais possèdent donc la majorité des sièges
et l’appui du « club polonais » s’avère indispensable au Reichsrath. Ils fournissent d’ailleurs plusieurs ministres
et Premiers Ministres aux gouvernements de Vienne, tels Potocki (1870-1871) ou Badeni(1895-1906). Des
institutions spécifiques sont créées : une Banque provinciale polonaise en 1883 par exemple. Les grands
propriétaires polonais assujettissent la masse paysanne Ruthène, leur enlevant toute possibilité d’action.
De leur côté, si les Tchèques sont exclus de la vie politique depuis le refus de l’Empereur de signer les
dix-huit articles fondamentaux qui aurait donné à la province le même statut que la Hongrie, ils gagnent peu à
peu en autonomie. La Bohême et la Moravie se couvrent, nous l’avons vu, d’un réseau d’associations, auquel se
greffe le parti national tchèque. En 1884, la chambre de commerce de Prague, dominé par les Allemands, passe
sous contrôle tchèque. Ils développent leurs propres caisses d’épargne et un réseau de caisses mutuelles qui
collectent l’épargne populaire. A partir de 1890, Prague est le centre financier des pays slaves de la Monarchie.
Ils participent aussi activement à la vie culturelle, même s’il faut attendre 1882 pour voir la création d’une
Université tchèque indépendante. En 1881 est inauguré le Théâtre National Tchèque. Une école nationale
tchèque de musique est créée, auréolée du prestige de Smetana et Dvorak
3
et organise des concerts populaires et
de l’orchestre philharmonique. Les arts plastiques et l’architecture exaltent les héros tchèques. La langue tchèque
est rendue obligatoire dans l’administration de Bohême en 1901.
2
Lorsque les révolutionnaires hongrois, en 1849, rejettent le droit des nationalités, les Croates, soutenus par les
Serbes de Croatie, prennent les armes pour défendre leur droit. Les hommes politiques comme Eötvös ou Deak
veulent éviter qu’une telle situation ne recommence.
3
Smetana : 1824-1884, compositeur et pianiste tchèque, principal représentant de la musique de Bohême. A écrit
l’opéra La Fiancée vendue et des poèmes symphoniques (Ma patrie)
Dvorak : 1841-1904, compositeur tchèque, dirige les conservatoires de New York puis Prague. A composé
notamment neuf symphonie (La Symphonie du nouveau Monde), des concertos, des poèmes symphoniques et des
quators.

Mathilde L’Hour Vendredi 26 mars 2004
Conférence d’histoire de Mme Larrère
3
Les Italiens eux aussi bénéficient d’avantages incontestables : taux d’analphabétisme faible, prospérité
économique, forte assimilation de leur langue.
Enfin, en Transleithanie, la Croatie est la seule à conserver quelques droits spécifiques. Son statut est
défini dans le compromis hungaro croate de 1868 (la Nagodba). Elle a un Parlement (Sabor) qui envoie trente-
neuf députés au Parlement de Budapest. Trois départements autonomes sont placés sous l’autorités d’un
gouverneur : l’intérieur, les cultes et l’instruction, la justice. En réalité, la province qui se voit reconnaître
quelques droits historiques a promis en échange sa soumission à Budapest. Seul 2% des hommes ont le droit de
vote, 8% après la réforme de 1910. En fait, ce n’est qu’en Cisleithanie que certains peuples peuvent réellement
s’émanciper.
Entre l’adhésion au principe dynastique et l’attachement de chacun à son groupe ethnique, il semble au
départ y avoir une place pour une action libre des citoyens en faveur de leur nationalité. Ce système fonctionne
dans la partie autrichienne, moins dans le royaume de Hongrie où rapidement s’affirme une tendance largement
intolérante. Dans la partie autrichienne, certains peuples réussissent à se forger une prison dorée. Pourquoi
« prison », puisqu’ils bénéficient de droits importants ? Tout simplement parce que si le niveau des droits
constitutionnels permet aux partis nationalistes de développer leur activité, le système parlementaire à tous les
niveaux, des Diètes auxquelles ils peuvent participer au Reichsrath où ils sont sous représentés, assure une
efficace régulation. Et les revendications nationales demeurent stériles pendant un certains temps. Quoiqu’il en
soit, seuls une minorité de peuples sont enfermés dans une prison dorée. Les autres peuples subissent une
« incarcération » plus dure et contraignantes.
Le Compromis fait de l’Autriche-Hongrie une prison pour les peuples minoritaires.
Comme nous le disions dans l’introduction, le compromis rassemble une Autriche libérale et
centralisée, une Hongrie conservatrice appuyée sur des droits historiques, seule à bénéficier d’une autonomie
complète ou d’un « droit d’Etat » avec sa Constitution propre et son exécutif -gouvernement responsable
hongrois présidé d’abord par Andrassy- et une multitude d’autres peuples dont le droit d’Etat n’est pas reconnu.
Allemands et Magyars sont nettement majoritaires (voir l’annexe) et revendiquent leur supériorité. Les
conditions même du Compromis, mais aussi sa mise en application, vont se révéler être les bases d’une prison
pour ces peuples reniés.
Les conditions du Compromis : une prison pour les peuples minoritaires
Le Compromis met en place une double centralisation. Les Parlements hongrois et autrichiens élisent
des délégations qui se réunissent chaque année dans l’une ou l’autre capitale pour ratifier le budget commun et
approuver des politiques communes. Pour les peuples slaves
4
de la monarchie, cette entente entre les Allemands
et les Magyars impliquent qu’ils perdent l’espoir de réaliser l’idée de l’austro slavisme de 1848, un Empire qui
donnerait à ses populations slaves la place que méritent leur nombre et la reconnaissance de leur loyalisme
envers l’Empereur. Il faut souligner ici que François-Joseph pouvait choisir en 1967 comme alternative à l’unité
le fédéralisme ou le dualisme. Or, il choisit le dualisme. La première formule aurait associé toutes les
nationalités en conservant un exécutif unique, mais elle fut rejetée par les Hongrois comme insuffisante pour
eux. La seconde scellait la fin de l’Empire unitaire, satisfaisant les Hongrois mais lésant les autres nationalités.
L’alternative choisie permettait en fait de satisfaire la forte majorité hongroise et donc à l’Autriche de tenir son
rang de grande puissance dans le concert européen.
L’administration elle est au service de l’Empereur et de sa Maison. Les gouverneurs des provinces, les
Statthalter, sont, au sens ancien du terme, des lieutenants du souverain. C’est surtout vrai en Autriche, car dans
la partie hongroise, l’administration locale et régionale repose entre les mains de la noblesse qui monopolise ces
fonctions électives (le peuple au sens « masse populaire », au sens de classe, est donc lui aussi d’une certaine
façon emprisonné…). La Constitution hongroise n’offre le droit de vote qu’à 6% de la population. En
Transleithanie, le Compromis inaugure d’autant plus une prison qu’il confère aux dirigeants magyars une
position ambiguë. Vis-à-vis de l’Empereur de l’Autriche, ils ont des réactions de susceptibilité exacerbée d’une
nation à peine émancipée, et font constamment pression, au nom des droits historiques réels ou plus souvent
inventés pour augmenter leur part de pouvoirs dans le dualisme, mais vis-à-vis de leurs population non
magyares, ils jouent une autre carte, celle des droits de la nation dominante d’opposer ses propres conceptions.
La noblesse magyare, soit 6% de la population du royaume, est bien implantée dans les comitats (Diètes des
provinces) et en monopolise le pouvoir électif. Se sentant seule légitime, elle maintient avec vigueur le suffrage
4
Les slaves forment un groupe ethnique de l’Europe centrale et orientale et de l’Asie septentrionale (Sibérie).
Dès le XVIème Siècles, ils peuplent l’Autriche (Bohème, Slovaquie, Slovénie, Croatie) et l’Empire Ottoman
(Bulgarie, Macédoine, Bosnie, Serbie). Seuls les slaves de Russie et de Pologne demeurent indépendants.

Mathilde L’Hour Vendredi 26 mars 2004
Conférence d’histoire de Mme Larrère
4
censitaire ce qui permet aux Magyars de disposer de 60% des votes, et d’éloigner les masses. Les peuples de
Transleithanie ne peuvent donc pas accéder à la politique. Le Compromis devant être renégocié tous les dix ans,
les Hongrois détiennent en outre une possibilité de chantage continu contre l’Empereur : la survie de l’Empire
passe par le maintien du Compromis, ce qui lui interdit d’intervenir en faveur des nationalités plus lésées de
Transleithanie.
Le Compromis n’accorde aucun droit politique aux différentes nationalités qui se sentent opprimées et
exigeront leur « libération » comme nous le verrons plus loin. Mais si l’absence de droit constitue un mur de la
prison austro-hongroise, la langue et le problème de l’histoire en constituent un autre.
Le problème de la langue et de la légitimité historique : certains peuples sont
véritablement emprisonnés
En Autriche-Hongrie, la langue prend une importance démesurée. Si les textes autorisent l’usage de la
langue d’origine, dans la pratique, les langues magyare, mais surtout allemande s’imposent comme langue
d’administration, de politique, de commerce, de science. L’armée est celle du souverain, pas de l’Etat, la langue
de commandement reste par conséquent l’allemand, même si le serment personnel fait à l’Empereur lors de
l’engagement dans l’armée peut être prononcé en douze langues. Dans les écoles, le problème est le même. Ce
problème de langue s’accroît du fait que l’allemand est la seule langue de communication entre les différentes
nationalités ce qui permet son développement au dépens des autres.En définitive, l’égalité des langues se réduit
au départ au domaine des tribunaux et des administrations locales. Le Parti pangermaniste (Alldeutsche) prône
même l’allemand comme seule langue officielle de la double monarchie. Seules quelques nationalités verront
leur langue officialisée, et uniquement en Cisleithanie.
En Transleithanie, malgré l’égalité constitutionnelle des nationalités, une tendance intolérante s’impose,
qui leur interdit l’usage de leur propre langue. Des nationalités, dites « inférieures », les Slovaques et les
Roumains, sont contraintes à la magyarisation forcée au nom des droits de la supériorité culturelle magyare. En
1897, le Comte Albert Apponyi déclare au politologue français Charles Benoist : « Je dis qu’il ne saurait y avoir
à l’intérieur de l’Etat hongrois ni nationalités, ni droit des nationalités. Il n’y a qu’une nationalité : tout ce qui
est en Hongrie est hongrois. Je dis donc, je dis bien : comme citoyen hongrois, si les Roumains, si les Slovaques
s’estiment lésés, qu’ils se plaignent ; s’ils désirent une plus grande liberté, qu’ils la demandent. Nous verrons ce
que nous pourront faire ; mais une nationalité croate, ou roumaine, ou slovaque, nous n’en connaissons pas,
jamais nous n’en reconnaîtrons. » Dans les villages slovaques, les paysans sont soumis au contrôle de
l’instituteur hongrois, du cabaretier hongrois, du gendarme hongrois et du curé sous contrôle de la hiérarchie
hongroise. Dès 1867, les lycées en langues slovaque ou roumaine sont supprimés. En 1879, la loi introduit le
hongrois comme langue obligatoire dans les écoles normales des nationalités. Nul ne peut par conséquent faire
ses études sans adopter la langue hongroise. Les intellectuels deviennent des magyaron, faux hongrois rejetés par
leur nationalité. La nationalité magyare à cette période est d’ailleurs ouverte : quiconque veut en adopter la
langue et la culture est accueilli sans qu’on s’interroge sur son origine : c’est en réalité la porte ouverte vers la
prison puisque la légitimité historique des peuples n’est pas reconnue.
Les populations se germanisent, se magyarisent, voire se polonisent, pour les Ruthènes de Galicie. Dans
toute l’Autriche-Hongrie, les peuples, par l’impossibilité de la pratique de leur langue, sont enfermés dans une
prison car ils n’ont pas la liberté de mener une existence nationale. Des associations, en Transleithanie,
travaillent à la magyarisation, soutenue par les autorités. En 1878, le code pénal prévoit même des peines contre
ceux qui s’y opposent et en 1907, la loi Apponyi créée des pénalités sévères contre les écoles confessionnelles
dont les maîtres et les élèves n’ont pas un niveau suffisant de hongrois.
Les murs de cette prison sont renforcés du fait que les histoires nationales n’ont pas droit de cité. La
vision de l’histoire enseignée dans les écoles est purement dynastique. Tout est présenté comme une succession
des bienfaits de l’Empereur, les célébrations scolaires lui sont consacrées. L’histoire des peuples passe au second
rang, même si certains peuples multiplient les efforts pour exalter leurs héros nationaux. L’histoire officielle
autrichienne évite d’ailleurs de parler des conflits de nationalités, pour ne mécontenter aucun des camps en
présence. Même les Croates qui sauvent quelques droits historiques en 1868 doivent en contrepartie accepter la
subordination à Budapest, ce qui montre bien la volonté d’éloigner les histoires nationales.
Les éléments qui légitiment une nation, langue et histoire, notamment, sont donc ignorés par les
dirigeants de l’Autriche-Hongrie, et ce malgré les textes constitutionnels. Les peuples subissent des
transformations qui mettent leurs cultures en péril. Les nationalités les plus puissantes vont revendiquer leur
droit à l’autonomie, ce qui prouve bien qu’elles se sentent enfermées.
Des peuples aux velléités fugitives

Mathilde L’Hour Vendredi 26 mars 2004
Conférence d’histoire de Mme Larrère
5
Quand il n’existe ni passé unificateur, ni langue commune pour cimenter la nation, il est
difficile de rester un pays uni longtemps. Les peuples, qui se sentent emprisonnés, vont revendiquer de plus en
plus de liberté, c'est-à-dire pour certains, l’indépendance, pour d’autre, l’appartenance à un Etat fédéral.
Revendications politiques et actions terroristes vont ouvrir les portes de la prison austro-hongroise.
La revendication de droit politique
Dès les débuts de l’Autriche-Hongrie, dans les Diètes où les Slaves jouent un rôle important, les
protestations sont vives. En 1867, Les Magyars avaient fait céder l’Empereur sur le Compromis par des
négociations directes en annonçant que s’ils n’obtenaient pas leurs droits historiques, ils boycotteraient le
Parlement commun, le Reichsrath, installé à Vienne. Dès avril 1867, des Slaves, se sentant lésés, vont tenter de
reprendre cette menace pour faire valoir leurs droits. Les Tchèques refusent d’envoyer des députés siéger au
Reichsrath. En 1868, les députés tchèques de Bohême s’abstiennent de siéger et réclament un accord avec le
souverain pour respecter les droits anciens du royaume de Bohême.
Cela relève plus du pittoresque, au départ, mais les revendications d’autonomie se multiplient à la fin du
siècle. En 1889 s’organise en Autriche le Parti social-démocrate des travailleurs dont le leader, Victor Adler, a
un passé nationaliste. En 1899, le congrès de Brünn adopte un programme qui prévoit la transformation de l’Etat
autrichien en un Etat fédéral constitué de deux corps autonomes fondés sur des caractères ethniques et égaux
entre eux. En principe, le mouvement est supranational et commun à l’ensemble de la double monarchie. Mais
dès 1890, une scission se produit avec les Hongrois, entraînant la formation d’un parti social-démocrate de
Hongrie en 1908. De même qu’en Bohême se constitue un Parti des sociaux-démocrates tchèques autonomistes.
Les Tchèques ont pour la majorité des revendications autonomistes. Si les Vieux Tchèques se fondent déjà sur la
« théorie du droit d’Etat de Palacky » pour réclamer l’autonomie, acceptant de collaborer avec les Allemands sur
la base du fédéralisme, les Jeunes Tchèques, nés de la sécession de Fric et Gregr, refusent de collaborer avec les
Allemands mais désiraient eux aussi l’autonomie de leur Province dans l’Empire.
En Cisleithanie, l’exigence d’autonomie est particulièrement importante comme nous le montre
justement l’exemple tchèque.En 1879, le ministère Taffe arrive au pouvoir. Les Tchèques, exclus de la vie
politique,
5
sont réintégrés dans la vie politique. Ils représentent 23% de la population de Cisleithanie, dominent
la ville de Prague et peuvent s’appuyer sur un grand héritage historique pour revendiquer un droit d’Etat. Ils
gagnent en autonomie. Par exemple, en Bohême, les caisses d’épargne populaire sont détenues par des tchèques.
L’individu qui y dépose sont argent donne en même temps son appui à la cause nationale. En outre, dès 1862,
deux Tchèques fondent les Sokols, association de gymnastique dont l’entraînement vise à faire du jeune Sokol
un patriote tchèque. Les premiers Congrès de Sokols rassemblent des gymnastes venus de tout le territoire de
Bohême Moravie mais aussi d’autres pays slaves : des Croates, des Serbes, des Polonais. A la veille de la
première guerre mondiale, l’association rassemble près de 120000 membres, représentant un vivier pour le
recrutement de cadres nationaux. Les jeunes et les ouvriers participent aussi par des manifestations à la volonté
d’émancipation tchèque. Tout le peuple se sent oppressé et veut se libérer, même si les divisions politiques
internes s’aggravent. L’enthousiasme pour la cause slave va entraîner la naissance du mouvement néo slaviste
fondé notamment sur un profond sentiment de solidarité avec les Slaves d’Autriche-Hongrie. Si à la veille de la
guerre, le camp politique tchèque ne présente toujours aucune unité réelle, la force du mouvement national l’a
mis au premier rang des Slaves de la monarchie.
Oppressés dans une Autriche-Hongrie qui ne leur accorde pas la reconnaissance qu’ils souhaitent, les
peuples cherchent à affirmer leur autonomie par un développement culturel, économique, et finalement politique,
que leur permet l’Empereur. Les Tchèques donnent l’impulsion à de moins importantes nationalités. Ainsi en
1882, ils collaborent avec le Slovène Ivan Hribar, maire de Llubljana, directeur de sociétés d’assurance,
nationaliste et défenseur de sa langue. La politique slovène très loyaliste jusqu’alors s’oriente vers les
revendications nationales. Un mouvement intellectuel national Ruthène s’appuyant sur la société Sevcenko voit
aussi le jour en 1873.
En Transleithanie, les peuples revendiquent eux une existence autonomes. En 1892, par exemple, les
Roumains remettent à l’Empereur un mémorandum protestant contre l’absence de statut de la Transylvanie et
contre les persécutions que subit la langue roumaine. L’échec est total mais cela montre bien les revendications
des peuples, leur sentiment d’oppression. Les Roumains bénéficient d’ailleurs du soutien de la Ligue pour l’unité
culturelle de tous les Roumains, fondée en 1891 à Bucarest : ils s’appuient sur un pays auquel ils se sentent liés
mais qui n’est pas le leur.
C’est alors que des nouveautés politiques permettent à certaines nationalités de coexister, démocratisant
l’Empire. En 1905 est signé un compromis qui répartit les listes électorales en fonction des nationalités. Le
suffrage universel, utilisé uniquement pour les élections au Reichsrath, est accordé en 1907. La démocratisation
5
En 1871, l’empereur refuse de signer les 18 articles, dit fondamentaux, qui donnaient à la Bohême le même
statut que celui accordé à la Hongrie et la transformation de la Cisleithanie en une véritable confédération
 6
6
 7
7
1
/
7
100%