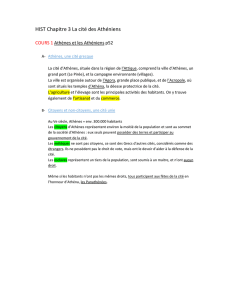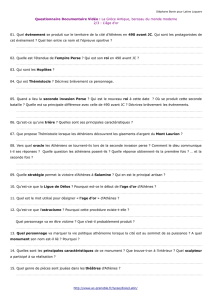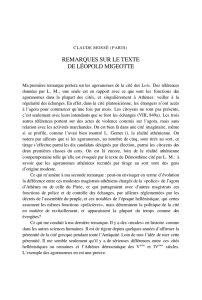La langue comme facteur d`intégration ou d`exclusion

1
Bruno Rochette
La langue comme facteur d'intégration ou d'exclusion
L'Athènes de Périclès et la Rome de Cicéron
Pour les Grecs comme pour les Latins, la langue a toujours été un des critères déterminants
permettant de caractériser le citoyen, l'étranger ou le barbare. Le βάρβαρος/barbarus se définit en
effet au premier chef comme celui qui ne parle ni le latin ni le grec
1
. Le premier emploi du verbe
βαρβαρίζω, qui se trouve chez Hérodote
2
, a le sens de « parler une langue étrangère », sans
jugement négatif. Ce n'est que plus tard que le verbe se chargera d'une connotation péjorative
3
.
La dichotomie Ἕλλην/βάρβαρος ou Romanus/barbarus connaît toutefois des nuances. Parmi les
Grecs et les Latins, on distingue les personnes qui parlent bien le grec ou le latin de celles qui
s'expriment avec un accent ou en s'écartant de la norme - la langue de la ville, la langue des élites
urbaines. Bien souvent, le degré de maîtrise de la langue grecque ou latine est un facteur
permettant l'intégration ou, à l'inverse, conduisant à l'exclusion. Ce sont ces cas que je voudrais
examiner en comparant la situation qui se fait jour dans l'Athènes du Ve siècle – l'Athènes de
Périclès - à celle qui prévaut dans la Rome de la fin de la République – la Rome de Cicéron.
*
En Grèce, la notion de groupe ethnique uni n'apparaît pas avant le début du Ve s. En
restant très schématique, c'est le conflit avec la Perse qui a fait prendre conscience aux Grecs
qu'ils appartenaient à une communauté qui a plusieurs éléments en commun. Hérodote est le
premier à présenter explicitement, dans le prologue, l'opposition ethnique Grecs/Barbares
comme deux blocs antithétiques qui se font face et s'affrontent
4
. La langue est l'une des
caractéristiques qui permet de définir la spécificité du Grec. Le même Hérodote le rappelle en
insérant une parenthèse éclairante dans le discours qu'il met dans la bouche des Athéniens en
réponse au Macédonien Alexandre, fils d’Amyntas, envoyé par Mardonios après Salamine, au
printemps de 479
5
. Cet Alexandre avait pour mission de pousser les Athéniens à se soumettre à
Xerxès, tandis que les Spartiates les encourageaient à poursuivre la lutte. Repoussant la
proposition du Macédonien, les Athéniens donnent comme raison de leur refus de conclure la
1
W. NIPPEL, La costruzione dell'"altro", in S. SETTIS (a cura di), I Greci. Storia Cultura Arte Società I, Turin
1996, p. 168.
2
II 57, 2.
3
La bibliographie sur le sujet est importante. Je renvoie à l'article M. DUBUISSON, Barbares et barbarie dans
le monde gréco-romain : du concept au slogan, "AC", LXX 2001, pp. 1-16, qui comporte une bibliographie
importante.
4
Sur l'attitude d'Hérodote à l'égard des peuples étrangers, cf. A. DIHLE, Die Griechen und die Fremden,
Munich 1994, pp. 41-44 et les contributions réunies dans le volume Hérodote et les peuples non grecs,
Vandoeuvres-Genève, 1990 (Entretiens de la Fondation Hardt, XXXV).
5
D.J. MOSLEY, Envoys and Diplomacy in Ancient Greece, Wiesbaden 1973, p. 55.

2
paix avec les Perses la συγγένεια qui les lie avec les Spartiates
6
. Ces réflexions sur la parenté qui
unit deux cités du monde grec pourtant si différentes amènent l’historien à définir l'῾Ελληνικὸν
au premier chef comme une unité de sang et de langue : ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον
7
. Il
ajoute que la communauté de religion - en fait les aspects rituels - et de moeurs constitue aussi un
ciment de l’ethnos grec : καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι, ἤθεά τε ὁμότροπα.
En plaçant la langue immédiatement après la consanguinité, la définition hérodotéenne de
l’῾Ελληνικόν, citée ad nauseam, montre quelle importance le « parler grec » (τὸ ἑλληνίζειν)
revêt aux yeux des Hellènes pour définir leur identité
8
. Ce faisant, Hérodote semble méconnaître
la multiplicité des dialectes grecs. Réfléchissant comme s'il n'y avait qu'une seule langue grecque, il
utilise ῾Ελλάς comme un adjectif féminin pour désigner la langue grecque dans son ensemble
9
.
Pour les Grecs, parler la même langue constitue la condition de la solidarité. En revanche, si
l’incompréhension s’installe, elle ne peut conduire qu’à la discorde et à la haine
10
. Hérodote
connaît bien les problèmes de communication entraînés par la différence de langues. Son voyage
en Ėgypte lui en a fait faire l'expérience. Il présente la γλῶσσα
11
, c’est-à-dire la langue considérée
comme système structuré, comme le véhicule indispensable conduisant à la connaissance de
l’autre
12
.
Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que la langue ait joué un rôle important dans
la société de l'Athènes du Ve s. comme élément de discrimination. Le nombre d'étrangers résidant
à Athènes devait être considérable, même s'il est difficile de donner des chiffres exacts
13
– après
6
Voir aussi DIOD. SIC. XI 28, 1 : τηρεῖν τὴν πρὸς τοὺς ῾´Ελληνας καὶ συγγενεῖς καὶ
ὁμοφώνους εὔνοιαν. Voir L. PICCIRILLI, La diplomazia nella Grecia antica : temi del linguaggio e caratteristiche
degli ambasciatori, "MH", LVIII 2001, p. 9 et L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica, Rome 2002, p.
87 ; F. GAZZANO, La diplomazia nelle 'Storie' di Erodoto. Figure, temi, problemi, in L. PICCIRILLI (a cura di),
La retorica della diplomazia nella Grecia antica e a Bisanzio, Rome 2002, pp. 26-27.
7
VIII 144, 2. Sur le problème de la nationalité grecque, W.F. WALBANK, The Problem of Greek Nationality,
"Phoenix", V 1951, pp. 41-60 [repris dans Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and
Historiography, Cambridge 1985, pp. 1-19 et in Th. HARRISON (ed.), Greeks and Barbarians, Edinburgh
2002, pp. 234-256] ; A. AYMARD, Les étrangers dans les cités grecques aux temps classiques (Ve et IVe siècles avant
J.-C.), in Ėtudes d'histoire ancienne, Paris 1967, pp. 300-313 ; J.M. HALL, The Role of Language in Greek
Ethnicities, "PCPhS", XLI 1995, pp. 83-100, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997, pp. 177-
181 et Hellenicity : between ethnicity and culture, Chicago-Londres 2002 [non uidi] ; D. ASHERI, Identità greche,
identità greca, in I Greci cit., II/2 Turin 1997, pp. 19-26.
8
À en croire le Père de l'histoire, les Égyptiens se servent aussi de la langue comme critère leur
permettant d'identifier les autres peuples et de définir leur propre identité (VIII 144, 2).
9
VI 98, 3 (κατὰ ῾Ελλάδα γλῶσσαν) et IX 16, 2 (τὸν Πέρσην ... ῾Ελλάδα γλῶσσαν ἱέντα).
10
W. SPEYER, Die Griechen und die Fremdvölker. Kulturbegegnungen und Wege zur gegenseitigen Verständigung, "Eos",
LXX 1989, pp. 17-29 et Über die Uneindeutigkeit des Barbarischen, "ZAnt", XLV 1995, pp. 359-369.
11
Sur les langues dans l’oeuvre d’Hérodote, Th. HARRISON, Herodotus’ Conception of Foreign Languages, dans
Histos [http://www.dur.ac.uk/Classics/histos/1998/index.html], 2 (1998). Plus généralement, sur les
échanges linguistiques entre Grecs et non-Grecs, M.L. WEST, The East Face of Helicon, Oxford 1997, pp.
606-609.
12
G. NENCI, L’Occidente ‘barbarico’, in Hérodote cit., pp. 310-311 et, plus particulièrement sur Hérodote et
l’Ėgypte, C.W. MÜLLER, Fremderfahrung und Eigenerfahrung, "Philologus", CXLI 1997, pp. 200-214.
13
F.M. HEICHELHEIM, Wirtschaftsgeschichte des Altertums, Leyde 1938, p. 330 et la note 17 (bibliographie) ; J.
BELOCH, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1886, pp. 99-100 ; T. TARHIAINEN, Die
athenische Demokratie, Zurich 1966, pp. 50-58.

3
431, de 10 à 15.000 métèques, qui peuvent être des Grecs ou des barbares, sept fois autant
d'esclaves. C'est dire que les citoyens de plein droit étaient minoritaires
14
. Ces étrangers étaient
depuis longtemps puissants économiquement dans la ville et ils prenaient de plus en plus
d'importance dans la vie intellectuelle et culturelle d'Athènes. Pensons à Hérodote ou aux
sophistes, qui, à l'exception d'Antiphon, sont tous des métèques. Cette présence en masse
d'hommes venus d'horizons divers ne demeura pas sans influence sur le grec parlé en Attique.
L'attique parlé par les étrangers, surtout les esclaves et les métèques de basse condition sociale,
était loin d'être parfait. Il constituait une sorte d'attique vulgaire, influencé par les dialectes grecs
et même par des langues non-grecques
15
. L'auteur anonyme de la Constitution des Athéniens,
transmise parmi les oeuvres de Xénophon, émet un jugement éclairant sur la situation linguistique
de l'Athènes de la fin du Ve siècle
16
. L'opuscule doit dater de 431-425 et, plus précisément, de 431
ou 430
17
. L'hégémonie maritime d'Athènes, dit le pamphlétaire, a eu pour conséquence que la
capitale de l'Attique a pu bénéficier de produits venant des quatre coins de la Méditerranée. En
outre, ajoute le vieil oligarque, en entendant des langues de différent type, les Athéniens ont pris
des caractéristiques tantôt de l'une tantôt de l'autre : φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο
τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ τῆς· καὶ οἱ μὲν ῞Ελληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ
διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, ᾿Αθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν ῾Ελλήνων καὶ
βαρβάρων. Tandis que les Grecs se servent d'une langue, d'habitudes et d'une façon de se vêtir
qui leur sont propres, les Athéniens, pour leur part, sont comme un mélange d'éléments
hétéroclites pris à tous les Grecs et aux barbares. Cette affirmation est certainement exagérée,
puisqu'elle émane d'un adversaire du régime démocratique athénien. Elle n'en reflète pas moins
une réalité, dont on trouve des traces dans la littérature. Les fragments de la Comédie attique
offrent plusieurs exemples de contaminations. Ainsi en est-il dans un fragment d'Ėpicrate
18
. Une
prostituée jure par τὰν Φερρέφατταν, en utilisant un forme dorienne de l'article et une forme
attique pour le nom propre. Sans doute le comique voulait-il marginaliser par ce procédé une
personne de basse extraction. Eustathe a conservé le souvenir de formes utilisées par Platon le
Comique : ὁ πρόσωπος à la place de τὸ πρόσωπον, τοῦ γάλα à la place de τοῦ γάλακτος ou
14
Les estimations sont difficiles à établir : vers 480, environ 35.000, vers 431 entre 42.000 et 43.000, après
la guerre du Péloponnèse, de 20.000 à 22.000, d'après A.W. GOMME, The Population of Athens in the Fifth
and Fourth Centuries B.C., Oxford 1933, tabl. I (p. 26). Voir aussi Cl. MOSSE, The Ancient World at Work.
Traduction de J. Lloyd, Londres 1969 [éd. Orig. 1966], p. 15.
15
E. RISCH, Das Attische im Rahmen der griechischen Dialekte, "MH", XXI 1964, pp. 1-14 [repris dans Kleine
Schriften, Berlin-New York 1981, pp. 222-235].
16
II 7, et le commentaire de E. KALINKA, Die pseudoxenophontische Einleitung –
Übersetzung – Erklärung, Leipzig-Berlin 1913, pp. 198-203.
17
Edm. LEVY, Athènes devant la défaite de 404. Histoire d'une crise idéologique, Paris 1976, pp. 273-275 et H.B.
MATTINGLY, The Date and Purpose of the Pseudo-Xenophon Constitution of Athens, "CQ" XLVII 1997, pp. 352-
357.
18
9 Kock = 8 Kassel-Austin :
τελέως μ᾿ ὑπῆλθεν ἡ κατάρατος μαστροπός,
ἐπομνύουσα τὰν Κόραν, τὰν ῎Αρτεμιν,
τὰν Φερρέφατταν, ὡς δάμαλις, ὡς παρθένος,
ὡς πῶλος ἀδμής· ἡ δ᾿ ἄρ᾿ ἦν μυωνιά

4
γάλατος
19
. Comme le souligne Kock, ce n'est pas un barbare qui pouvait s'exprimer ainsi, mais
quelqu'un qui utilisait une langue peu soignée, une langue vulgaire en quelque sorte. Un passage
du grammairien Hérodien montre que les comiques d'Athènes avaient l'habitude de se moquer
des usages provinciaux. Après avoir cité deux fragments de Rhinton de Tarente, dans lesquels on
trouve ὀλίος au lieu de ὀλίγος, le grammairien dit que Platon, dans l'Hyperbolos – le démagogue
ostracisé au début de l'année 416
20
, présenté comme le fils d'un esclave étranger
21
, avait tourné en
dérision l'utilisation de ὀλίγος sans γ en la qualifiant explicitement de contraire à l'usage attique
22
:
168 Kock = 183 Kassel-Austin
23
:
ὁ δ᾿ οὐ γὰρ ἠττίκιζεν, ὦ Μοῖραι φίλαι,
ἀλλ᾿ ὁπότε μὲν χρείη διῃτώμην λέγειν,
ἔφασκε δῃτώμην, ὁπότε δ᾿ εἰπεῖν δέοι
ὀλίγον, ὀλίον ἔλεγεν.
Cette prononciation de ὀλίγος, caractérisée de barbare par Hérodien (ὡς βάρβαρον),
permettait sans doute au comique d'étayer la thèse de l'origine étrangère d'Hyperbolos. Comme
ses contemporains, Platon faisait de la politique militante et était passé maître dans l'art de la
parodie. L'origine étrangère des démagogues était un lieu commun de leurs adversaires
24
.
Aristophane tenait Hyperbolos pour suspect d'usurpation du titre de citoyen
25
. Ce quolibet est
probablement d'invention pure, car le nombre de citoyens athéniens qui pouvaient se prévaloir
d'une ascendance athénienne exempte de tout mélange, en remontant à trois ou quatre
générations, devait être infime. Platon le Comique fait d'Hyperbolos un Lydien
26
, Polyzélos un
Phrygien
27
, une scholie à Aristophane un Syrien
28
. En réalité, il était bien Athénien, né de parents
19
238 Kock = 247 Kassel-Austin.
20
H. HEFTNER, Zur Datierung der Ostrakisierung des Hyperbolos, "RSA", XXX 2000, pp. 27-47.
21
166-167 Kock = 182 Kassel-Austin et Ar., Aves, 764 et 1244. B. BALDWIN, Notes on Hyperbolus, "AClass",
XIV 1971, pp. 151-156 ; P. BRUN, Hyperbolos, la création d'une "légende noire", "DHA", XIII 1987, pp. 183-
187 (spéc. sur l'origine, pp. 186-188) ; G. CUNIBERTI, Iperbolo ateniese infame, Naples 2000 (I/1 : tra padre
e madre : la presunta barbarie) [non uidi]. Hyperbolos ne devait pas avoir reçu une éducation soignée. Il
était fabriquant de lampes, terme auquel la poésie comique ne manquait pas de donner un aspect
péjoratif. En réalité, il possédait une fabrique dans laquelle il employait une main d'oeuvre servile (cf.
MOSSE, World cit., p. 92).
22
Une comparaison avec la langue des inscriptions montre qu'il s'agit d'une prononciation populaire de
l'attique. Cf. L. THREATTE, The Grammar of Attic Inscriptions I (Phonology), Berlin-New York 1980, pp. 440-
441.
23
T. LONG, Barbarians in Greek Comedy, Edwardsville 1986, p. 137 et THREATTE, Grammar cit., p. 440.
24
Sur l'image négative des démagogues à Athènes, LEVY, Athènes cit., pp. 132-133, 149-150, 192-194 et
235-239.
25
Ranae, 678, 1504, 1533-1534.
26
170 Kock = 185 Kassel-Austin.
27
5 Kock = 5 Kassel-Austin.
28
Sch. à AR., Pax, 692.

5
athéniens
29
. Les tessons d'ostracisme le concernant retrouvés sur l'agora d'Athènes l'attestent
formellement
30
. Cléophon, le démagogue le plus important après la restauration démocratique de
410
31
, fit aussi les frais des moqueries des comiques. Une scholie à Aristophane dit que Platon
avait mis en scène la mère de Cléophon, supposée Thrace
32
, en la disant βαρβαρίζουσα
33
. Ces
exemples peuvent être comparés avec celui de Théophraste, qui, bien qu'il ait vécu de longues
années en Attique, y passait encore pour un étranger quod nimium Attice loqueretur
34
. Les Guerres
médiques, en effet, n'avaient pas seulement permis aux Athéniens d'affirmer leur supériorité sur
les barbares. Elles leur avaient aussi donné l'occasion de prendre l'avantage sur le reste de la
Grèce (οἱ ἄλλοι Ἕλληνες.
À côté des Grecs parlant mal l'attique – des ξένοι
35
, dont se moque volontiers les
comiques
36
, Athènes comptait un grand nombre d'étrangers, du point de vue ethnique et culturel
– des βάρβαροι
37
. Ces derniers n'ont en commun avec les Grecs aucun des éléments qui, selon
Hérodote, définissent l'Hellenikon : sang, langue, religion, coutumes. Dans la littérature, plusieurs
peuples étrangers se voient attribuer un vice particulier
38
. Une catégorie importante de βάρβαροι
était constituée par les esclaves de l'Etat, les seuls δημόσιοι ὑπηρέται dont la fonction, non
soumise à des élections, était permanente. Parmi eux se trouvaient les archers scythes, qui
constituaient, dans la pratique athénienne, la police de la ville. Dans la scène finale des
29
Le père d'Hyperbolos est tantôt Chrémès, tantôt Antiphanès. C'est ce dernier qui est le nom correct,
confirmé par les tessons d'ostracisme concernant Hyperbolos (cf. H. WANKEL, Die Rolle der griechischen
und lateinischen Epigraphik bei der Erklärung literarischer Texte, "ZPE", XVII 1974, pp. 88-89 et W.
SCHEIDEL, T 30 : Theopοmp FGrHist 115 F 96b (ca. 345-340 v. Chr.) : Ostrakisierung und Tod des Hyperbolos,
in P. SIEVERT (hrsg.), Ostrakismos – Testimonien, I, Stuttgart 2002, pp. 397-400).
30
A. ROOBAERT, L'apport des ostraka à l'étude de l'ostracisme athénien, "AC", XXXVI 1967, p. 527 et n. 19.
31
R. RENAUD, Cléophon et la guerre du Péloponnèse, "LEC", XXXVIII 1970, pp. 458-477 ; B. BALDWIN, Notes
on Cleophon, "AClass", XVII 1974, pp. 35-47 ;
32
Hérodote (IV, 46) souligne l'ignorance des populations originaires du bassin de la mer Noire. Sur l'image
stéréotypée négative des Thraces à Athènes, D. BRAUND, L'impatto sui Greci di Traci e Sciti : immagini di
sfarzo e austerità, in I Greci cit., III, Turin 2001, p. 8.
33
60 Kock = 61 Kassel-Austin (Schol. à AR., Ranae, 681). L'origine thrace était un lieu commun chez les
poètes comiques (cf. BALDWIN, Cleophon cit., p. 38).
34
QUINT. Inst. VIII, 1, 3 (voir aussi CIC., Brut. 172).
35
Ph. GAUTHIER, Les xenoi dans les textes athéniens de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C., "REG", LXXXIV
1971, pp. 184-194.
36
Aristophane, aux yeux de qui peu d'étrangers trouvent grâce, Grecs ou non-Grecs (cf. R. LONIS,
Aristophane et les étrangers, "Ktèma", XXVII 2002, pp. 184-194), s'est amusé à plusieurs reprises à
caricaturer l'utilisation de dialectes non-attiques : mégarien et béotien dans les Acharniens (729-835 ; 860-
954), ionien dans la Paix (45-48) et laconien dans Lysistrata (cf. S.D. OLSON, Aristophanes Acharnians.
Edited with Introduction and Commentary, Oxford 2002, pp. lxx-lxxv).
37
M. MOGGI, Greci e Barbari : uomini e no, in L. DE FINIS (a cura di), Civiltà classica e mondo dei barbari. Due modelli a
confronto, Trento 1991, pp. 31-46 ; Staniero due volte: il barbaro e il mondo greco, in M. BETTINI (a cura di), Lo
straniero ovvero l'identità culturale a confronto, Rome-Bari 1992, pp. 51-76 ; Lo straniero (xenos e barbaros) nella
letteratura greca di epoca arcaico-classico, "Ricerche storico bibliche", VIII 1996 [Lo "straniero" nella Bibbia. Aspetti
storici, istitutionali e teologici], pp. 103-116.
38
R. HODOT, Le vice, c'est les autres, in R. LONIS (éd.), L'étranger dans le monde grec. II. Actes du deuxième colloque
sur l'étranger. Nancy, 19-21 septembre 1991, Nancy 1992, pp. 169-183. Ce sont surtout les verbes en
qui servent à caractériser négativement certains peuples.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%