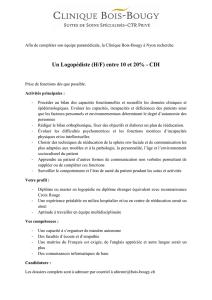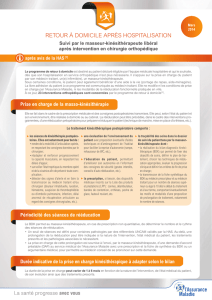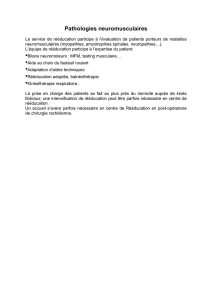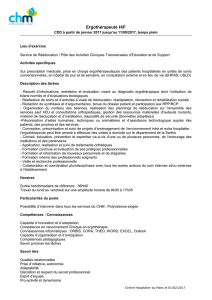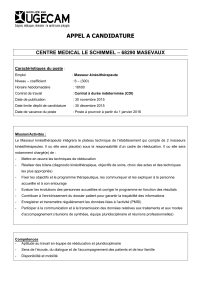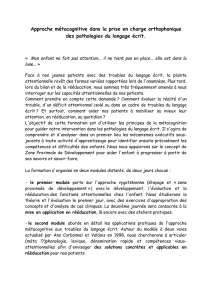Le Bilan – Diagnostic Kinésithérapique
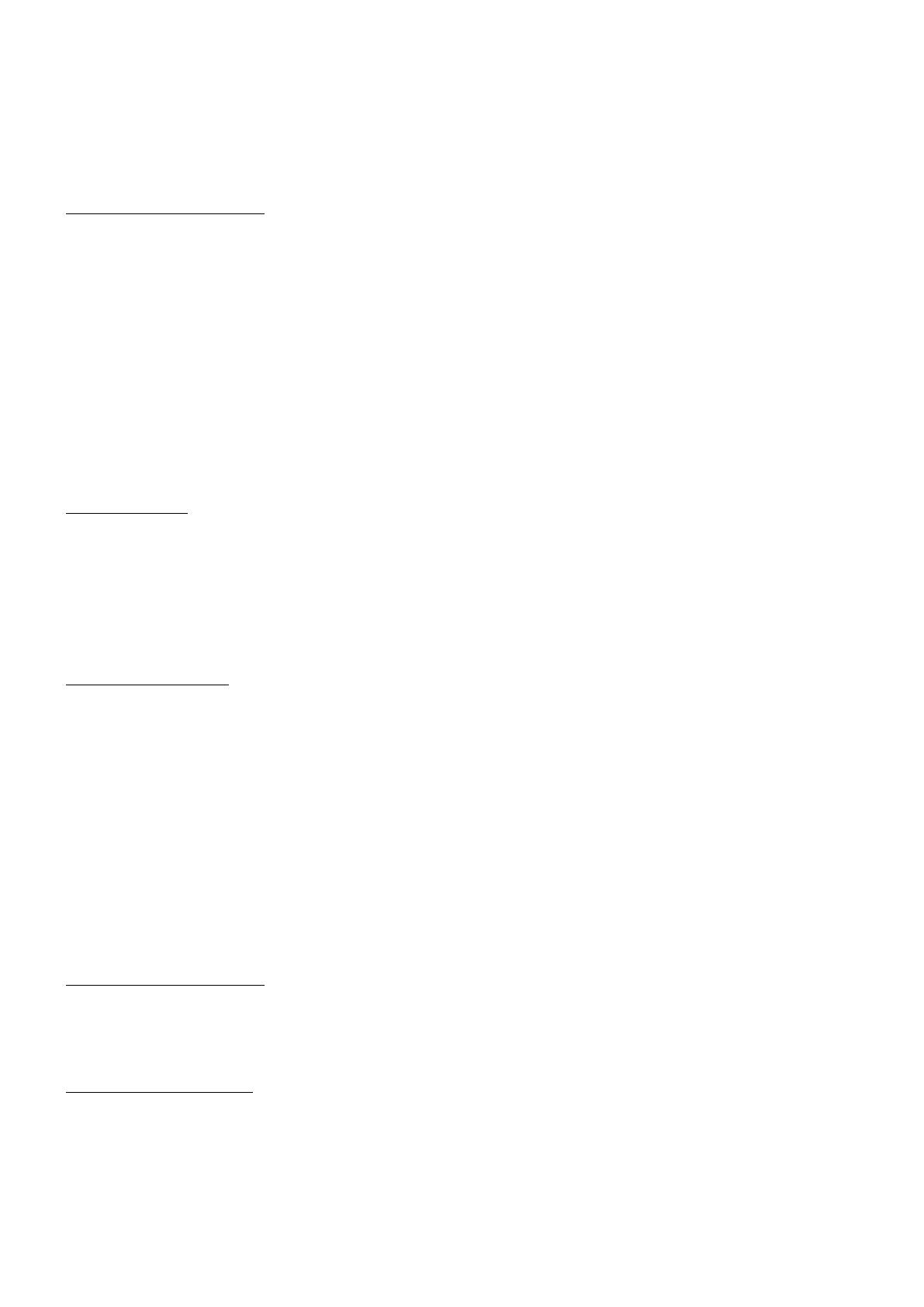
Le Bilan – Diagnostic Kinésithérapique
Ce bilan-diagnostic se déroule en plusieurs points qu’il faut réaliser dans l’ordre, avec le + de précision
possible.
I/ Connaissance du Patient
C’est la première étape où l’on se renseigne sur :
- l’état civil du patient (= renseignements personnels) ;
- sa situation familiale ;
- son lieu de vie (= ergonomie du domicile) ;
- sa profession ;
- ses activités sportives et de loisirs ;
- sa latéralité (= côté dominant) ;
- le projet du patient (= qu’attend-il du kiné, de la rééducation ?).
Il faut ensuite connaître l’anamnèse, c’est-à-dire l’histoire de la maladie racontée par le patient
(comment est-elle survenue, etc…).
Enfin, il faut se renseigner sur les antécédents médicaux du patient qui sont en rapport avec la
rééducation, ainsi que sur le traitement médical en cours.
II – Observation
Elle est commencée par l’inspection de l’attitude et de l’environnement du patient, afin d’avoir une
idée de l’état musculaire (amyotrophie ou état normal). On observe l’état trophique du patient, s’il a des
escarres, des oedèmes, la couleur de sa peau, sa respiration, s’il a les lèvres cyanosées, etc…
Ensuite, on réalise la palpation qui va donner des renseignements sur la température du patient (prise
de température au dos de la main), sur la tonicité du patient (reliefs musculaires, oedèmes autour d’une
articulation), sur la douleur et sur les contentions (plâtres, attelles…)
III – Bilan Articulaire
On mesure les amplitudes articulaires (goniométrie), au niveau des 4 membres, de façon symétrique et
comparative (bras droit/bras gauche, jambe droite/jambe gauche). Sur tous les membres, chaque
articulation doit être vérifiée. S’il y a des limitations d’amplitude, il faut savoir ce qui limite le
mouvement (douleur, raideur ou rétractation musculaire). Cette vérification des amplitudes peut se faire
au niveau du rachis, sous réserve de la disponibilité du patient.
Le bilan articulaire est quelque chose de passif : le patient ne fait rien ; il se laisse manipuler par le MK.
Ce bilan passif permet aussi d’évaluer le tonus musculaire résiduel (TMR) qui s’évalue à l’inspection,
à la palpation (un muscle au repos conserve une fermeté) et à la mobilisation.
On teste aussi l’extensibilité : un muscle sain se laisse étirer jusqu’aux amplitudes physiologiques des
articulations ; et la passivité : c’est l’aptitude du muscle à recevoir des mouvements communiqués.
A l’issue du bilan TMR on peut savoir si le tonus musculaire est augmenté, diminué ou normal, donc
savoir si le sujet à une musculature hypertonique, hypotonique ou normale.
IV – Bilan des Sensibilités
(Cf. « Notions Générales de Kiné Active » sur les récepteurs)
On investigue la sensibilité de défense, c’est-à-dire la sensibilité thermique et algique, et la sensibilité
d’analyse (tactile, profonde osseuse et articulaire).
V – Bilan de la Motricité
Il comprend un bilan fonctionnel et un bilan moteur fin, faisant intervenir les 3 motricités (R, A, V).
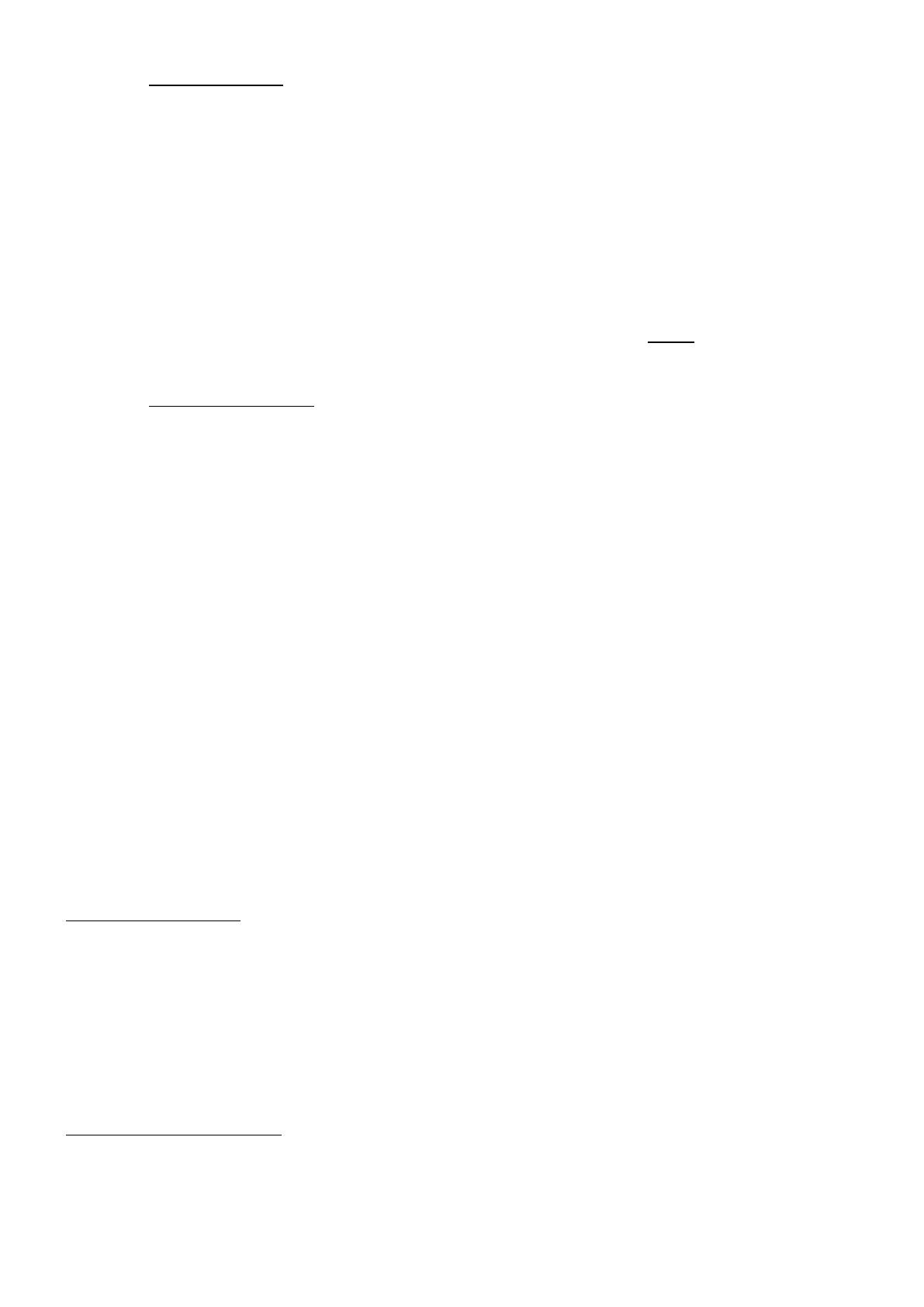
a) Bilan Fonctionnel
Il permet d’avoir des informations concernant l’autonomie du patient. On vérifie :
l’autonomie posturale :
- test des activités de redressement et de transfert du patient ;
- test des fonctions d’équilibration et de stabilisation en statique et en dynamique, et de
la marche (déroulement du pas, balancement des membres supérieurs, nécessité d’une aide
à la marche…)
l’autonomie gestuelle : c’est la capacité du patient à réaliser des gestes adaptés aux AVQ. On
évalue alors :
- les cadrans : main-bouche, main-tête, main-nuque, main-épaule opposée, main-poche,
main-poche opposée, main-poche postérieure, main-sacrum, main-espace interscapulaire ;
- les prises : fonction de préhension du patient ;
- l’autonomie dans les AVQ : le patient mange, se lave, etc… SEUL.
Ce bilan fonctionnel est à faire le plus rapidement possible.
b) Bilan des 3 Motricités
La Motricité Réflexe : testée par la présence ou l’absence des ROT, et s’ils sont là, on investigue
quelles sont leurs caractéristiques (perceptibles, vifs, polycinétiques…). On réalise aussi le réflexe
cutané (= polysynaptique), comme par exemple le réflexe cutané plantaire.
On cherche ensuite la présence de réflexes pathologiques comme :
- réflexe de Mendel : qd percussion du dos de la main flexion des doigts ;
- réflexe de Babinski : qd grattage du bord externe du pied extension de l’hallux.
La Motricité Automatique : investiguée en partie dans le bilan fonctionnel (équilibre, tonus postural,
etc…). On vérifie aussi la présence ou l’absence des syncinésies de coordination (F des doigts E
automatique du poignet ; F des orteils triple F du mb inf).
La Motricité Volontaire : investiguée par rapport à ses caractéristiques (force, direction, amplitude).
La force est bilantée de 2 façons :
- Bilan analytique : testing musculaire, dans les pathologies de type périphériques ;
- Bilan de la qualité du mouvement : dans les pathologies de type centrales.
La direction est vérifiée par la réalisation par le patient d’un mouvement adapté, avec puis sans le
contrôle visuel.
L’amplitude du mouvement est ensuite vérifiée, donc la coordination aussi.
Ce bilan de la motricité V donne des informations sur la capacité du patient à contracter un muscle
bien précis.
Des tests permettent de savoir si la motricité V est atteinte ou n on :
- au mb sup : épreuves des bras tendus : en E/Sup, sans support visuel :
- au mb inf : en DD, le patient doit maintenir le F de H et de G à 90°.
Si relâchement du membre ou chute du membre : pathologies centrales.
VI – Bilan Respiratoire
On peut le faire dès l’inspection : lèvres cyanosées, extrémités bleues, ailes du nez pincées…
L’environnement va dire si le patient a de l’oxygène, s’il est intubé-ventilé.
Le bilan respiratoire porte aussi sur l’encombrement des voies aériennes supérieures et bronchiques. Il
faut vérifier la dyspnée (respiration aisée ou recherche de la respiration) = c’est la mauvaise respiration.
On vérifie la fonctionnalité des muscles respiratoires (diaphragme, transverses, abdominaux,
respirateurs accessoires). On explore aussi le type de respiration (thoraco-abdominale, thoracique
uniquement ou abdominale uniquement…), savoir si le patient a une respiration naso-buccale, naso-
nasale, bucco-buccale.
VII – Bilan Cardiovasculaire
On vérifie la T.A., la fréquence cardiaque. Il faut également porter attention aux signes de phlébite
lorsque le patient a une ou ses deux jambes immobilisées (plâtre, etc…)
On regarde ensuite le traitement médical en cours (prise d’hypo ou d’hypertenseurs, etc…).
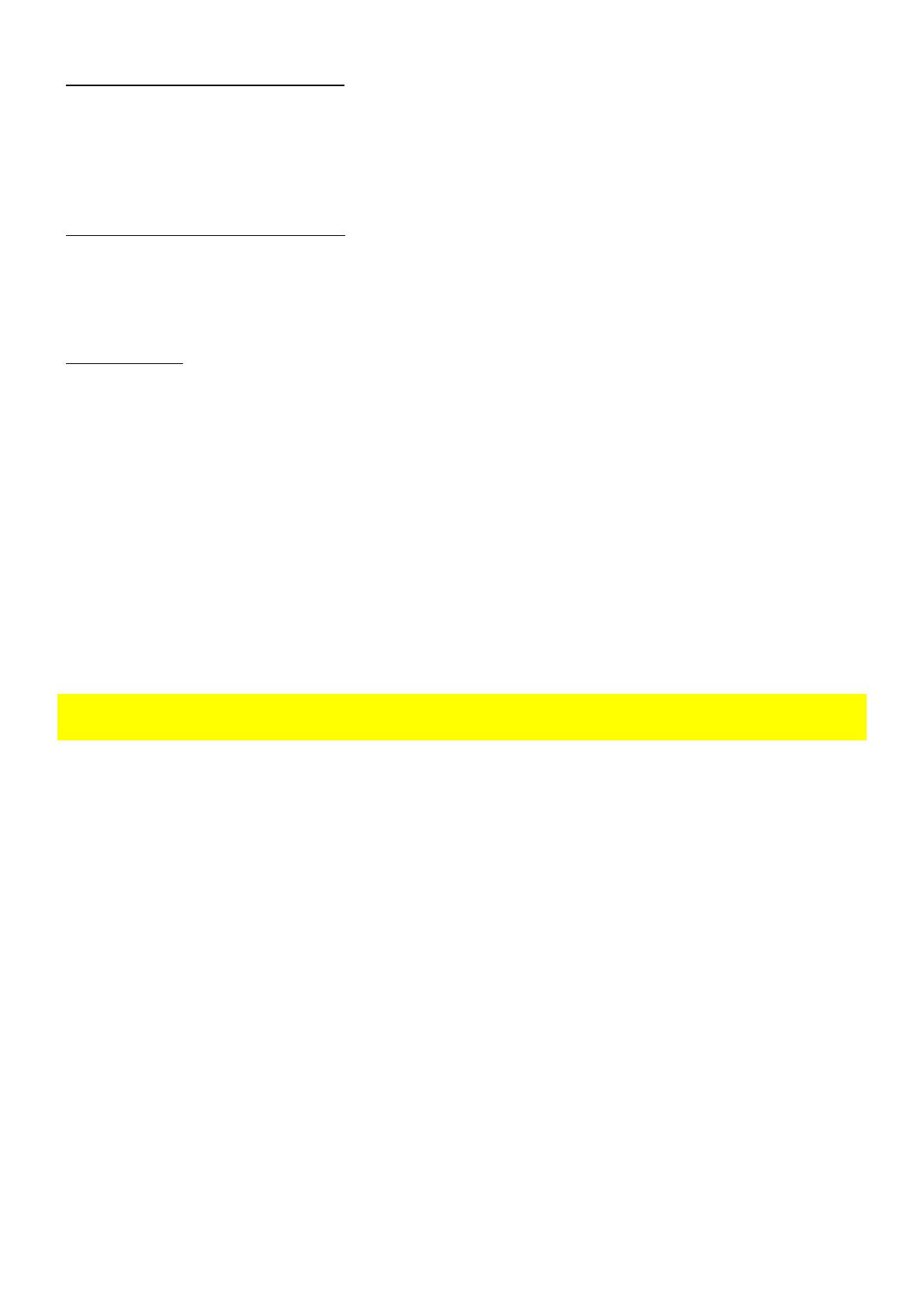
VIII – Bilan de la Fonction Digestive
Il faut s’assurer du mode d’alimentation du patient (comment est-il nourri, s’il est autonome ou nourri
par IV ou par sonde gastrique).
On vérifie l’intégrité du tube digestif (si le patient a une poche de colostomie par exemple), la
déglutition (possible rééducation à la déglutition), le transit intestinal (diarrhée, constipation), le
traitement en cours, l’hydratation (miction), etc…
IX – Bilan des Fonctions Supérieures
On teste la capacité de communication du patient, sa possibilité de parler, s’il a une aphasie
d’expression ou de compréhension. On vérifie l’organisation temporo-spatiale, l’adaptation du
patient (= compréhension en rapport avec ses capacités) et on évalue le psychisme du patient (dépressif,
suicidaire…)
X – Conclusion
Une fois ces investigations terminées, on peut réaliser le bilan-diagnostic kinésithérapique. Ce BDK est
un impératif incontournable, synthétique et court, qui permet en une phrase de résumer tous les
déficits objectivés lors des bilans, car les déficits vont entraîner des incapacités, lesquelles incapacités
ont des répercussions dans la vie quotidienne qui entraînent des handicaps.
Ce BDK comporte un pronostic kinésithérapique (= une hypothèse de guérison), donné par rapport au
projet du patient. Il faut bien entendu que le patient adhère aux processus thérapeutiques proposés.
Le BDK permet d’amener les objectifs thérapeutiques de rééducation :
- à court terme ;
- à moyen terme ;
- à long terme ;
listés par ordre de priorité. A chaque objectif de rééducation correspond une technique de rééducation la
plus appropriée.
Il faut enfin parler des précautions et des contre-indications.
Le bilan-diagnostic kinésithérapique est une étape incontournable, puisque c’est la première étape de
la rééducation du patient.
1
/
3
100%