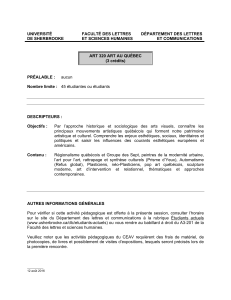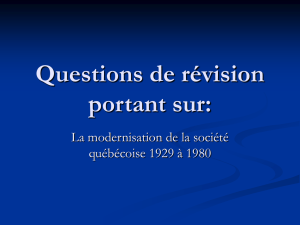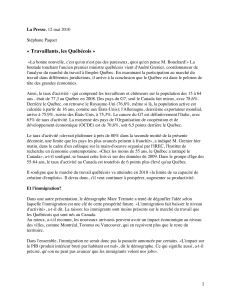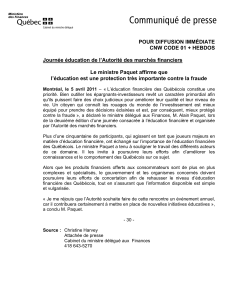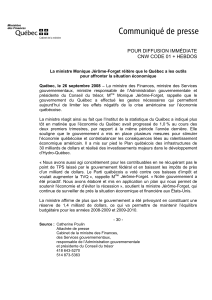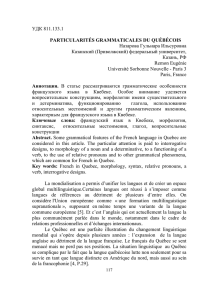La norme du français québécois - Office québécois de la langue

[p. 33]
LA NORME DU FRANÇAIS QUÉBÉCOIS : L’AFFIRMATION
D’UN LIBRE ARBITRE NORMATIF
Robert Vézina
Terminologue
Office de la langue française
Nous aborderons quelques aspects de la problématique qui entoure la question de la norme
linguistique au Québec, plus particulièrement l’explicitation de la norme lexicale;
autrement dit, c’est d’un aspect important du français standard tel que pratiqué au Québec
qu’il sera question. Nous ne nous attarderons pas aux différents types de normes : norme
prescriptive, norme spontanée, norme objective, norme subjective, norme implicite, norme
explicite, norme officielle, etc. C’est la norme comme modèle du bon usage de la langue
française au Québec qui nous intéresse, avec ce qu’elle comporte de prescription et de
subjectivité, mais également d’objectivité et de description. Il sera aussi question de
québécismes (faits de langue caractéristiques du français québécois), puisque ce sont sur
eux principalement que se fonderait l’existence d’une norme lexicale québécoise distincte.
Le bon usage au Québec : français standard ou français québécois standard?
À quoi correspond le modèle linguistique de référence, le français standard, pour le
francophone québécois? Est-il le même que pour un Français, pour un Belge ou pour un
Sénégalais?
Quelques réponses ont été proposées au fil des ans. Rappelons que dès 1965, l’Office de la
langue française a exprimé son point de vue quant à la norme du français qu’il faut établir
pour le Québec : l’usage doit s’aligner sur le français international1. Les divergences ne
sont acceptables que dans le seul domaine lexical, dans la mesure où les canadianismes
désignent des réalités nord-américaines pour lesquelles le français international n’a pas de
termes appropriés. Quatre ans plus tard, dans son opuscule intitulé Canadianismes de bon
aloi, l’Office de la langue française affirmait que la diffusion du français commun n’allait
pas de pair avec un alignement aveugle sur le lexique parisien et que certains termes
québécois demeuraient nécessaires pour décrire le milieu de vie
[p. 34] québécois; d’autres termes étaient vus comme tout aussi valables que leurs
équivalents parisiens, voire préférables s’ils permettaient d’éviter un anglicisme. Quoique
timides, ces premières prises de position officielles attestent de la volonté d’établir une
norme pour le Québec, applicable dans l’enseignement et l’Administration, c’est-à-dire un
français international très légèrement québécisé2. Il n’est alors nullement question d’un
français québécois standard.
Toutefois, on remarque que depuis la célèbre résolution que l’Association québécoise des
professeurs et professeures de français a prise en 19773, plusieurs articles, surtout de la
plume de linguistes, ont affirmé la réalité d’un français québécois standard, bien que les
1 Office de la langue française (1965). Norme du français écrit et parlé au Québec, p. 6.
2 Dans cette optique, les québécismes sont acceptables dans la langue soignée dans la mesure où ils sont
« utiles » : ils comblent une lacune terminologique ou ils permettent de préserver la francité du lexique.
3 « Que la norme du français dans les écoles du Québec soit le français standard d’ici. » Cité dans : Conseil de
la langue française (1990), p. 31.

2
appellations varient, ce qui signale peut-être la difficulté d’étiquetage de ce registre
québécois que l’on considère de niveau standard (Martel et Cajolet-Laganière, 1996 :
Français québécois standard; Poirier, 1998 : La norme du français du Québec; Corbeil,
2000 : Norme du français correct propre au Québec). En 1985, l’Énoncé d’une politique
linguistique relative aux québécismes de l’Office de la langue française donnait de la norme
de la langue française au Québec une vision plus nuancée que celle de 1965 : « Cette
norme, qui s’insère dans le processus d’aménagement linguistique du Québec, doit tenir
compte du contexte socioculturel et sociolinguistique du Québec, de sa situation
géographique et de son appartenance à la francophonie » (p. 10). Cet énoncé affirmait par
ailleurs l’autonomie normative du Québec (p. 37). Mentionnons également que le rapport
du Conseil de la langue française remis en 1990 au ministre responsable de l’application de
la Charte de la langue française stipule « qu’il existe un français québécois standard, assez
près néanmoins de la norme internationale du français4 ». L’idée selon laquelle le français
du Québec serait doté d’une norme propre est désormais assez répandue dans le milieu
scientifique. Il importe ici de préciser que cette norme québécoise concerne essentiellement
le lexique, la grammaire du français telle que décrite dans les ouvrages européens faisant
encore l’unanimité, sauf peut-être sur des aspects de la féminisation des titres de fonction et
sur des points de détail. Évidemment, si on examine l’usage réel de la langue, on peut
percevoir plusieurs écarts par rapport à la grammaire standard. Quant à la
[p. 35] phonologie et à la phonétique, il est connu que le modèle radio-canadien symbolise
depuis longtemps ce que les Québécois valorisent sur le plan de la prononciation (v.
Gendron, 1990 : 374).
L’explicitation d’une norme implicite
L’existence d’une norme locale ne se vérifierait pas qu’au Québec. La linguiste belge
Marie-Louise Moreau (1999 : 56) constate qu’un « certain nombre de communautés
nationales – sinon toutes – se sont dotées d’une norme propre [...]. Autrement dit, les
standards locaux ne doivent pas être élaborés. Ils existent déjà et fonctionnent déjà comme
tels dans les faits, même s’ils ne sont guère décrits et s’ils ne bénéficient que d’une
légitimité très limitée dans le discours normatif institutionnel ».
Nous en sommes donc rendus à expliciter, à préciser et à valoriser cette norme québécoise
qui fonctionne de façon implicite. Il semble que ce soit l’aboutissement normal du grand
projet d’aménagement linguistique amorcé dès les années soixante; on peut même y voir la
suite logique du travail de codification du français québécois amorcé par les auteurs de
manuels correctifs au XIXe siècle (v. Poirier, 1998 : 137). La valorisation du français
québécois dépend en effet directement de sa description et de son instrumentation
adéquates. En tant que communauté politique et culturelle distincte, qui a suivi une
évolution particulière, qui affirme son identité à travers une langue qui est sienne depuis le
XVIIe siècle, bref en tant que communauté complète et complexe, le Québec se doit
d’exercer son droit de propriété sur la langue française et d’assumer pleinement sa
différence tout en affirmant son appartenance à la francophonie, ce qui représente un défi
de taille. Comme le disait Corbeil (1986 : 294) : « Tant et aussi longtemps que nous
n’aurons pas instrumentalisé le français que nous avons promu comme langue officielle, il
nous manquera toujours un outil essentiel pour le bien-être de toute [la] communauté
linguistique. » Ce travail d’explicitation presse, comme le souligne le journaliste Daniel
4 Ibid, p. 28.

3
Raunet (2001 : 23) : « Le vrai problème, c’est le non-dit, le silence, le tabou qui entoure nos
choix dans un registre particulier : la langue soutenue. » Le travail est cependant
commencé, et plusieurs personnes et organismes y contribuent, chacun tirant profit des
travaux de l’autre.
La contribution de l’Office de la langue française
À l’Office de la langue française, la production terminologique quotidienne versée dans Le
grand dictionnaire terminologique participe à ce
[p. 36] travail d’explicitation de la norme lexicale5. Puisque l’un des mandats principaux de
l’Office est de « veiller à ce que 1e français devienne, le plus tôt possible, la langue des
communications, du travail, du commerce et des affaires dans l’Administration », le travail
terminologique vise la francisation et le développement continu des vocabulaires de
spécialité, travail qui a débuté par un important chantier de mise à niveau rendu nécessaire
par le retard qu’avait pris le Québec dans ce domaine, étant donné l’utilisation généralisée
des terminologies anglaises.
Les politiques linguistiques en tant que balises normatives
L’Office s’est donné des politiques qui visent à guider le travail des terminologues en ce
qui concerne la norme; mentionnons : l’Énoncé d’une politique relative aux québécismes, la
Politique relative à l’emprunt de formes linguistiques étrangères et Titres et fonctions au
féminin : essai d’orientation de l’usage. Le travail de l’organisme porte essentiellement sur
le français écrit et parlé au Québec, ce qui revient à dire qu’il vise en premier lieu l’usage
québécois. Bien sûr, la diffusion gratuite du GDT sur Internet, les efforts de coopération
avec d’autres organismes linguistiques, notamment ceux de France, contribuent à diffuser
les choix terminologiques de l’OLF au-delà des frontières du Québec. Ainsi, l’Office
souhaite contribuer au développement du français en tant que langue de communication
internationale. Il n’en demeure pas moins que lorsque l’Office promeut l’usage du terme
téléavertisseur et déconseille, par exemple, l’usage du terme parking, c’est bien l’usage
correct du français au Québec que l’OLF précise. Bien sûr, l’usage des autres pays
francophones peut éventuellement être influencé par l’usage québécois, par l’entremise du
travail de l’Office ou de celui d’autres organismes (par exemple, ciné-parc et covoiturage
ont été officialisés en France).
Les québécismes et la norme
Les politiques de l’Office orientent le travail des terminologues et la façon d’expliciter des
éléments de la norme. Le traitement des québécismes, par exemple, a fait l’objet d’une
réflexion qui est exposée dans l’Énoncé d’une politique linguistique relative aux
québécismes, qui date de 1985. Un de ses principes directeurs s’énonce ainsi :
« Les québécismes doivent principalement servir à dénommer des réalités concrètes ou
abstraites qui n’ont pas de correspondant ou qui
5 Le service de consultation téléphonique représente un autre vecteur d’intervention de l’OLF; l’organisme est
vu par plusieurs citoyens comme un guide sur toutes les questions concernant l’usage correct de la langue
française.

4
[p. 37] ne sont pas encore dénommées en français, ou pour lesquelles les dénominations
québécoises qui les expriment ont acquis un statut linguistique ou culturel qui les rend
difficilement remplaçables » (p. 16).
En faisant éclater le carcan des termes qui désignent des réalités d’ici, la dernière
proposition de ce principe a une grande portée et, à elle seule, confirme la diversité des
particularismes linguistiques dignes de figurer dans le registre soigné du français québécois.
Toutefois, puisque la plupart des québécismes semblent avoir un statut linguistique ou
culturel qui les rend difficilement remplaçables, le terminologue doit avoir recours à des
critères plus précis pour l’aider à effectuer ses choix : la variante québécoise désigne-t-elle
une réalité québécoise ou nord-américaine? Remplace-t-elle avantageusement un emprunt?
Est-elle productive sur le plan morphologique (dérivés et composés)? Sa fréquence d’usage
est-elle élevée? Est-elle bien formée? Est-elle un emprunt qui concurrence inutilement un
terme français? Ces critères d’acceptation et de rejet sont utiles, vu que, dans une optique
d’orientation de l’usage, tous les termes ne sont pas égaux, qu’ils soient des québécismes
ou non. Le constat général que l’on peut faire cependant, c’est que l’usage de québécismes
dans une terminologie française de qualité est dûment reconnu par l’OLF.
Les québécismes dans les langues de spécialité
En terminologie française, la variation topolectale n’est pas toujours sensible et, dans
plusieurs domaines spécialisés, la plupart des termes revêtent un caractère tout à fait
universel. Ainsi, tout le monde francophone s’entend sur ce que désignent les termes arbre
à cames en tête, clé dynamométrique à cadran et machine à commande numérique. La
normalisation des vocabulaires techniques constitue d’ailleurs un des aspects du travail
terminologique, qui tend idéalement vers l’univocité des termes et l’uniformisation des
usages6. Sur ce point, de nombreux organismes de normalisation tels que l’ISO, le BNQ et
l’AFNOR peuvent orienter certains choix terminologiques7. L’absence de barrière
culturelle,
[p. 38] si on veut bien l’appeler ainsi, est également observable en contexte de néologie.
Toutefois, on ne saurait nier l’existence de la variation topolectale, même dans le domaine
des langues de spécialité. Certains secteurs y sont plus sujets que d’autres, notamment ceux
touchant la vie sociale (politique, comptabilité, assurances, loisir, etc.) ou qui sont rattachés
à des activités plus ancrées dans la tradition socioéconomique québécoise (acériculture,
agriculture, foresterie, etc.). Cette variation n’est pas sentie comme nuisible aux relations
entre francophones. Ainsi, pour désigner la personne qui effectue une mission de
vérification, au Canada on emploie vérificateur, en France, auditeur, et en Belgique,
réviseur.
Les québécismes de la langue générale
6 Rousseau (1994 : 41) rappelle avec justesse que l’univocité du terme technique « se heurte dans la pratique à
des variations terminologiques de différents types ». Il mentionne notamment la variation topolectale, la
variation sociotechnolectale et la variation technico-commerciale.
7 Il convient de noter que le terminologue conserve son sens critique face à un terme diffusé par une norme
technique; certain sont rejetés, car ils s’accordent mal à la sémantique du français général. Cholette (1994 :
503) donne l’exemple du terme tiré d’une norme AFNOR concernant le textile : chef de pièce. Ce terme n’a
pas été retenu car, calqué de l’anglais leader sloth, il s’accorde mal avec la sémantique du mot chef. Le terme
avant-pièce a été retenu.

5
Lorsqu’on traite des termes qui relèvent de l’usage spécialisé, les principes de la
socioterminologie conduisent bien entendu les terminologues à prendre en considération les
usages qui prévalent dans les milieux concernés. Lorsque la terminologie traitée touche
également la langue générale, un critère prend une importance particulière, celui de la
hiérarchisation des usages telle que l’ensemble de la communauté se la représente. Dans de
tels cas, est-ce que la norme, le bon usage, n’est que le reflet de la langue courante? La
réponse est évidemment non. Il faut bien avouer que l’on doit dans certains cas proposer
des choix terminologiques moins représentés dans l’usage courant, mais qui cadrent avec
un modèle idéal, qui s’appuie notamment sur les critères d’acceptation précédents. La
pondération de ces critères ne va pas nécessairement de soi. Par exemple, les critères de
productivité morphologique et de résonance internationale doivent-ils toujours primer sur
celui de la fréquence d’emploi dans la langue courante? La difficulté d’implantation de
certains termes n’est pas toujours imputable aux lacunes de la stratégie de diffusion, mais
s’explique sans doute en partie dans une pondération inadéquate des différents critères de
sélection8. Cela
[p. 39] dit, les terminologues de l’Office tiennent de plus en plus compte de l’usage courant
dans leurs propositions terminologiques, et ce, pour faciliter l’implantation ou la
reconnaissance d’un bon usage conforme au sentiment linguistique des Québécois. Ainsi,
l’existence d’un terme technique ou scientifique n’empêche naturellement pas la
reconnaissance d’un terme de la langue générale pour désigner une même réalité (cf. thuya
et cèdre). Les terminologues s’intéressent aussi aux tendances évolutives de la création
lexicale du français, lesquelles peuvent rendre normales des formes traditionnellement
jugées comme non orthodoxes (ex. : approche client, clavardage, webmestre); ils s’ouvrent
à l’emprunt, ce qui inclut le calque, comme procédé d’enrichissement de la langue : applet
(< angl. applet), lien retour (< angl. back link), pont-routeur (< angl. bridge-router), tout en
respectant la sensibilité québécoise face à ce phénomène.
Les tensions entre l’usage et le modèle prescrit
L’écart occasionnel entre l’usage courant et le modèle prescrit, voire entre différents
modèles prescrits concurrents, est la source d’un malaise que d’aucuns qualifient
d’insécurité linguistique; ce problème, présent dans toute la francophonie, est
particulièrement aigu au Québec (pensons à fournaise que ne peut déloger chaudière).
L’OLF n’étant pas le seul organisme à expliciter le bon usage et à diffuser un discours
officiel sur cette question, et ne prétendant pas le devenir, ses choix terminologiques ne
sont évidemment pas partagés par tous. Parmi plusieurs exemples, on se rappellera le cas
des mots épluchette et canot (au sens de « canoé »), inclus parmi les canadianismes de bon
8 Prenons par exemple roulotte au sens de « remorque de camping », qui est vieilli en France. Le terme y a été
progressivement remplacé par caravane, emprunté à l’anglais britannique, probablement parce que roulotte
évoque plutôt les Tsiganes nomades et désigne souvent un véhicule hippomobile. Au Québec, roulotte
demeure largement employé, même dans la langue commerciale; il n’évoque pas automatiquement les
Tsiganes, réalité peu présente en Amérique du Nord. Pour la majorité des Québécois, une caravane évoque
plus naturellement un groupe de personnes qui se déplacent (éventuellement avec leurs roulottes) qu’une
roulotte seule. Caravane a été officialisé par l’OLF en 1980. Vingt ans plus tard, caravane a pénétré l’usage
officiel (il est adopté par la Fédération québécoise de camping et de caravaning), mais moins l’usage courant.
Pourtant, ce terme avait pour lui la nouveauté, son caractère international et le fait de s’inscrire dans la famille
de caravaning et de caravanier, termes assez bien implantés au Québec. Tremblay (1994 : 63) montre que
roulotte correspond à la norme spontanée et à la norme préférée d’environ 80 % de son échantillon, tandis que
caravane correspond à la norme spontanée de moins de 2 % de l’échantillon et à la norme préférée de 7 % de
celui-ci.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%