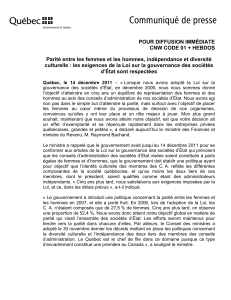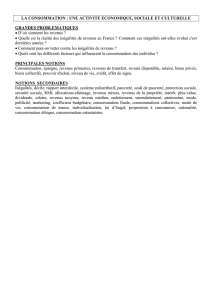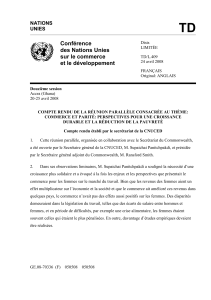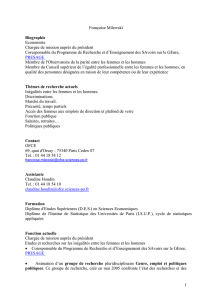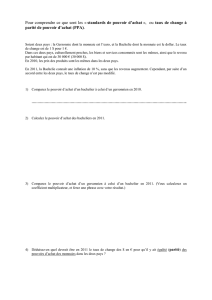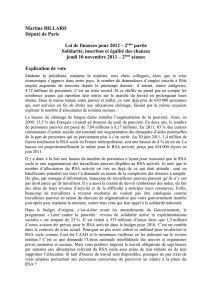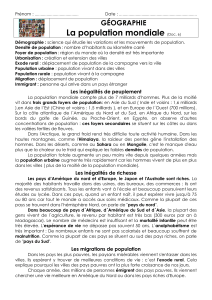B) Enjeux et réponses actuelles face à la crise de l`Etat - E

86
86
86
B) Enjeux et réponses actuelles face à la crise de l’Etat
Providence
1°) Réforme des retraites et de l’assurance maladie : où en est-on ?
En matière de protection sociale, deux branches connaissent des difficultés
financières, la branche vieillesse et la branche maladie, conduisant les pouvoirs publics
-- à engager des réformes qualifiées de structurelles.
a) La réforme du système de retraite
En 1993, le gouvernement d’Edouard Balladur a modifié la durée d’annuité dans le
secteur privé et le niveau futur des pensions de retraites en indexant celles-ci sur
l’évolution des prix et non plus sur l’évolution du salaire moyen.
Document n°119
Les effets de la réforme Balladur (estimation de l’évolution, jusqu’en 2040, du taux de
remplacement (rapport entre première pension et dernier salaire) net de cotisations des
salariés du secteur privé à législation constante ayant effectué une carrière complète).
2000
2020
2040
Carrière toujours au
SMIC
81%
70%
68%
Carrière au salaire
moyen des non-
cadres
84%
71%
67%
Carrière au salaire
moyen des cadres
75%
62%
58%
Conseil d’Orientation des retraites, in Arnaud Parienty, « Protection sociale : le
défi », éd Gallimard, 2006, p.42.
Document n°120
« La proportion de salariés du secteur privé bénéficiant du minimum contributif est déjà
passée de 25% des partants au début des années 1990 à 40% au début des années 2000.
Elle pourrait bientôt être de 60%. Le minimum a été réévaluée pour le régime général
passant de 534 euros à 589 euros pour le régime de base ».
Arnaud Parienty, « Protection sociale : le défi », éd Gallimard, 2006, p.45
Après l’échec de la réforme des régimes spéciaux en 1995 sous l’égide du
gouvernement d’Alain Juppé, il a fallu attendre 2003, pour les pouvoirs publics se
lancent dans une nouvelle réforme concernant la fonction publique.
Le 24 juillet 2003, malgré une forte protestation, le Parlement adopte un projet de
réforme des retraites. Il en ressort que :
- « (…) dans le secteur public, il faudra cotiser pendant
quarante ans comme dans le privé, et que cette durée de
cotisation sera prolongée pour tous à quarante et un ans en
2008 et à quasiment quarante deux ans en 2020.

87
87
87
- (…) la revalorisation des pensions se fera pour tous sur
les prix (alors que les fonctionnaires voyaient leur pension
augmenter au même rythme que les salaires de la fonction
publique) ».
- la mise en œuvre « (…) d’un système de bonification
(« surcote ») en cas de départ à la retraite au delà des 60
ans et de sanction (« décote ») en cas de départ avant cet
âge et d’années de cotisations manquantes »
1
.
Par ailleurs suite à des négociations avec la CFDT et la CGC, « le gouvernement
annonce qu’il garantit un taux de remplacement de 85% du SMIC pour les plus basses
retraites et un taux de 66% pour toutes les autres retraites (le taux de remplacement
moyen en France, est en 2003 de 74%).Il annonce que les personnes ayant accumulé
plus de quarante ans de cotisations avant 60 ans et ayant commencé à travailler entre 14
et 16 ans pourront partir à l’âge de 58 ans. Il annonce la création d’un régime
complémentaire par point pour prendre en compte les primes des fonctionnaires. Il
annonce enfin une hausse de 0.2% des cotisations sociales à partir de 2006 pour
financer les départs avant 60 ans, en comptant sur la baisse à venir du chômage pour
financer les grands déséquilibres (ces mesures ne devraient permettre de couvrir qu’un
tiers des déficits futurs »
2
.
Enfin, un système de fonds de pension a été créé en France, malgré l’existence d’un
certain nombre de critiques. Le gouvernement de M. J.P. Raffarin a transformé les
« plans partenariaux d’épargne salariale volontaire » (épargne sur le long terme,
sommes faisant l’objet d’une exemption fiscale et délivrables sous forme de capital ou
de rente) en plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR).
Document n°121
« (…)les sommes ne sont plus bloquées durant dix ans, mais jusqu’au départ à la
retraite. A ce dispositif s’ajoute le plan d’épargne individuel pour la retraite (PEIR),
« produit d’assurance, géré sur les marchés financiers par une compagnie d’assurance,
une institution de prévoyance ou une mutuelle et placé sous le contrôle d’un comité de
surveillance émanant des adhérents individuels aux groupements d’épargne individuels
pour la retraire qui auront, eux, le statut d’associations. Il est destiné à recevoir
l’épargne individuelle et reverser après départ à la retraite une rente viagère »
3
.
Les arguments essentiels en faveur des fonds de pension en
France sont les suivants :
- le fait de mettre en œuvre des dispositifs d’épargne
retraite volontaire au caractère individuel permet de
résoudre le problème démographique ;
- la constitution de fonds de pension permet également à
l’économie française de disposer d’un réservoir national
d’épargne longue ; susceptible de concurrencer les fonds
de pensions anglo-saxons
1
Bruno Palier, « La réforme des retraites », Ed Puf, Coll « Que sais-je ? », 2003, p.107.
2
Bruno Palier, « La réforme des retraites », Ed Puf, Coll « Que sais-je ? », 2003, p.107.
3
Bruno Palier, « La réforme des retraites », Ed Puf, Coll « Que sais-je ? », 2003, p.116.

88
88
88
Document n°122
« Ainsi N. Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, déclarait : « Les salariés
européens et français doivent quand même se demander maintenant s’ils vont continuer
à laisser les fonds de pension anglo-saxons (…) avoir le monopole de l’intervention
dans le capital des entreprises françaises et européennes ».in B. Palier, « La réforme des
retraites », Ed Puf, Coll « Que sais-je ? », 2003, p.112-113. « Dans un rapport du
Conseil d’analyse économique, François Morin montre que les entreprises françaises
ont besoin de capitaux issus de fonds de pension français pour ne plus se faire dicter
leur loi par les fonds de pensions américains », in B. Palier, « La réforme des
retraites », Ed Puf, Coll « Que sais-je ? », 2003, p.113.
- la généralisation des fonds de pension permettrait de
développer un actionnariat populaire susceptible de
générer un meilleur contrôle de la part des salariés de la
gestion des entreprises.
Document n°123
« Certains imaginent d’actionner le levier de l’épargne salariale pour reconquérir du
pouvoir sur le capital, et projettent de donner une réalité institutionnelle à l’idée que les
salariés sont les véritables propriétaires puisqu’ils sont les détenteurs finaux des
actions des entreprises. D’autres vont plus loin encore et rêvent d’une société politique
entièrement reconstruite autour de la question patrimoniale »,
in F. Lordon, « Fonds de pension, piège à cons ? Mirage de la démocratie actionnariale », Ed
Liber/Raisons d’agir, 2000, p.12.
Face à ces arguments, il convient de relever les critiques suivantes.
Document n°124
La mise en œuvre d’un système de retraite par capitalisation ne résoud pas le problème
démographique dans la mesure où « les richesses réelles que les retraités
consommeront demain avec leurs pensions, quel que soit le système, devront bien être
prélevées sur la production disponible à ce moment là. Le recours à la capitalisation,
en complément de la répartition, est au mieux un moyen d’accroître la part du revenu
national dédiée aux retraités au détriment des actifs en lui donnant un autre fondement
(la possession de droits de propriété se substitue à un droit de tirage sur les générations
futures), mais elle a au niveau macroéconomique le même effet qu’une hausse des
cotisations ».
Ph. Frémaux, art : « Le casse-tête des retraites », in Alternatives économiques, n°164,
novembre 1998, p.37-41.
Document n°125
Cela n’empêche pas le fait que « Les retraites de l’an 2020 vivront de biens et services
produits en 2020 »
4
.
Document n°126
« Par ailleurs, d’un point de vue macroéconomique, le rendement de la capitalisation
ne peut être supérieur que si au minimum le taux d’intérêt est toujours plus élevé que le
taux de croissance de la valeur ajoutée (qui définit le rendement des cotisations dans un
système par répartition), hypothèse enfin difficilement tenable dans une perspective de
long terme.
4
P. Sohlberg, art : « La grande illusion des fonds de pension », in Alternatives économiques,
n°31, hors-série, 1er trim 1997, « Protection sociale : l’heure des choix », p.28-29.

89
89
89
En effet, elle implique une déformation continue du partage de la valeur ajoutée au
détriment des revenus du travail et au profit des revenus du capital, ce qui ne paraît
soutenable ni au niveau pratique ni au niveau théorique »
5
.
Du point de vue de la nécessité de favoriser l’épargne au moyen de la
constitution de fonds de pension, il convient de relever que la faiblesse des taux
d’épargne dans un certain nombre de pays industrialisés est plus le résultat d’une
croissance molle (et non sa cause au passage) que de l’absence de fond de pension, et
qu’aux Etats-Unis, le taux d’épargne, fonds de pension inclus, est particulièrement
faible. Il en résulte que le véritable argument en faveur des fonds de pension ne se situe
pas autour de la question de leurs capacités à élever le taux d’épargne, mais plus
fondamentalement, à même niveau de taux d’épargne, à assurer une meilleure allocation
des ressources en capital. Les défenseurs des fonds de pension considèrent que ceux-ci
permettent de renforcer les mécanismes de financement de l’économie par les marchés
financiers (développement des marchés d’actions et d’obligations), mécanismes qui sont
considérés comme plus efficaces économiquement que le système traditionnel de
financement bancaire. Or, les observations empiriques ne permettent guère de
démontrer une telle efficacité, et du point de vue du financement, la tendance aux Etats-
Unis est au « buy-back », c’est-à-dire au rachat par les entreprises de leurs actions
6
.
Du point de vue de la possibilité de voir émerger un véritable pouvoir de gestion et
de contrôle par et pour les salariés, le tableau est moins idyllique qu’il n’y paraît.
L’histoire des fonds de pension aux Etats-Unis est avant tout l’histoire d’une montée
en puissance du pouvoir actionnarial, le temps des « entreprises providence » dans
lesquelles des plans de retraite à prestations définies, sous le contrôle et la gestion de
l’entreprise même et de son chef, est désormais largement remis en cause.
Document n°127
Se développe aujourd’hui « (…) une formule de retraite de fait individualisée
puisque les cotisations sont versées sur un compte personnel associé à chaque salarié et
transférable d’un employeur à un autre. Le terme logique de ce désengagement
progressif de l’entreprise réside dans son retrait de la gestion même qui se retrouve
déléguée à des intermédiaires financiers spécialisés : les fonds de pension et les fonds
mutuels »
7
.
Ces intermédiaires financiers, ce nouveau pouvoir actionnarial, ne laissent guère de
place aux petits actionnaires salariés et à une démarche éthique ou sociale, puisque par
nécessité, ces fonds de pension se doivent de garantir une maximisation de la rentabilité
des capitaux propres, au mépris parfois de stratégies industrielles de croissance.
« Cette possibilité d’un « socialisme des fonds de pension » est démentie par
l’expérience des fonds gérés par les syndicats américains qui montre que la logique
financière l’emporte nécessairement sur la logique salariale dans leur gestion »
8
.
5
Jean Claude Barbier, Bruno Théret, « Le nouveau système français de protection sociale », Ed
La Découverte, coll « Repères », 2004, p.60.
6
Cf. F. Lordon, op-cit, p.41-42.
7
F. Lordon, op-cit, p.34.
8
Jean Claude Barbier, Bruno Théret, « Le nouveau système français de protection sociale », Ed
La Découverte, coll « Repères », 2004, p.63.

90
90
90
b) Assurance maladie : quelle réforme ?
Jusqu’au début des années 80, la sécurité sociale a joué un rôle majeur en matière de
remboursement face aux risques qu’encouraient les individus (« progression à froid des
mécanismes de protection sociale » selon P. Rosanvallon), mais depuis le milieu des
années 80, une inflexion sensible se fait jour
9
. Les ménages et les assurances
complémentaires sont amenés à prendre en charge un peu plus massivement les
conséquences des risques sociaux et en particulier en matière de maladie.
Document n°128
« Il n’existe au fond que trois grands principes de régulation. Le principe de la
demande solable est intégralement marchand : celui qui dispose des moyens de
paiement peut les dépenser comme il l’entend, sur un marché libre. La contrainte
budgétaire consiste à définir un certain nombre de prestations offertes à peu près
gratuitement mais dont le périmètre est limité en fonction d’une nomenclature et d’une
enveloppe financière. La délibération financière. La délibération démocratique consiste
à définir un certain nombre de droits sociaux qui doivent être garantis sous forme d’une
gratuité socialisée »
10
.
La montée en puissance des mutuelles et des assurances privées
Quelques soient les données utilisées, on constate une montée en puissance des
mécanismes de prise en charge par les complémentaires (assurances et mutuelles) ou
directement par les ménages .
Document n°129
Structure de financement de la dépense courante de soins et de biens
médicaux
1960
1980
2000
Ménages et autres
assurances
complémentaires
32.4
13.8
16.1
Mutuelles
5.2
5.1
7.4
Etat
9.2
3.0
1.1
Sécurité sociale
53.2
78.2
75.4
Source : Alternatives économiques, Hors série, n°58, 3ème trim 2003.
Structure de financement de la dépense courante de soins et de biens
médicaux en 2002 en %
Sécurité sociale
75.7
Etat et collectivité locales
1
Institutions de prévoyance
2.5
Assurances
2.7
Mutuelles
7.5
Ménages
10.6
Source : Le Monde, 25 juillet 2003
9
Cela correspond à un changement d’orientation de la politique économique et sociale dès 1983 :
- mise en oeuvre de la politique de rigueur ;
- lutte contre l’inflation et politique de désinflation compétitive ;
volonté de stabiliser et de réduire le poids des prélèvements obligatoires.
10
Michel Husson, « Les casseurs de l’Etat social. Des retraites à la Sécu : la grande démolition »,
Ed La Découverte, 2003, p.61.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
1
/
91
100%