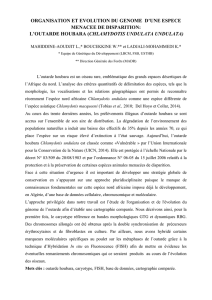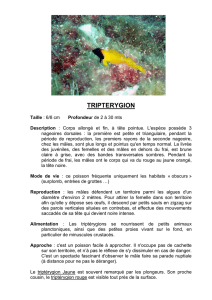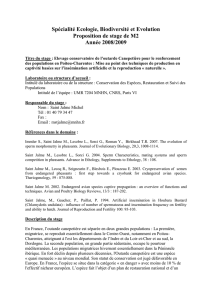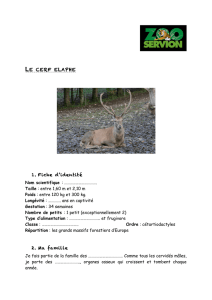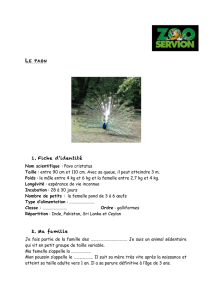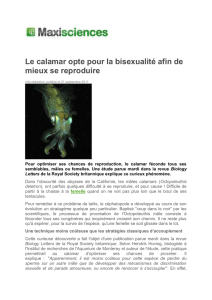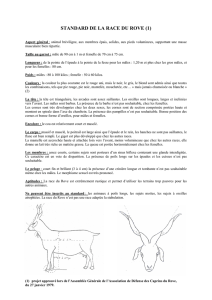Mention Ecologie, Biodiversité et Evolution

Mention Ecologie, Biodiversité et Evolution
Proposition de stage de M1 / M2
Année 2006/2007
Titre du stage : Les signaux liés aux parades sexuelles chez l’outarde houbara sont-ils des
indicateurs honnêtes de l’état de santé des oiseaux.
Laboratoire ou structure d’accueil :
ECWP (Emirats Center for Wildlife Propagation), Missour; Maroc
Responsable du stage :
Michel Saint Jalme
Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité
UMR 5173 MNHN-CNRS Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des Populations
Ménagerie du Jardin des Plantes
57 rue Cuvie, 75005 Paris
Tél : 01 40 79 34 47 ; E-mail : [email protected]
Références dans le domaine :
Articles récents dans le domaine de la sélection sexuelle et de l’étude des populations
d’outarde au Maroc :
Hingrat, Y., Saint Jalme, M., Ysnel, F., Lacroix, F., Seabury, J., Rautureau, P. 2004.
Relationships between home range size, sex and season with inference on the mating system
of the houbara bustard Chlamydotis undulata undulata. Ibis 146 : 314-326.
Loyau, A., Saint Jalme, M., Sorci, G. 2005. Intra and intersexual selection for multiple traits
in the peacock (Pavo cristatus). Ethology. 111,810-820.
Hingrat, Y., Saint Jalme, M. 2005. Mating system of the Houbara Bustard Chlamydotis
undulata undulata in eastern Morocco. Ardeola 52 (1) 91-102.
Loyau, A, Saint Jalme, M., Gagniant C., Sorci, G. 2005. Multiple sexual display
advertisements honestly reflects health status in peacocks (Pavo cristatus). Behavioral
Ecology and Sociobiology 58, 552-557.
Loyau, A, Saint Jalme, M., Sorci, G. 2007. Non-defendable resources affect peafowl lek
organization: a male removal experiment. Behavioural Processes 74, 64-70.
Hingrat, Y. Ysnel, F. Saint Jalme, M., Le Cuziat, J. Béranger, P.M. Lacroix. F. In press.
Assessing habitat and resource availability for an endangered desert bird species in eastern
Morocco: the Houbara Bustard. Biodiversity and Conservation.

Hingrat, Y., Saint Jalme, M., Ysnel, F., Le Nuz, E., Lacroix, F. In press. Habitat use and
mating system of the houbara bustard, Chlamydotis undulata undulata, in a semi-desertic area
of North Africa: implications for conservation. Journal of Ornithology.
Loyau A., Saint Jalme M., Mauget R., Sorci G. In press. Male sexual attractiveness affects the
allocation of maternal resources into the eggs in peafowl (Pavo cristatus). Behavioral Ecology
and Sociobiology.
Hingrat, Y. Saint Jalme, M. Chalah, T. Orhant, N. Lacroix, F. In press. Environmental and
social constraints on breeding sites selection. Does the exploded-lek and hotspot model apply
to the Houbara Bustard Chlamydotis undulata undulata ? Journal of Avian Biology.
Description du stage
L’écologie comportementale (Behavioral Ecology) peut schématiquement se définir comme
l’étude des stratégies utilisées par les individus pour maximaliser leur représentation
génétique dans les générations futures. La rencontre entre l’écologie comportementale et la
Biologie de la Conservation se concrétise par l’utilisation des résultats des études sur les
systèmes socio-sexuels, la compétition sexuelle, la compétition spermatique… pour élaborer
des plans de gestion et de conservation d’espèces menacées d’extinction. Dans ce cadre, un
programme de conservation peut être considéré comme un succès non pas parce qu’il a
permis d’augmenter le nombre d’individus de telle ou telle espèce ou parce qu’il a permis de
protéger un immense espace naturel, mais parce qu’il a permis de préserver les potentialités
évolutives et adaptatives d’une espèce ou d’un système plus complexe.
Cette problématique s’applique au programme de conservation de l’outarde houbara.
L'outarde houbara est une espèce qui présente une structure socio-sexuelle dite à « lek diffus »
(Hingrat et al., 2004). Chez de telles espèces, pendant la saison de reproduction, les mâles se
rassemblent pour parader sur des aires traditionnelles appelées « leks ». Les femelles viennent
les visiter dans l’unique but de se reproduire et n’obtiennent des mâles que leurs gènes
(Bradbury, 1981). Seule une faible proportion des mâles participent à la reproduction. La
sélection sexuelle est donc très forte.
D’après la théorie du « bon gène », qui s’applique à ce système socio-sexuel, les mâles
diffèrent en condition et en viabilité et ces paramètres sont transmis à la descendance. Les
femelles peuvent mesurer cette variation de valeur sélective par les traits ornementaux ou le
comportement de parade des mâles. Selon Hamilton et Zuk (1982), les femelles peuvent
augmenter la viabilité de leurs descendants en s'accouplant avec les mâles les plus
ornementés, qui présentent une meilleure résistance aux pathogènes.
Le sujet du stage consiste à vérifier cette hypothèse sur l’outarde houbara en captivité.
L’étude portera sur 70 mâles d’une même cohorte, nés en captivité. Il s’agira de caractériser
les paramètres morphologiques et comportementaux associés à la parade des mâles. La
variabilité interindividuelle de ces signaux sera ensuite mise en relation avec la réponse
immunologique induite lors d'un challenge immunitaire.
Basé sur l’hypothèse que le coût énergétique lié à l'activation du système immunitaire devrait
affecter le comportement de parade des mâles, nous nous attendons à trouver une relation
entre le degré d’ornementation des individus, leur activité de parade et leur aptitude à
répondre à une infection.

L’étude s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche associé à un élevage
conservatoire et au renforcement des populations d’outarde houbara dans l’Est Marocain. Ce
programme est mené par l’ECWP (Emirats Center for Wildlife Propagation), situé à Missour
au Maroc. Ce centre est une antenne du Ministère de l’environnement d’Abu-Dhabi.
Dans le programme d’élevage, selon les connaissances actuelles, les partenaires potentiels
sont choisis sur les bases de considérations démographiques et génétiques dans le but de
maximaliser la variabilité génétique et d’éviter la consanguinité. Dans les faits, cela revient à
égaliser la représentativité de chaque fondateur. Dans le cas des espèces à structure de lek, la
contribution des mâles à la reproduction se limite au transfert de matériel génétique. On peut
s’attendre selon la théorie des bons gènes à trouver dans les populations sauvages une relation
entre la valeur sélective des mâles et le choix des femelles. Par la non prise en compte du
choix des femelles dans la gestion des populations captives on pourrait observer une
augmentation de la variabilité de la fitness des descendants et donc une baisse globale de la
fertilité ou/et de la mortalité embryonnaire et juvénile (implication dans la gestion des
élevages en captivité). Cette altération de la valeur sélective globale de la population captive
et donc des oiseaux relâchés pourrait également réduire la survie des individus relâchés et
avoir un impact non négligeable sur les populations sauvages.
Ce stage est proposé à un master pro car au cours des dernières années, plusieurs Masters ont
été recrutés sur des thématiques de gestion des populations à l’issu de leur stage.
Pour les stages de M2
Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse : NON
1
/
3
100%