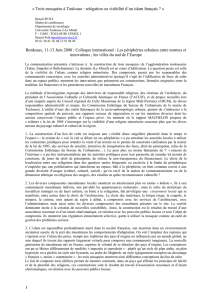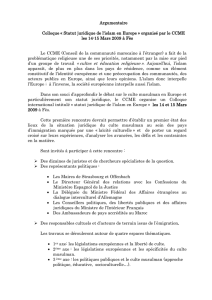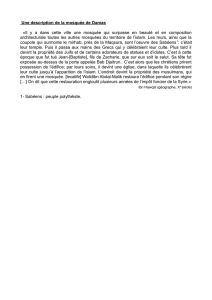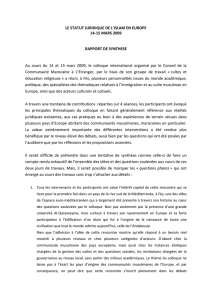C). Les réponses au non droit

1
Construction des lieux de cultes musulmans
di Jean C. Hergott
Introduction.
La construction des lieux de cultes musulman en France rencontre les difficultés observées en
Europe ; s’y ajoute le particularisme du régime de laïcité et de séparation des églises et de
l’Etat. Ces deux principes qui renvoient à une manière d’être, à un imaginaire politique et
national compliquent l’insertion d’une nouvelle tradition religieuse comme l’islam.
A cette donnée s’ajoute, également, comme en Europe mais avec des nuances nationales et
post coloniales, le rapport particulier à l’islam, coloré par les débats géopolitiques sur
l’islamisme.
L’islam des caves est aujourd’hui révolu, des projets de construction se multiplient. Mais
nous sommes très loin d’une situation normale et surtout du respect du droit. Par ailleurs, les
projets de construction se développent parallèlement à l’islamophobie, en témoigne le débat
sur les minarets.
La construction des lieux de culte musulmans sera abordée à partir des invariants qui
caractérisent la construction de tout édifice religieux.
Puis j’évoquerai le cadre juridique, et spécialement celui de la liberté de religion et de
l’urbanisme pour, dans une dernière partie, préciser l’attitude des élus locaux et donner
quelques exemples sur le non droit qui fait souvent obstruction à la construction des lieux de
cultes musulmans.
1. Contexte français
Avant de parler des lieux de culte et précisément de la construction des lieux de culte
musulman, je vous propose d’exposer brièvement le contexte des relations entre l’Etat et les
églises en France.
Depuis 1905, ces relations sont sous le régime de la séparation.
On distingue traditionnellement le régime des églises nationales (églises d’Etat
comme dans les pays nordiques où la tradition religieuse est liée à l’histoire de
l’identité nationale), les régimes de reconnaissance ou d’église établies, les régimes
conventionnels (Concordat, ententes…), la séparation (France, Pays Bas).
Si la définition de la liberté de religion est la même pour tous les pays européens
(article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), il est possible de

2
dire qu’il existe autant de régimes de relation Etat / églises qu’il y a d’histoires des
pays européens et des églises et même davantage (ex : France, Alsace Moselle,
Guyane, Réunion, Marquises)
La loi de 1905 est d’abord la marque d’une histoire complexe :
- celle d’une lutte dés le moyen âge entre le pouvoir royal (temporel) et le pouvoir du pape
(spirituel) avec une affirmation progressive du pouvoir de l’Etat sur l’Eglise, puis les
églises (Philippe le Bel, François 1er).
- Celle de l’émergence de conceptions philosophiques qui affirment une autonomie du
politique vis à vis du religieux et construisent une théorie politique de la séparation
(Lumières mais Michel de L’Hôpital fortement marqué par la guerre de religion entre
catholiques et protestants)
- Celle d’un combat politique contre l’influence idéologique et morale de l’Eglise (notion
de laïcité qui apparaît tardivement, écoles publiques, laïcisation des cimetières).
Fondamentalement, même s’il existe trois anciennes traditions religieuses, catholique,
protestante et juive, cette histoire complexe est celles des relations entre l’Eglise
Catholique et l’Etat (pouvoir royal, Napoléon ou les Républiques). Bruno ETIENNE
définissait la mentalité française comme catho laïque et, pour en définir les évolutions,
BAUBEROT parle de seuils de laïcité. Sur un plan plus strictement lié à l’évolution
des idées politico religieuses, peuvent être cités Marcel GAUCHET ou Stéphane LE
BRAS.
Pour autant, la loi de 1905 est une loi de compromis (CLEMENCEAU : un discordat) entre :
- les partisans d’une mise sous tutelle de l’église et d’une réduction complète de son
influence (Emile COMBES, ancien séminariste) (éradication)
- les partisans d’une réduction de l’influence de l’église dans la société (notion d’églises
« modérées » par référence au discours d’aujourd’hui sur « l’islam modéré »).
« Les diverses croyances religieuses (doivent être) contenues et respectées dans leur
domaine propre. (Cela aboutit à) une République pleine de laïcité et de tolérance absolue,
un régime de paix définitive » ( Jean-Jaurès, Chambre des députés, novembre 1906). De
M de L’Hôpital à JAURES, en passant par Napoléon (le Concordat pour « pacifier la
France »), un spectre hante l’histoire du pays : la crainte des affrontements religieux et le
souhait d’une pacification.
Les premiers comme partie des seconds auront à l’esprit, que de toute manière le religieux ne
pouvait être, face au rationalisme et aux sciences, que dans une logique d’extinction
progressive.
Mais dés 1914, se noue à nouveau « l’union sacrée » entre l’Etat et l’église catholique ainsi
qu’avec les autres traditions religieuses.
Union sacrée
En fait, la loi de 1905 est ambiguë ; cette ambiguïté se lit dans la loi :
- la séparation est imparfaite
- l’église catholique apparaît favorisée au regard de la situation des autres cultes
loi de 1905

3
- les deux premiers articles posent le principe de la liberté de culte (qui n’est pas à
proprement parlé la liberté de religion), de la fin de la reconnaissance, la suppression de la
prise en charge des traitements du clergé et l’interdiction des subventions.
En apparence, ces articles définissent un régime de séparation. Ils peuvent être comparés avec
les articles 7 et 8 de la constitution italienne qui définissent deux régimes conventionnels, l’un
pour le Vatican, l’autre pour les autres cultes.
constitution italienne
Mais, les articles de la loi de 1905 posent également le principe de la propriété publique des
lieux de culte et de leur mise à disposition gratuite aux églises.
- * il s’en suit que l’église catholique se retrouve dans la situation de bénéficier d’un
important patrimoine cultuel à titre gratuit, patrimoine qui restant public est pour son
entretien à la charge de l’Etat ou des collectivités locales.
- Si la loi fera l’objet d’une contestation idéologique très forte de la part du Vatican, le
clergé français va assez rapidement y reconnaître un intérêt. Les tensions vont s’apaiser
d’autant plus fortement que la droite catholique va rester une donnée importante de
l’histoire française jusque dans les années soixante. La séparation à la française est en
réalité très différente d’une séparation absolue comme celle-ci existe aux Etats-Unis ou
encore aux Pays Bas (ces deux derniers modèles étant très différents l’un de l’autre)
- - rompues, les relations diplomatiques seront rétablies dès le début des années 20. Le droit
local d’Alsace Moselle est maintenu (droit des cultes, enseignement de la religion dans
l’école publique) Un président du conseil radical socialiste remet pour la première fois, à
titre officiel les pieds à Notre Dame de Paris, Léon Blum autorise la construction de
nouvelles églises autour de Paris par le biais de baux emphytéotiques. La jurisprudence et
le législateur apporteront des aménagements notamment fiscaux. Dans les années 80,
l’expression d’une laïcité apaisée est juste même si les débuts de la cinquième république
sont marqués en 1958, et dans les années 80 par des débats et des manifestations massives
sur le développement de l’enseignement libre, c’est à dire confessionnel. Remarquons que
la laïcité est devenue un principe constitutionnel, article 1er de la Constitution.
- Peuvent être observés, à titre d’exemples le retour des décrets créant des Congrégations (à
l’initiative de F MITTERRAND), la participation des églises aux comités publics sur
l’éthique.
En fait et en droit, l’évolution de l’application de la loi de 1905 présente 3 caractéristiques :
- une rémanence du régime des cultes reconnus (l’expression est de Magali FLORES
LONJOU) : la République implicitement mais concrètement « reconnaît » sinon en droit,
mais dans le fait des relations politiques, financières avec les cultes à des degrés plus ou
moins forts. L’ancienne hiérarchie entre catholiques, protestants et juifs est maintenue.
- Une implication financière de l’Etat malgré la lettre de l’article 2 de la loi de 1905.
loi de finances 2007
Sur l’évolution de l’application de la loi de 1905 et le contexte paradoxal, voici un exemple
caractéristique. La République ne salarie, ni ne subventionne les cultes. Dans le projet de loi

4
de finances pour 2007, on trouve un programme (ministère de l’intérieur) qui regroupe
l’engagement de l’Etat pour la vie politique, (élections et soutien aux partis), la vie
associative et les cultes.
- Une influence du droit européen qui oblige à une dialectique entre une conception
nationale centrée sur la notion « institutionnelle » de cultes et une conception européenne
centrée sur la liberté (individuelle et collective) de religion.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte paradoxal :
- elle est sans doute contraire à ce que pouvait envisager le législateur de 1905 au sens où
l’Etat entretient toujours des relations complexes et soutenues avec les religions.
- Elle se développe dans un contexte important de déprise religieuse, de sécularisation
massive de la société. L’évolution du code civil, (adultère, divorce, avortement, PACS)
comme la chute de fréquentation des églises en sont de excellents indicateurs.
Au début des années 80, la question laïque ou, vice versa, la question religieuse sont, semble-
t-il, des problèmes d’histoire mais plus des sujets d’actualité politique.
2. L’islam : la réception d’une nouvelle tradition religieuse et crispation sur la laïcité.
La sociologie des religions semble au début des années 80 une discipline en perte de vitesse
faute d’objet à étudier. Or, nous sommes aujourd’hui réunis et bien présents.
Deux phénomènes :
- à l’échelon français mais également européen : crise des églises établies mais dans le
même temps : recomposition du religieux (Danielle HERVIEU LEGER) réorganisation du
marché de la croyance (Frank FREGOSI) et « born again » dans toutes les traditions
religieuses.
- Islam en Europe
Cette nouvelle tradition va s’apprécier sous un triple aspect :
- local avec la demande de lieux de culte, de cimetières….
- National, au sens où le contexte politique et institutionnel n’est pas nécessairement adapté
aux questions que pose l’insertion de cette tradition et, où la question religieuse impacte le
discours sur l’immigration qui lui-même n’est pas sans lien avec le passé colonial.
- International, ou mondialisé pour reprendre l’expression d’Olivier ROY, dans la mesure
où l’islam est porteur de cet item appelé « le choc des civilisations » qui mêle l’histoire la
plus lointaine (les Croisades) et la géopolitique actuelle, qui fait émerger la figure « d’un
nouvel ennemi » (Karl SCHMITT), le « péril islamique » Gilles KEPEL, ou en Italie,
Oriana FALACI.
C’est dans ce contexte, éclairé par un régime de séparation qui a la caractéristique d’être
plastique que se pose la question de la construction des lieux de culte. De 1905 au début des
années 90, la séparation a évolué dans le sens d’une atténuation avec une question de laïcité
qui a fini par être une donnée historique plutôt qu’une donnée politique. La recomposition du
religieux, la place du religieux dans un nouveau contexte géopolitique et notamment de

5
l’islam, la visibilité du fait religieux musulman avec la revendication de lieux de culte, la
montée de revendications identitaires et communautaires ont conduit à une crispation de la
question laïque et à une émergence de l’islamophobie dont l’extrême droite s’est emparée.
Cette crispation touche toute la classe politique y compris l’extrême gauche (cf. : débat sur
une candidate NPA voilée).
opinion et mosquées / minarets
Le sondage IFOP de 2009 est intéressant. Le nombre des opposants a globalement doublé
depuis 2001, majoritairement à droite mais également de façon significative à gauche. A
remarquer le % important de favorables en Alsace où prévaut un régime de cultes reconnus.
Xavier Bertrand : « la France n’a pas besoin de minarets », Christian Estrosi, ministre et
maire de Nice, « il n’y aura pas de minarets à Nice »
Ce n’est pas qu’un problème français : sondage du Spiegel : 78% contre les minarets.
Il serait intéressant d’étudier l’évolution des opinions européennes : le débat tend à
s’homogénéiser, les variables historiques tendent à s’atténuer.
3. La construction des lieux de culte musulmans.
Quelques chiffres.
mosquées, France / Allemagne / Espagne / Pays Bas
France :
- 39000 églises
- 1700 lieux de culte musulman dont 8 à 10 mosquées, 0,1% avec minaret
- 1100 temples
- 300 synagogues
- 100 pagodes
Allemagne :
- 2600 lieux de culte musulman dont 70 mosquées + 30 en projet, 159 ont une coupole et un
minaret (nombre de musulmans : 3,5M)
Espagne :
- 800 lieux de culte dont 427 légalement reconnus (population : 1,5M)
Pays Bas
- 300 mosquées (population : 400 000)
En fait, en France, parler de la construction de lieux de culte pour les musulmans relève du
paradoxe. On pourrait davantage parler de la difficulté de construire dans un pays où
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%