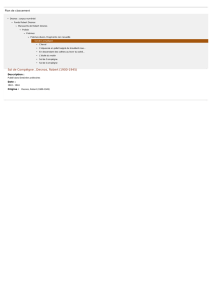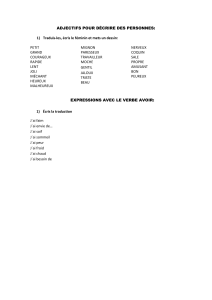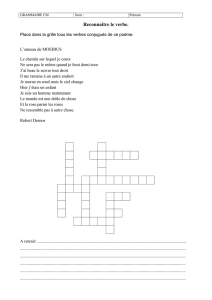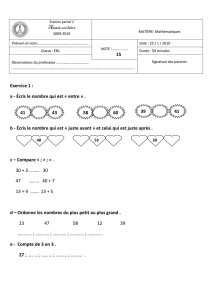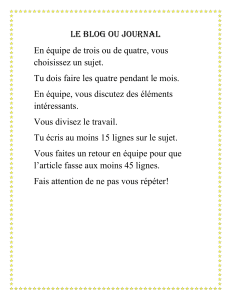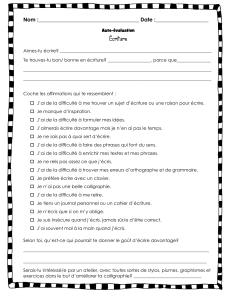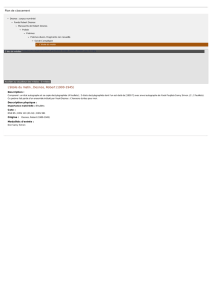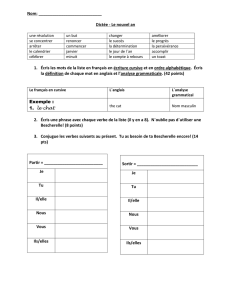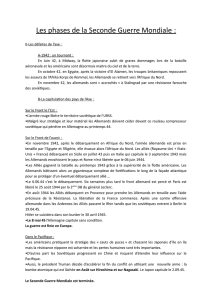Repères historiques sur la Résistance en France

ANTHOLOGIE
Poètes en résistance
Source : RESEAU-CANOPE
La Seconde Guerre mondiale et les années d’occupation ont provoqué de nombreuses
réactions chez les écrivains. Afin de témoigner, d’inciter à la réflexion et à l’action,
d’exprimer leur révolte, ou encore d’échapper à la censure, des poètes se sont engagés en
utilisant toutes les richesses de la langue française.
Poésie et engagement
La multiplicité de la production poétique pendant la Seconde Guerre mondiale et la notion
même de l’« engagement » littéraire soulèvent de nombreuses questions. Trois enjeux
méritent examen.
Tout d’abord, la représentation que le poète a de lui-même et de son rôle. Si écrire est acte de
résistance, si la poésie est en soi résistance, cela ne signifie pas nécessairement que la
participation résistante des poètes à l’Histoire se confonde avec leur écriture. « Engagement »
et « engagement littéraire » sont à dissocier.
Deuxième enjeu : le rapport du poète avec son public. Les « poètes de la résistance » ont
remporté une éclatante victoire : ils ont réconcilié la poésie et son lectorat,
traditionnellement confidentiel et élitiste. Cela s’est traduit par une audience sans précédent.
La production poétique a conquis par la simplicité de son lexique, l’efficacité de sa prosodie
et la charge émotionnelle qu’assumait son discours. Poésie populaire ou censée pouvoir le
devenir, elle offrait aux consciences en quête d’identification personnelle un miroir
accessible.
Dernière question : la relation du poète au langage. Outil de libération civique aux accents
voulus comme intemporels, assurément.
Louis Aragon
Écrivain et poète, Louis Aragon est né en 1897. Il a à peine 20 ans et poursuit des études de
médecine lorsqu’il rencontre André Breton. Tous deux admirent Mallarmé, Rimbaud et
Apollinaire. Parti pour le front des Ardennes en juin 1918, Aragon en revient décoré de la
croix de guerre. Aragon devient l’un des chefs de file de l’avant-garde littéraire. Avec André
Breton et Philippe Soupault, il crée la revue Littérature. C’est le début des années
vingt. À Paris, la saison « dada » bat son plein.
1920-1938. Le procès Barrès (1921) marque la scission entre Tzara et les futurs surréalistes.
Aragon publie ses premiers textes (Feu de joie, 1920 ; Anicet ou le Panorama, 1921 ; Les
Aventures de Télémaque, 1922) et signe avec Breton le Premier Manifeste du surréalisme
(1924). Tous deux adhèrent au parti communiste français en 1927. Aragon fait ensuite la
rencontre décisive d’Elsa Kagan (séparée de son mari, André Triolet). Ensemble, ils voyagent
en URSS et représentent les surréalistes lors du congrès des écrivains révolutionnaires de
Kharkov (1930). Après l’affaire du poème « Front rouge », Aragon opère une mise au point
dans L’Humanité qui entraînera la rupture définitive avec André Breton. Il se lance dans le

militantisme, et se consacre parallèlement à l’écriture romanesque (Les Cloches de Bâle,
1934 ; Les Beaux Quartiers, 1936) et journalistique (L’Humanité, secrétaire général de la
revue Commune, puis rédacteur en chef du quotidien Ce soir en 1937).
1939-1945. La déroute de la France conduit Aragon jusqu’à Périgueux. Capturé, il parvient à
s’échapper, se réfugie en zone libre et rencontre Pierre Seghers (1940) et Henri Matisse
(1941). Il s’engage en politique – utilisant ses romans pour illustrer le réalisme socialiste et
prôner l’avènement du communisme (Aurélien, 1944 ; Les Communistes, 1949-1951) – et
participe à la Résistance en créant avec Elsa Triolet le Comité national des écrivains pour la
zone Sud et le journal La Drôme en armes. Il s’engage aussi par ses poèmes, publiés dans la
clandestinité, dans lesquels l’amour de la femme (Les Yeux d’Elsa, 1942) rejoint l’amour de la
patrie (« Le Musée Grévin », 1943 ; « La Rose et le Réséda », 1944).
1945-1982. Aragon reste fidèle à la ligne générale du Parti, et fonde Les Lettres françaises.
Anéanti par la disparition d’Elsa Triolet (juin 1970), il décide de léguer au CNRS ses archives
personnelles ainsi que celles d’Elsa. Il meurt le 24 décembre 1982.
Louis Aragon laisse une œuvre considérable qui explore les ressorts classiques ou novateurs,
lyriques ou politiques, de l’écriture romanesque et poétique.
« La Rose et le Réséda », Louis Aragon, 1946 (Il s'agit d'un appel à l'unité dans la
Résistance, par-delà les clivages politiques et religieux.)
À Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves comme à Guy Môquet et Gilbert Dru
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats
Lequel montait à l’échelle et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Qu’importe comment s’appelle cette clarté sur leur pas
Que l’un fut de la chapelle et l’autre s’y dérobât
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Tous les deux étaient fidèles des lèvres du cœur des bras
Et tous les deux disaient qu’elle vive et qui vivra verra
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Du haut de la citadelle la sentinelle tira
Par deux fois et l’un chancelle l’autre tombe qui mourra
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Ils sont en prison Lequel a le plus triste grabat
Lequel plus que l’autre gèle lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas

Un rebelle est un rebelle deux sanglots font un seul glas
Et quand vient l’aube cruelle passent de vie à trépas
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Répétant le nom de celle qu’aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle même couleur même éclat
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
Il coule, il coule, il se mêle à la terre qu’il aima
Pour qu’à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat
Celui qui croyait au ciel celui qui n’y croyait pas
L’un court et l’autre a des ailes de Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle le grillon rechantera
Dites flûte ou violoncelle le double amour qui brûla
L’alouette et l’hirondelle la rose et le réséda
Louis Aragon, mars 1943 (repris dans La Diane française, 1944)
Les Fusillés de Châteaubriant
1941 est une année importante pour la Résistance en France. Les groupes et les réseaux
se développent. Particulièrement après l’engagement officiel du Parti communiste dans la
lutte provoquée par l’attaque allemande contre l’URSS, les attentats et les sabotages contre
l'occupant se multiplient. La réaction de celui-ci est de plus en plus violente. À la suite de
l'attentat survenu le 21 août contre l'aspirant Moser, dans le métro à Paris, une ordonnance
allemande décrète que tous les Français mis en état d'arrestation seront considérés comme
otages et, qu' "en cas d'un nouvel acte, un nombre d'otages correspondant à la gravité de l'acte
criminel commis sera fusillé". Si les fusillés de Châteaubriant ne sont pas les premiers otages
exécutés, leur massacre est le point de départ des exécutions massives perpétrées à titre de
représailles par les Allemands.
À la mi-octobre, des groupes armés, dont les membres sont présentés comme des
"terroristes" par les Allemands, programment une série d'opérations à Bordeaux, à Nantes et à
Rouen. Ces actions visent à obliger l'occupant à maintenir des troupes sur l'ensemble du
territoire en entretenant un climat d'insécurité ainsi qu'à développer la lutte armée. Le 19
octobre, un sabotage provoque le déraillement d'un train sur la ligne Rouen-Le Havre. Le
lendemain, vers 8 h 00 du matin, un officier allemand, le lieutenant-colonel Holtz, est abattu à
Nantes. Gilbert Brustlein et Guisco Spartaco, deux jeunes Parisiens, rencontrent sur leur
chemin, près de la cathédrale, deux officiers, Holtz et le médecin-capitaine Sieger et leur
emboîtent le pas. Au moment de tirer, l'arme de Spartaco s'enraye mais le revolver de
Brustlein atteint Holtz qui s'effondre.
La réaction de l’occupant est immédiate. À Châteaubriant, des troupes allemandes
viennent renforcer la gendarmerie française qui assure la garde du camp de prisonniers de
Choisel, dont la population est notamment constituée de détenus politiques arrêtés par le
gouvernement du maréchal Pétain. Le jour même, un officier allemand se présente au camp
pour y consulter la liste des détenus. Le lendemain, le général Von Stülpnagel, commandant
militaire en France, fait annoncer par voie d'affiche que, "en expiation de ce crime", cinquante
otages seront fusillés ainsi que cinquante autres si les coupables ne sont pas arrêtés avant le 23

octobre à minuit. Une récompense de quinze millions de francs est offerte pour la
dénonciation des auteurs de l'attentat.
Le choix des otages est laissé à la discrétion du gouvernement de Vichy. Sur la liste de
cent détenus présentée par les Allemands au ministre de l'intérieur Pierre Pucheu, les noms de
cinquante personnes sont retenus, essentiellement des communistes. Tandis que se prépare
ainsi l'exécution du premier groupe d'otages, un autre officier, le conseiller d'administration
militaire Reimers, est abattu à son tour à Bordeaux par Pierre Rebière. La riposte est la même
: cinquante otages fusillés, cinquante en sursis jusqu'à l'arrestation des coupables, offre d'une
récompense de quinze millions de francs aux dénonciateurs.
Le 22 octobre, vingt-sept otages sont fusillés à Châteaubriant. En début d'après-midi, ce
mercredi, les Allemands regroupent les otages dans une des baraques du camp de Choisel où
ils peuvent écrire une dernière lettre avant d'être conduits à la carrière de la Sablière, à la
sortie de la ville, lieu de leur exécution. Celle-ci se déroule en trois salves, à 15 h 50, 16 h 00
et 16 h 10. Tous refusent d'avoir les yeux bandés et les mains liées. Ils meurent en chantant la
Marseillaise. Le même jour, seize otages sont également exécutés à Nantes, au champ de tir
du Bèle, et cinq autres au Mont- Valérien. Le lendemain, les Allemands dispersent les vingt-
sept corps dans neuf cimetières des environs. Le dimanche suivant, malgré les interdictions,
des fleurs sont déposées à l'emplacement des neuf poteaux par la population de Châteaubriant
et de ses alentours. Dans le discours prononcé par le maréchal Pétain à la radio le soir du 22,
nulle condamnation de ces exécutions. Il dénonce au contraire les auteurs d'attentats et enjoint
aux Français de se dresser contre eux en les poussant à la délation : "Par l'armistice, nous
avons déposé les armes. Nous n'avons plus le droit de les reprendre pour frapper les
Allemands dans le dos… Aidez la justice. Je vous jette ce cri d'une voix brisée : ne laissez
plus faire de mal à la France."
Le 23 octobre, le secrétariat général à l'information diffuse un communiqué destiné à
apaiser les esprits : "Il est établi que les autorités occupantes ne choisissent pas les otages
destinés à être exécutés parmi les personnes arrêtées après un attentat, mais parmi les suspects
internés dont la culpabilité a été nettement prouvée".
Le 24 octobre, cinquante otages sont fusillés à Souges, près de Bordeaux, à la suite de
l'attentat du 21 octobre contre le conseiller militaire Reimers. Dans le même temps, le
maréchal Pétain propose de se livrer lui-même aux Allemands comme otage. Rencontrant
l'opposition de ses ministres, il renonce à son projet et Pierre Pucheu est chargé de négocier
avec les autorités d’occupation.
Les Allemands ont menacé de fusiller de nouveaux otages si les coupables ne sont pas
découverts. L'offre de récompense pour la dénonciation des auteurs de l'attentat n'ayant pas
porté ses fruits, Stülpnagel essaie d'amener les Français à coopérer en promettant aux familles
qui apporteront leur concours la libération des détenus en Allemagne et le retour des
prisonniers dans leur foyer. Au terme de ses tractations avec les autorités de Vichy,
Stülpnagel renonce finalement aux exécutions complémentaires.
Alors que l'autorité allemande pensait faire de la fusillade de Châteaubriant un exemple,
elle obtient l'effet inverse. Partout, cette exécution suscite l'indignation et la colère. Elle
frappe de manière irréversible la conscience des habitants de la région et l'ensemble de la
population française, jouant un rôle important dans la mobilisation des énergies pour
combattre l'occupant. Son retentissement est considérable dans le pays comme à l'extérieur.
« Les Fusillés de Châteaubriant », René-Guy Cadou, 1978
Ils sont appuyés contre le ciel
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel,
Avec toute la vie derrière eux

Ils sont pleins d’étonnement pour leur épaule
Qui est un monument d’amour
Ils n’ont pas de recommandation à se faire
Parce qu’ils ne se quitteront jamais plus
L’un d’eux pense à un petit village
Où il allait à l’école
Un autre est assis à sa table
Et ses amis tiennent ses mains
Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent
Ils sont bien au dessus de ces hommes
Qui les regardent mourir
Il y a entre eux la différence du martyre
Parce que le vent est passé là où ils chantent
Et leur seul regret est que ceux
Qui vont les tuer n’entendent pas
Le bruit énorme des paroles
Ils sont exacts au rendez-vous
Ils sont même en avance sur les autres
Pourtant ils disent qu’ils ne sont plus des apôtres
Et que tout est simple
Et que la mort surtout est une chose simple
Puisque toute liberté se survit.
« Octobre », Pierre Seghers, 1941
Le vent qui pousse les colonnes de feuilles mortes
Octobre, quand la vendange est faite dans le sang
Le vois-tu avec ses fumées, ses feux, qui emporte
Le Massacre des Innocents
Dans la neige du monde, dans l’hiver blanc, il porte
Des taches rouges où la colère s’élargit ;
Eustache de Saint-Pierre tendait les clefs des portes
Cinquante fils la mort les prit,
Cinquante qui chantaient dans l’échoppe et sur la plaine,
Cinquante sans méfaits, ils étaient fils de chez nous,
Cinquante aux regards plus droits dans les yeux de la haine
S’affaissèrent sur les genoux
Cinquante autres encore, notre Loire sanglante
Et Bordeaux pleure, et la France est droite dans son deuil.
Le ciel est vert, ses enfants criblés qui toujours chantent
Le Dieu des Justes les accueille
Ils ressusciteront vêtus de feu dans nos écoles
Arrachés aux bras de leurs enfants ils entendront
Avec la guerre, l’exil et la fausse parole
D’autres enfants dire leurs noms
Alors ils renaîtront à la fin de ce calvaire
Malgré l’Octobre vert qui vit cent corps se plier
Aux côtés de la Jeanne au visage de fer
Née de leur sang de fusillés
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%