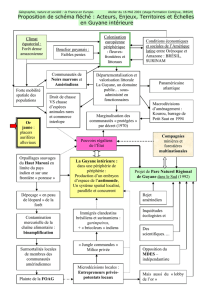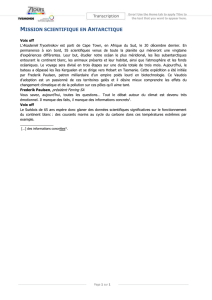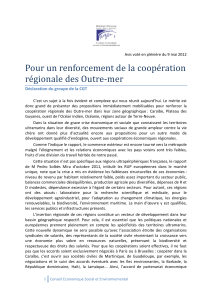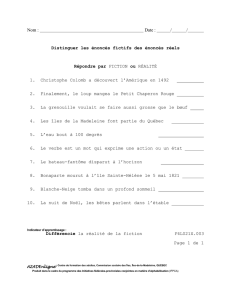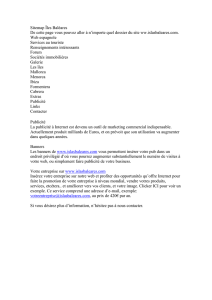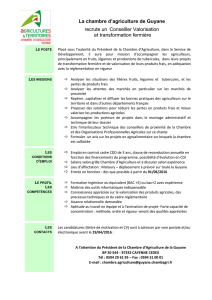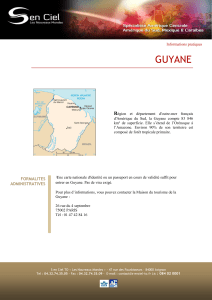Thème 3 L`Union européenne : dynamiques de

Thème 3 L’Union européenne : dynamiques de développement des territoires
De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne
- Qu’est-ce que l’Europe ? Quelle identité européenne ? Qu’ont en commun les Européens ? Où les caractéristiques
communes sont-elles les plus perceptibles ?
- Quelles dynamiques d’élargissement ou d’approfondissement de l’Union européenne ? Quels débats ces questions
suscitent-elles? Pourquoi l’UE est-elle à géométrie variable ? Quelle carte de l’Union européenne se dessine du fait des
adhésions sélectives aux politiques communes ?
- Quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne? Où et comment l’UE agit-elle pour
les réduire ? Quels sont les résultats de son action ?
1. Europe, Europes : un continent entre unité et diversité
Les habitants du continent européen partagent un certain nombre d’héritages historiques et culturels permettent de trouver
une certaine homogénéité. Mais le pluriel « Europes » se justifie par la grande diversité géographique et culturelle de ce
continent pourtant de faible étendue.
Rappel : le continent européen est fragmenté (de 44 à 50 pays, selon les limites qu’on lui donne). L'Europe a une
superficie de 10 392 855 km². Cela représente un tiers de l'Afrique (54 Etats) ou un quart de l'Asie (51 Etats) ou de
l'Amérique (44 Etats). L’Europe compte 724 millions d’habitants soit 10,6 % de la population du globe.
1.1 Les éléments d’unité du continent européen
Le continent européen présente certains traits d’unité qui sont principalement issus d’un héritage historique et culturel
commun.
un héritage judéo-chrétien, c’est-à-dire l’influence prédominante des religions fondées sur la Bible : différentes
Eglises chrétiennes (catholique, protestante et orthodoxe) et le judaïsme ;
des valeurs aujourd’hui considérées comme universelles issues de l’humanisme de la Renaissance (XVe-XVIIe
siècles), période de renouveau intellectuel et artistique qui a redécouvert l’Antiquité classique (c’est l’héritage
gréco romain) et placé l’être humain et son épanouissement au coeur de ses préoccupations ; défendant la raison
et la liberté de pensée des individus (le libre-arbitre), les humanistes ont bénéficié de l’invention de l’imprimerie
pour la diffusion de leurs idées ; la philosophie des Lumières (XVIIle siècle) a poursuivi cette promotion de la
liberté individuelle qui débouchera sur la définition et la défense des droits de l’homme ;
l’État moderne, démocratique et garant des droits des individus que l’Europe a inventé ;
d’autres innovations majeures liées entre elles et également nées en Europe aux XVIIle et XIXe siècles : le
capitalisme (système économique et social caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la
recherche du profit) ; les révolutions industrielles des XVIIIe-XIXe s. et l’industrialisation ; « l’exploration » du
monde et l’expansion coloniale ; l’urbanisation.
Il résulte de ce développement économique ancien certaines caractéristiques géographiques que l’Europe partage avec
d’autres continents ou régions du monde, mais qui permettent de la différencier par rapport à d’autres ensembles
géographiques :
un haut niveau de développement comme l’indique l’IDH (Indice de développement humain), qui fait de l’Europe le
second ensemble le plus développé du monde après l’Amérique du Nord ; parmi les 50 pays en tête de classement, on
trouve 31 états européens ;
des densités de population élevées (69 hab/km² ; 100 hab/km² sans les parties européennes de la Russie et du
Kazakhstan).
un taux d’urbanisation (part de la population totale vivant en ville) élevé : alors qu’à l’échelle mondiale, la part des
citadins dépasse légèrement celle des ruraux, 72 % des Européens vivent en ville (2007). Certains pays développés ont
cependant une proportion plus élevée : Australie (91 %), Canada (81 %), Etats-Unis et Japon (79 %) ;
un réseau urbain très dense et un peuplement rural très continu caractéristiques des régions les plus denses du globe ;
la population continentale la plus âgée et la seule population du globe à stagner à l’échelle continentale ; elle pourrait
même diminuer d’ici 2030, ce qui est unique au monde.
1.2 Mais les éléments de diversité l’emportent
La diversité est donc ce qui caractérise le mieux les milieux européens : quoi de commun en effet entre la froide Laponie
finlandaise et le Sud méditerranéen aux étés secs, entre le doux climat océanique de l’Irlande et le rude climat continental
et montagnard de l’Oural septentrional, entre la plaine de Flandre et les hauts sommets du Caucase ?
Sur le plan politique, l’Europe comporte, comme les autres continents, des états de taille très variable. Elle présente même
la particularité de comprendre une partie du plus grand pays du monde (la Russie, dont la partie européenne est presque

aussi vaste que les 27 Etats membres de l’Union européenne) mais également les deux plus petits : le Vatican (44
hectares), qui est aussi avec moins d’un millier de résidents permanents le pays le moins peuplé du globe, et Monaco, qui
n’atteint pas les deux kilomètres carrés. L’Europe comporte plusieurs autres micro-Etats puisque sur les 231 pays ou
territoires recensés sur la planète, on relève également comme Etats en fin de classement le Luxembourg (175e), Andorre
(194e), Malte (205e), le Liechtenstein (216e) et San-Marin (222e).
Sur le plan démographique, les écarts ne sont pas moindres puisque à côté de ces toutes petites nations, l’Europe
comporte quelques poids lourds : la seule Russie d’Europe (114 millions d’habitants) émargerait en 11e position entre le
Japon et le Mexique, l’Allemagne (82 millions) occupe encore la 15e place, tandis que cinq pays se classent dans les
trente premiers (France métropolitaine, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Ukraine).
Enfin, ces pays sont-ils loin d’être homogènes sur le plan culturel (carte p. 202-203 + carte p. 208). On a vu que
l’Europe se partage entre plusieurs grands cultes (doc. 2). Certains pays se partagent même entre plusieurs religions,
comme l’Allemagne, ou comportent des minorités religieuses, que la carte n’a pas toutes représentées (par exemple les
protestants, les musulmans et les adeptes du judaïsme n’ont pas été figurés là où ils sont très minoritaires ou dispersés).
À côté de la division religieuse, la diversité linguistique n’est pas moindre puisque l’on ne compte pas moins de 225
langues sur le continent, même si la plupart se rattachent à trois grands groupes linguistiques indo-européens (langues
latines, germaniques et slaves). Une partie de ces langues sont employées par des minorités.
Les minorités nationales (n°1, p. 209) demeurent malgré un apparent ajustement des frontières des Etats aux nations par
les redécoupages des pays intervenus après chacune des guerres mondiales et à nouveau après l’effondrement des régimes
communistes en 1990. Entre 1957 et 2011, pas moins de quinze nouveaux pays ont ainsi vu le jour en Europe, pour une
seule disparition (la République démocratique allemande (RDA) ou Allemagne de l’Est après la réunification de
l’Allemagne en 1989).
La fragmentation croissante de la carte politique de l’Europe a accru le nombre de petits pays : sans parler des micro-Etats
cités supra, dont aucun n’excède les 500 000 h., sept autres créations pour la plupart récentes ne dépassent pas les 2,5
millions d’habitants (soit la population d’une région comme le Languedoc-Roussillon) : Islande, Monténégro,
Slovénie, Macédoine, Estonie, Kosovo et Lettonie. Aussi la superficie et la population moyennes des Etats d’Europe sont-
elles moindres qu’ailleurs : même avec la Russie, les pays d’Europe sont trois fois moins vastes et deux fois moins
peuplés que la moyenne planétaire.
En dehors de l’immense Russie, l’Europe, de faible dimension et fragmentée sur le plan géopolitique, ne comporte
cependant aucun très grand pays en termes de superficie : l’Ukraine figure seulement au 45e rang et la France
métropolitaine au 48e.
Enfin, l’extrême hétérogénéité des États européens se mesure à leur niveau de développement. Dix pays européens se
classent dans les 20 premiers. Six d’entre eux figurent même dans les dix premiers. Si l’Europe figure comme l’un des
trois pôles de la Triade avec l’Asie orientale et l’Amérique du Nord, elle le doit essentiellement à l’Europe occidentale.
Les pays les plus développés sont tous localisés en Europe de l’Ouest et du Nord. Les plus à la traîne se situent tous en
Europe orientale et notamment dans les Balkans (Europe du Sud-est : Ancienne république yougoslave de Macédoine
(ARYM), Bosnie-Herzégovine, Albanie, Serbie, Bulgarie).
Au regard de critères naturels, démographiques, géopolitiques et économiques, il est difficile de faire valoir l’unité de
l’Europe. Le morcellement politique croissant accroît le besoin de coopération pour assurer la paix sur un continent
divisé, compenser l’étroitesse des marchés nationaux par le libre-échange des marchandises et réduire les inégalités de
développement entre eux. L’Europe est donc un continent en quête d’unité politique.
2. L’Union européenne : frontières et limites ; une union d’États à géométrie variable
La CEE a été constituée à partir des six pays fondateurs déjà associés dans la CECA : Allemagne, France, Italie, Pays-
Bas, Belgique, Luxembourg (n°1, p. 211).
Il faut ensuite attendre 1973 pour qu’intervienne le premier élargissement, effectué vers le Nord-ouest avec les îles
britanniques (Royaume-Uni, Irlande) et le Danemark, soit l’Europe des 9. La CEE s’étend alors vers le nord.
Puis c’est l’élargissement en direction du sud. La Grèce, redevenue démocratique, a rejoint la CEE en 1981. C’est
l’Europe des 10, puis l’Europe des 12. En 1986, la péninsule ibérique (Espagne, Portugal), à son tour sortie de
nombreuses années de dictature.
La réunification allemande en 1990 conduit à l’absorption de l’Allemagne de l’Est, extension géographique sans nouvel
Etat membre. 1995 voit l’entrée de deux états nordiques (Suède et Finlande) et de l’Autriche dans ce qui est devenu entre-
temps (1993) l’Union européenne (Europe des 15).
L’agrandissement le plus spectaculaire intervient en 2004 puisque non seulement dix pays entrent dans l’UE d’un seul
coup (Europe des 25), avec de surcroît parmi eux huit anciennes démocraties populaires, seulement 14 ans après la chute
du rideau de fer. Cet élargissement agrandit l’Europe vers le Sud (Malte et Chypre) et surtout vers l’Est avec les huit

anciens pays communistes qui ont réussi spectaculairement leur conversion à l’économie de marché et leur transition
démocratique.
Le dernier élargissement absorbe deux autres anciens pays communistes, la Roumanie et la Bulgarie, élargissant l’UE
vers le Sud-est, donnant naissance en 2007 à l’actuelle Europe des 27.
La chute du communisme a donc fortement accéléré le processus d’intégration, augmentant en peu d’années le nombre
d’Etats membres, la Communauté étant passée de 6 à 12 pays en près de 30 ans, mais de 12 à 27 en peine plus de 20 ans
en raison de la multiplication du nombre de pays en Europe et du désir des anciens pays du bloc de l’Est de rejoindre une
Union européenne démocratique et prospère.
L’Union européenne est à « géométrie variable ». L’analyse de cartes permet de dégager le noyau des Etats adhérant à
l’essentiel des structures communes, notamment la monnaie unique et l’espace Schengen (carte p. 210), et les auréoles
d’Etats moins engagés. Les frontières ont donc tendance à s’effacer mais n’ont pas disparu. La notion même de frontière
est renouvelée (entrées dans l’Union par les aéroports, contrôle des flux sur des lieux qui ne sont plus les frontières
nationales…) – introduction p. 214.
L’extension spatiale suscite aussi l’émergence d’ensembles régionaux au sein de l’Union afin de défendre des positions
communes.
L’UE est susceptible d’accueillir de nouveaux membres. Pour être admis dans l’Union européenne, il faut manifester
l’adhésion à ses valeurs en présentant sa candidature puis respecter l’ensemble des conditions pour y rentrer (ce qu’on
appelle depuis 1993 les critères de Copenhague) en reprenant dans son droit national l’ensemble des décisions prises et
textes réglementaires adoptés depuis l’origine par les états membres : c’est la transcription (dans la législation du pays) de
l’acquis communautaire. Enfin, l’ensemble des Etats membres doit être d’accord pour accueillir le pays candidat.
L’agrandissement de l’Europe communautaire n’a donc pu se faire que par étapes.
Par ordre chronologique, l’Union européenne a officiellement reconnu comme candidats et ouvert des négociations
d’adhésion avec les cinq pays suivants (entre parenthèses, la date de reconnaissance officielle comme pays candidat) : la
Turquie (1999) ; la Croatie, ancienne république de l’ex-Yougoslavie (2004) ; l’Ancienne république yougoslave de
Macédoine (ARYM), également née de la disparition de la Yougoslavie communiste (2005) ; l’Islande, désireuse
d’adopter l’Euro suite à la crise financière de 2008 (2010) ; le Monténégro, un des derniers pays nés des divisions
successives de l’ancienne Yougoslavie (2010). Au regard du niveau d’avancement des négociations, la Croatie devrait
pouvoir intégrer l’UE d’ici à 2014 de même que l’Islande.
En 2009, deux autres pays se sont portés candidats : l’Albanie et la Serbie ; leur candidature n’a pour l’instant pas encore
été jugée recevable par l’UE au regard des exigences préalables, de sorte que les négociations d’adhésion ne sont pas
entamées.
D’autres pays situés en Europe ont officiellement « vocation à adhérer à l’Union européenne ». On les appelle candidats
potentiels : ce sont des Etats dont les Etats membres de l’UE reconnaissent officiellement qu’ils sont susceptibles
d’adhérer un jour. Ce statut leur est décerné par l’Union européenne sans que les pays en question aient auparavant
nécessairement fait acte de candidature. Deux pays des Balkans occidentaux faisant autrefois partie de la défunte
Yougoslavie sont désormais concernés : la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo.
En dehors de ces pays officiellement associés au processus d’élargissement, des débats ont lieu dans d’autres pays
d’Europe occidentale (Norvège, Suisse) sur l’opportunité d’une candidature éventuelle. Certains pays d’Europe orientale
ont fait connaître leur aspiration à rentrer dans l’Union européenne : l’Ukraine et la Moldavie et trois pays du Caucase
(Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) dont seul le premier est géographiquement européen si l’on s’en tient aux limites
traditionnelles.
3. Disparités et inégalités socio-spatiales : l’action de l’Union européenne sur les territoires
Les inégalités socio-spatiales concernent les disparités observées entre les populations ou les groupes sociaux en fonction
de l’endroit où ils vivent. L’Union européenne compare principalement ces écarts par région car c’est à ce niveau qu’elle
agit pour tenter de réduire ces disparités. De telles inégalités socio-spatiales s’observent aussi entre les espaces urbains et
espaces ruraux, notamment dans les parties les moins développées de l’espace communautaire. La Commission
européenne recherche une meilleure cohésion, c’est-à-dire une réduction des inégalités. Elle poursuit un triple objectif de
cohésion économique (réduction des disparités de développement entre Etats membres), sociale (réduction des écarts de
revenus et de chômage entre populations) et territoriale (réduction des différences de développement entre les territoires,
notamment régionaux).
3.1 Les inégalités entre États membres
Inégalités des PIB (n°1, p. 217). On distingue :
Les pays riches de l’Ouest (une douzaine de pays plus productifs que la moyenne de l’Union européenne) : le
Luxembourg, petit pays à l’économie tertiaire centrée sur les activités financières, est loin devant les autres, qui
appartiennent tous à l’Europe occidentale et à l’ancienne Europe des 15 (1995) , sauf la Grèce et le Portugal.

Les intermédiaires dont le PIB/hab. est situé entre la moyenne communautaire et 75 % de cette moyenne : une
demi-douzaine de pays d’Europe méditerranéenne, entrés avant 2003 (Grèce, Portugal) ou après (Chypre, Malte),
et centrale, les plus développés des PECO (Pays d’Europe centrale et orientale), territoires autrefois communistes
(Slovénie, République tchèque) ;
Les pauvres : 4 pays dont le PIB/habitant est compris entre 75 % et 61 % de la moyenne, autrement dit où la
richesse produite par tête est située entre les trois quarts et les trois cinquièmes de la moyenne. Ce sont toutes
d’anciennes économies communistes d’Europe centre-orientale ;
Les très pauvres : 4 pays d’Europe orientale où le niveau de productivité est à peu près deux fois plus faible que
la moyenne de l’UE, se situant autour de 50 %, voire moins.
Taux de pauvreté en Europe (le taux de pauvreté est la part de pauvres dans la population d’un pays (en fonction du
niveau de vie de ce dernier).
Les pays à forte proportion de pauvres pays (plus de 18,4 %) ont pour certains un faible PIB par habitant comme les pays
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), la Roumanie et la Bulgarie. La productivité étant faible, le niveau de vie
probablement aussi. Ces Etats n’ont pas les moyens de soutenir leurs populations désargentées, ce qui explique la part
élevée de pauvres. La crise financière débutée en 2008 a par ailleurs accru le chômage et endetté fortement la Grèce et
l’Espagne, deux pays méditerranéens où la part de pauvres a beaucoup augmenté.
La dizaine de pays de l’Union européenne comptant la plus faible proportion de pauvres (moins de 13,8 % de la
population) sont des pays riches à tradition de politiques sociales : pays nordiques, Pays- Bas, Autriche, France. Ce peut
aussi être d’anciens pays communistes moins développés mais ayant conservé leurs politiques sociales et de moindres
écarts de revenus entre catégories sociales (République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie).
Pour comparer le degré de pauvreté d’un pays à l’autre, il faut cependant comparer leur niveau de vie. Etre pauvre au
Luxembourg, pays à très fort niveau de vie, n’a pas la même portée que l’être en Bulgarie, dernier pays de l’UE pour son
PIB par habitant. C’est l’objectif de l’indicateur suivant.
Taux et seuil de pauvreté dans l’Union européenne
Le taux de pauvreté est la proportion de pauvres dans la population totale. Est considéré comme pauvre quelqu’un dont le
revenu est inférieur à 60 % de la médiane. Le seuil de pauvreté est le revenu en-dessous duquel on est pauvre dans chacun
des pays.
Les pays à faible proportion de pauvres sont les mêmes : République tchèque et Pays-Bas (10 %), et plusieurs pays où il
est compris entre 11% et 13 % (Suède, Slovaquie, Autriche, Danemark, Hongrie, Slovénie, Finlande et France). D’autres
restent sous les 15 %, c’est-à-dire en-deçà de la moyenne communautaire (18 %) (Luxembourg, Malte, Belgique,
Allemagne, Chypre). C’est majoritairement mais non exclusivement l’Europe du Nord et de l’Ouest.
Inversement, les États comptant une plus forte proportion de pauvres que la moyenne de l’UE sont situés en Europe
orientale (Roumanie, Bulgarie, pays baltes, Pologne) Lettonie, au Sud (Italie, Grèce, Espagne, Portugal) et dans les îles
britanniques (Royaume-Uni, Irlande).
Les écarts entre pays sont importants (variation de 1 à 2,5 entre les extrêmes).
3.2 Les disparités régionales (p. 199)
Le PIB (carte n°2, p. 229) régional le plus bas est de 6 400 euros par habitant et par an, tandis que la plus élevée dépasse
les 83 000 euros, soit un rapport de 1 à 77. Les régions les moins riches sont situées dans la moitié orientale de l’Union
européenne à savoir les Pays d’Europe centrale et orientale (PECO), de l’Estonie à la Bulgarie, prolongés par la Grèce.
Dans cet ensemble, aucune région n’atteint les 20 000 euros en dehors de régions capitales : Varsovie (Pologne), Prague
(République tchèque), Bratislava (Slovaquie), Budapest (Hongrie), Bucarest (Roumanie), Athènes (Grèce).
Les plus pauvres de toutes (moins de 14 000 Euros) sont situées sur la frange orientale de l’Union européenne le long de
sa frontière externe. L’Outre-mer constitue l’autre ensemble de régions en retard, à l’exception de Madère. Dans la moitié
Ouest, les régions à la traîne sont peu nombreuses : un Land (région) de l’Est de l’Allemagne, une partie de la Wallonie
(Belgique francophone) et des régions méditerranéennes : le sud-ouest de la péninsule ibérique (Portugal, Estrémadure) et
le Midi italien (Mezzogiorno).
Les plus productives (n°3, p. 217) se situent, à l’inverse, en Europe de l’Ouest : exception faite de celles qu’on vient de
citer, toutes les régions d’Europe occidentale sont au-dessus de la moyenne, du nord de la Finlande au sud de l’Espagne.
La mégalopole, région densément peuplée, urbanisée et industrielle s’étendant du Nord de l’Angleterre à l’Italie du Nord,
a les valeurs les plus élevées avec l’Europe du Nord : Danemark, Suède et Finlande. Une dizaine de régions atteint les
valeurs maximales : ce sont principalement des régions : Ouest de Londres, Ile-de-France, Stockholm, Copenhague,
Amsterdam, Francfort, Munich, Hambourg, Brême, Dublin, Vienne, Luxembourg.
Les régions les moins productives correspondent aux anciens pays du Bloc de l’Est qui ont pris du retard à l’époque
communiste (1945-1990) sur les pays d’économie de marché. Seule l’ancienne RDA a pu rattraper largement son retard
grâce à la réunification allemande qui a permis la solidarité de l’ex-Allemagne de l’Ouest et des aides de l’Union
européenne dès 1990. Ces pays restent aussi plus agricoles (ils comptent davantage d’agriculteurs dans la population
active). C’est aussi le cas des régions méditerranéennes en retard en Europe du Sud. Dans ces régions, l’agriculture est le

secteur le moins productif. L’industrie de ces pays n’a pas non plus achevé sa modernisation et elle repose sur des
secteurs plus traditionnels (métallurgie, textile, chaussure). Enfin, les services de haut niveau (activités financières,
conseil stratégique…) sont rares.
Les rares espaces où la productivité excède les 37 000 euros par tête correspondent presque tous à des régions-capitales
concentrant des activités de commandement (région londonienne, Paris, Stockholm, Copenhague, Amsterdam, Dublin,
Vienne, Luxembourg) ou plus largement à des régions métropolitaines comptant une forte proportion d’activités
financières (comme Francfort) ou d’industries de pointe (comme Munich). Ce sont soit des métropoles isolées, soit des
ensembles régionaux vastes, comme la mégalopole.
3.3 La politique de cohésion
(n°2, p. 217 ; carte p. 216)
La politique de cohésion désigne les politiques de mise à niveau des États les plus pauvres et de réduction des écarts entre
régions. Pour la période de programmation 2007-2013, cette politique va mobiliser 308 milliards d’euros.
L’Union européenne cherche d’abord à favoriser le décollage des pays les plus pauvres (en 1994, elle a créé le fonds de
cohésion pour financer ce rattrapage des économies les plus en retard). Tous les nouveaux Etats membres entrés depuis
2004 (PECO, Chypre et Malte) sont aidés par ce fonds (en plus de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce. On appelle pays
de la cohésion les 15 Etats bénéficiaires de ce fonds.
L’Union européenne mène également depuis 1988 une politique régionale visant à favoriser le développement des
régions en retard ou en crise.
D’autres fonds peuvent intervenir comme le volet A de coopération transfrontalière (n°2, p. 214) qui vise à faire coopérer
des régions entre elles de part et d’autre d’une frontière. Cela s’explique par les impératifs d’une coopération de proximité
pour traiter en commun des questions telles que le transport, l’emploi, le développement économique, les espaces
naturels, etc. en réalisant des projets communs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%