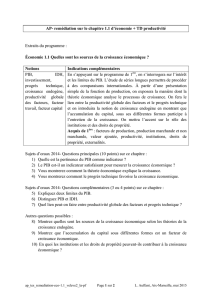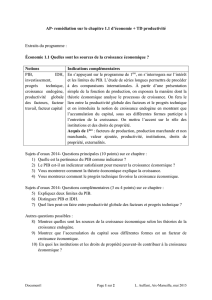Chapitre 2 : La production et le calcul du producteur

CHAPITRE 2
M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE
1
Chapitre 2 : La production et le calcul du producteur
Jean Fourastié (1907-1990) expliquait que nous travaillons pour transformer la nature
de façon à la rendre consommable. Pour pouvoir consommer, il faut transformer et donc
produire.
1. Notion de production
1.1 Définition de la production
La production désigne l’activité de création de biens et de services destinés à satisfaire les
besoins individuels ou collectifs.
Selon la définition de l’INSEE, « la production est l’activité économique socialement
organisée consistant à créer des biens et des services s’échangeant habituellement sur le
marché ou obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant sur le marché ».
1.2 Production marchande et production non marchande
La production est marchande lorsqu’elle s’échange ou est susceptible de s’échanger
sur un marché à un prix tel que l’on puisse considérer qu’il vise au moins couvrir les
coûts de production. C'est la production des entreprises, permettant de réaliser un
bénéfice de rémunérer les employés (salaires) et les apporteurs de fonds (intérêts et
profits);
La production non marchande, quant à elle, satisfait des besoins en dehors du
marché. Elle concerne des services destinés à être distribués « gratuitement » ou à
un prix inférieur à leur coût de production. Elle regroupe la production des
administrations publiques et des associations à but non lucratif et à caractère social,
mais repose en grande partie sur des ponctions fiscales sur la population en
contrepartie.
2. Mesure de la production
2.1 Mesure de la richesse par la valeur ajoutée
La production d’une unité ne mesure pas la « valeur » véritablement dégagée par celle-ci,
puisque cette valeur comprend des consommations intermédiaires (matières premières…)
nécessaires à l’élaboration des biens et des services (voir doc1). Pour mesurer la
contribution exacte d’une unité à la création de richesses, il convient de retenir la différence
entre la valeur de la production et le montant des biens ou des services utilisés dans le
processus de fabrication (ou consommations intermédiaires) : Cette différence est appelée
« valeur ajoutée ». Ainsi :
Valeur ajoutée = Production – Consommations intermédiaires
La valeur ajoutée : c’est la production réelle d’une entreprise, elle correspond à la
différence entre la valeur des biens et services qu’elle a produit et la valeur des biens
et services que les autres entreprises ont produits, et qui était utilisée dans son
processus de production.
Les consommations intermédiaires : sont les biens et les services produits par
d’autres entreprises et qui sont utilisés dans le processus de production de
l’entreprise.

CHAPITRE 2
M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE
2
2.2 Mesure de la richesse par les agrégats
a- Les différents agrégats de mesure de la richesse
Les agrégats de la comptabilité nationale sont des grandeurs synthétiques qui mesurent et
comparent, dans l’espace et dans le temps, les résultats de l’activité économique d’une
nation. Pour mesurer la production, la comptabilité nationale retient de multiples agrégats,
dont deux très significatifs :
Le produit intérieur brut (PIB) : mesure l’ensemble des richesses créées par la nation
durant une année ; Le PIB est un agrégat qui représente le résultat final de l'activité
de production des unités productrices résidentes. Il est égal à la somme des valeurs
ajoutées dégagées par les différentes unités productives résidentes.
PIB = Somme des valeurs ajoutées + TVA + droits de douane.
Le produit national brute (PNB) : Comme toute production génère des revenus, on
passe naturellement du PIB au PNB. Le PIB est approximativement égal au PNB. Il
faut toutefois ajouter au PIB les revenus en provenance de l'extérieur (transferts
reçus) et retrancher les revenus versés à l'étranger (transferts versés).
PNB = PIB + revenus des salariés et revenus de la propriété des
entreprises reçues de l'extérieur - revenus versés à l'étranger.
Le PNB ajoute ainsi au PIB les revenus du travail et de la propriété reçus du reste du monde
moins les revenus analogues versés au reste du monde. Le terme "National", dans Produit
National Brut, reflète ainsi la prise en compte de la valeur ajoutée produite par les résidents
du pays en question (principe de nationalité) mais il n'est pas intérieur parce qu'une partie de
cette valeur ajoutée est produite à l'étranger (le PIB est lui basé sur le principe de
territorialité).
b- Les limites de la mesure de la richesse par les agrégats
La mesure de la production, et plus généralement la comptabilité nationale elle-même, est
victime d’un certain nombre de lacunes qui en réduisent la pertinence. La mauvaise
évaluation des agrégats économiques (surévaluation ou sous évaluation selon les cas)
résulte de facteurs qui ne sont pas pris en compte :
- Le travail domestique (bricolage, jardinage, soins aux enfants au sein du ménage…) ;
- L’économie souterraine (travail au noir, pourboires non déclarés …) ;
- Les inégalités de répartition de la richesse ;
- Les nuisances (effets du bruit ou de la pollution atmosphérique sur la santé des
individus par exemple) ;
Illustration
Soit une usine fabricant des produits chimiques (engrais, peinture…) dont la
contribution en termes de richesse est évaluée à 1000 unités monétaires (soit 1000
de valeur ajoutée). Comme la production entraîne des dégâts sur l’environnement
immédiat, la municipalité et la région engagent alors un programme de dépollution
d’une valeur de 200 (salaires, achat de matériel).
- La comptabilité nationale retient donc 1200 de valeur créée (1000 + 200)
- Dans la réalité, les 200 dépensés par la collectivité ne servent qu’à réparer les
« dégâts du progrès »
- La richesse collective nette devrait être alors de 800 (soit 1000 – 200).
Le PIB mesure donc la richesse totale produite par l’activité économique sur un territoire
mais ne permet pas de conclusion sur le mode de vie réel de la population. En fait, la
comptabilité nationale n’apprécie qu’imparfaitement le bien être collectif.

CHAPITRE 2
M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE
3
3. Les facteurs de production
Pour produire, les agents économiques utilisent des facteurs de production ; c'est-à-dire les
différents éléments mis en œuvre dans le cadre du processus de production. On distingue
généralement deux facteurs : le travail et le capital.
3.1 Le facteur travail
Les ressources en travail d’une économie sont liées à l’importance quantitative et qualitative
de la population active. De même, à quantité de travail donnée, le niveau de production peut
varier en fonction de la productivité.
a- Les aspects quantitatifs du travail
Le volume de travail dans une économie dépend à la fois du nombre d’actifs disponibles et
du nombre d’heures de travail qu’effectue en moyenne chaque actif.
La population active : on entend par population active, l’ensemble des personnes qui
exercent un emploi ainsi que celles n’ayant pas d’emploi, désireuses d’en trouver un
et menant une recherche active pour cela. Au total, la population active comprend les
actifs occupés et les chômeurs.
Population active = actifs occupés + chômeurs
L’évolution de la population active dépend :
- De l’évolution démographique (natalité, mortalité, immigration…) ;
- Du taux d’activité qui est égal au rapport la population active et la
population totale.
La durée du travail : correspond au temps de travail qu’accomplit un salarié dans le
cadre de la production de biens et de services. On distingue la durée légale du travail
définie par les textes de loi, et la durée effective du travail qui tient compte de
l’absentéisme, du chômage technique et des heures supplémentaires.
La durée de la vie active ne cesse de diminuer en raison, d’une part de l’entrée plus
tardives des jeunes sur le marché du travail pour cause d’études plus longues, et
d’autre part d’une sortie plus précoce du marché du travail due à la diminution de
l’âge du départ à la retraite et au développement des dispositifs de préretraite.
b- Les aspects qualitatifs du facteur travail
La tertiarisation de l’emploi : le nombre d’emploi dans le secteur tertiaire (services,
télécoms, commerce) progresse régulièrement au dépend du secteur primaire
(agriculture, mines, forêt, pêche) et secondaire (industrie de transformation). La
croissance des activités de services est principalement due à l’élévation du niveau de
vie et aux nouvelles tendances en matière de consommation.
L’élévation des qualifications : les NTIC ont entraîné des changements importants
dans l’organisation du travail, amenant les entreprises à accroître leurs exigences en
terme de qualifications et de compétences nouvelles. Les postes d’encadrement ont
également crûe au détriment des postes d’agents non qualifiés.
Les nouvelles formes de l’emploi : les formes d’emploi atypique se sont amplifiées
ces dernières années. Il s’agit notamment des CDD (contrat à durée déterminée), du
travail intérimaire, du travail à temps partiel… Ces formes d’emploi permettent une
meilleure flexibilité facilitant ainsi l’adaptation et la réaction des entreprises face aux
changements. Toutefois, elles constituent une source de précarité de l’emploi et
présentent des risque d’instabilité pour les personnes qui les subissent généralement.

CHAPITRE 2
M. AOURAGH/ 1BTS PME-PMI/ ECONOMIE GENERALE
4
c- La productivité du travail
La productivité du travail repose sur une comparaison entre une production donnée et la
quantité du travail nécessaire à sa réalisation.
Ex : si 5 000 salariés produisent chaque année dans une usine 100 000 véhicules, la
productivité du travail sera :
On définit ainsi une productivité physique du travail car le numérateur, la production, est
mesurée en unités physiques. Donc :
Productivité physique du travail = quantité de production / quantité du travail
On peut également calculer :
Productivité en valeur du travail = valeur de la production / quantité du travail
= valeur ajoutée / effectif employé
Productivité horaire du travail = valeur ajoutée / nombre d’heures travaillées
= valeur ajoutée/effectif * durée moyenne
individuelle de travail
La productivité constitue un indicateur d’efficacité du travail. La mesure de la productivité
permet d’établir de ce point de vue des comparaisons entre les entreprises, les branches et
les économies.
Les écarts de productivité entre les entreprises concurrentes sont le plus souvent
explicatives des écartes de coûts et de prix ainsi que l’évolution des parts de marché. Les
différences observées entre branches ou entre économies en matière de productivité sont
par ailleurs à la base des différences de revenu et de niveau de vie.
3.2 Le facteur capital
Le capital est, comme le travail, un facteur de production qui correspond à l’ensemble des
biens destinés à produire d’autres biens et services.
a- Formes du capital
Le capital fixe : est l’ensemble des moyens de production durables (matériels et
constructions) qui participent plusieurs cycles de production
Le capital circulant : comprend les biens utilisables pendant un seul cycle (matière
première, énergies, produits semi-finis…)
Le capital technique : est l’ensemble des moyens de production utilisés pour produire
des biens et des services. Il est constitué de la somme du capital fixe et du capital
circulant.
b- La productivité du capital
Est le rapport entre un volume de production réalisé et le volume de capital nécessaire à
cette production.
Productivité du capital = valeur ajoutée / capital fixe
Productivité horaire du capital = valeur ajoutée / capital fixe * durée d’utilisation des
équipements
1
/
4
100%